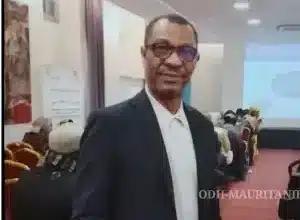Afghanistan, Sénégal ou Mauritanie : la migration intercontinentale passe par le Honduras

Afghanistan, Sénégal ou Mauritanie : la migration intercontinentale passe par le Honduras
Les effets des conflits, l’instabilité économique et sociale, résonnent à travers les milliers de kilomètres qui séparent l’Afrique ou l’Asie du continent américain.
Par Médecins Sans Frontières
Depuis un petit bureau de l’Institut national des migrations à Danlí, au Honduras , les migrants commencent à faire la queue à 8h30, une demi-heure avant l’ouverture des portes, pour recevoir le permis de transit dont ils auront besoin pour traverser légalement le pays d’Amérique centrale. Des semaines auparavant, la population hondurienne protestait contre une amende d’environ 250 dollars qui finirait par laisser de nombreux migrants avec moins de possibilités économiques pour traverser le Salvador, le Guatemala, le Mexique et, enfin, atteindre les États-Unis.
Les autorités ont cédé, reconnaissant le statut du pays comme destination de transit pour un itinéraire qui ne se termine pas au Honduras et l’importance de faciliter ce transit par l’amnistie à l’amende. Ainsi, sans ces frais, il serait encore plus facile pour les gens de se déplacer en toute sécurité vers leur prochaine destination. Les bus qui coûtent 40 dollars vous emmèneront pratiquement d’une frontière à l’autre, mais avant cela, ils s’arrêteront à Danlí ou à d’autres points de migration.
Quelques personnes sont arrivées au petit coin de l’INM en bus depuis la frontière la plus proche, Las Manos, à une heure de route en bas de la montagne. D’autres, dans des taxis, accompagnés de coyotes de contrebande qui assurent bon passage et confort durant leur bref séjour au Honduras. Et les autres, les moins fortunés, font un voyage de quatre heures soit sous la pluie, soit sous un soleil brûlant qui n’est arrêté que par un nuage occasionnel.
Alors que la ligne commence à s’allonger, un Mauritanien demande en anglais quand les services médicaux seront disponibles. « Dans peu de temps, si tu veux, attends au bureau et on t’attendra ici dehors », répond Kevin, psychologue à Médecins sans frontières (MSF) au Honduras. L’homme accepte, soulignant qu’il a des boules dans les pieds qui lui font très mal. Derrière, la clinique mobile commence à donner des consultations.
Lidia Guadalupe, agent de l’OIM, salue et commente : « préparez-vous, il semblait que le flux migratoire diminuait, mais pas vraiment. Les jours creuses, 70 à 80 personnes arriveront par lots de bus tout au long de la journée, mais lorsque le flux augmentera, il y aura 1 500 à 2 000 personnes qui traverseront ici cette semaine, la plupart en provenance du Venezuela et de pays asiatiques. Les premiers arrivés viennent d’Afrique : Mauritanie, Sénégal, Angola, Somalie.
Les effets des conflits, l’instabilité économique et sociale, résonnent à travers les milliers de kilomètres qui séparent l’Afrique ou l’Asie du continent américain. Ahmed*, 20 ans, originaire du Pakistan, raconte que son parcours en quête de sécurité a duré un mois, traversant chaque pays parfois sans rester plus d’une nuit. « J’ai pris l’avion du Pakistan à Dubaï (EAU), puis au Qatar, de là je pouvais aller directement au Paraguay et ce qui a suivi était le Brésil, la Colombie et le Panama, El Darién, et enfin nous sommes arrivés ici, au Honduras. » Son frère a insisté pour qu’il ne parle plus : il faut suivre le chemin. En arrière-plan, un chauffeur de taxi-coyote, s’impatiente, signalant qu’il est temps de partir.
Ahmed, en tant que migrant intercontinental, n’est pas seul. Au cours des six derniers mois, le projet de migration de MSF au Honduras a enregistré que 5,5 % de la population qui a reçu des soins médicaux provient d’au moins 45 pays entre l’Afrique et l’Asie. Ce pourcentage signifie qu’au moins 611 personnes sur plus de 10 000 ont traversé près de la moitié de la planète pour atteindre ce point sur la route migratoire. Parmi ceux-ci, la majorité chercherait des soins médicaux pour des infections respiratoires, des diarrhées, des affections musculaires et cutanées ou tissulaires, mais aussi des soins psychologiques pour des traumatismes et des affectations causés par leurs expériences.
Sous les rayons du soleil, vers 1 h 30 de l’après-midi, des centaines de personnes ont transité par les bureaux de l’INM. D’un coin de rue, Amina* s’approche timidement de la clinique mobile de Médecins Sans Frontières, portant dans ses bras une fillette qui baisse les yeux, cachant son visage dans le cou de sa mère. Elle se rend à son bureau et lorsqu’elle repart dans le fourgon-infirmerie, elle mentionne que le voyage l’a épuisée : « Je viens du Sénégal. Il a été très difficile d’arriver ici. J’ai été victime de violences, de vols, d’agressions. Le tout avec ma petite fille. Je veux juste une vie meilleure, mais à cause des problèmes avec la famille de mon mari, il était impossible d’y parvenir au Sénégal. Cela, ajouté à la violence dans mon pays, m’a fait fuir pour la première fois.
Fuyant une fois à cause de la violence et la fois suivante à cause d’une catastrophe naturelle sans précédent, dit Amina. « J’ai eu ma meilleure vie en Turquie, mais tout à coup les tremblements de terre sont arrivés, en avez-vous entendu parler ? Beaucoup de gens sont morts et nous nous sommes retrouvés sans rien. Chaque jour, nous avions peur que d’autres répliques se reproduisent. Nous n’avions pas d’autre choix que de repartir, mais je n’ai plus ma famille, ils sont tous au Sénégal ou en Turquie, même ma fille de 5 ans est là-bas, et une fois aux États-Unis, je veux pouvoir la récupérer. »
Les besoins en santé mentale des personnes qui migrent comme Amina ne sont pas mineurs. Le chagrin de quitter un espace peut parfois être aussi difficile à surmonter que toute autre perte. « Souvent, il y a des gens qui ont quitté leur lieu d’origine pendant des années, qui étaient dans différents pays et maintenant ils sont arrivés ici, mais ils ne peuvent pas revenir », explique Mayner Rodríguez, psychologue MSF à Danlí. « La barrière de la langue dans ces cas, bien sûr, est un défi auquel nous devons constamment faire face. Ce qui se passe alors, c’est que, parfois, le simple fait d’être à l’écoute, de les faire se sentir écoutés, peut leur apporter un soulagement qu’ils n’avaient pas eu jusqu’à présent ».
«La stratégie», poursuit Mayner, «dans de nombreux cas, consiste à normaliser les symptômes que les gens ont. Par exemple, s’ils sentent que leur cœur bat vite ou qu’ils ne respirent pas bien, c’est pour leur dire que sous le stress qu’ils subissent, il est normal que leur corps réagisse ainsi. Vient ensuite la validation de leurs émotions et le renforcement du contact et de la communication qu’ils ont avec leur famille ou les personnes avec qui ils font le chemin ».
Vers 4 heures de l’après-midi, les camions cessent d’apparaître et les dernières consultations sont effectuées avant la levée de la clinique. Là, une femme afghane est assise avec une fille de 12 ans. Elle ne parle pratiquement pas anglais, alors elle parle à sa sœur, Taara*, 22 ans, et raconte son parcours : « Nous sommes venus à pied, en camion, en avion, à travers la jungle panaméenne pour arriver ici. Ils nous ont donné un visa humanitaire au Brésil quand nous sommes arrivés d’Afghanistan. La jungle était difficile, mais nous sommes tous en bonne santé et nous espérons continuer maintenant », raconte-t-il tandis qu’un chauffeur de taxi-coyote l’interrompt en lui prenant le bras pour lui faire signe de monter dans la voiture. Il demande une minute.
« Si vous le savez, notre pays, l’Afghanistan , est désormais sous le pouvoir des talibans. Les femmes comme moi ne peuvent pas aller à l’université, à l’école, nous n’avons aucun droit. Nous voulons avoir une vie paisible aux États-Unis ; nous voulons la liberté. C’est la chose la plus importante qu’une femme puisse avoir », conclut-elle.
En arrière-plan, les enfants avec qui Taara voyage crient son nom : il est temps de continuer le voyage.
traduit de elfinanciero.com.mx