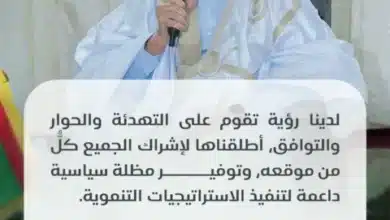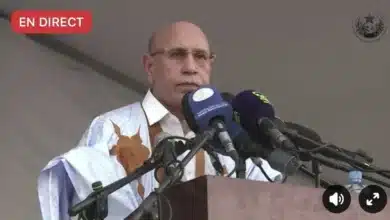L’énigme de l’opposition radicale en Mauritanie : silence, discours et défis pour la mobilisation populaire
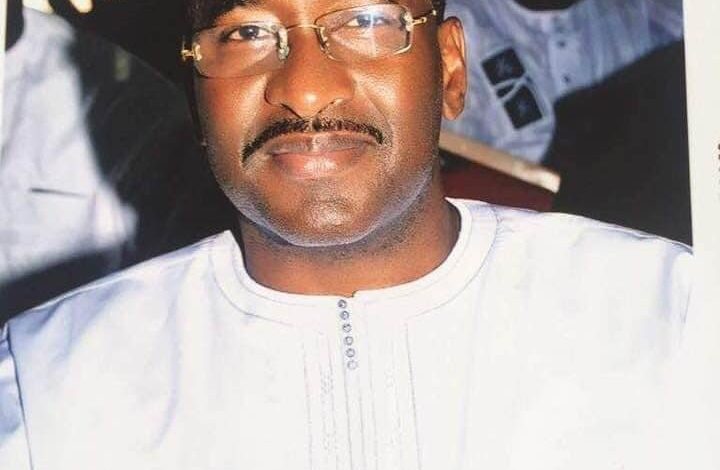
La phrase « En Mauritanie, la rue ne gronde jamais. À quoi sert donc cette opposition radicale qui est plutôt molle dans son action de protestation ? » soulève une question fondamentale sur la nature, l’efficacité et la légitimité de l’opposition dite radicale dans un contexte où la mobilisation populaire semble absente ou atone. Développons cela en plusieurs axes :
Un silence de la rue qui interroge
En Mauritanie, les grandes mobilisations de masse sont rares, même face à des crises politiques, économiques ou sociales graves. Ce silence peut s’expliquer par :
• La peur de la répression : manifestations violemment dispersées, arrestations arbitraires, surveillance.
• La fatigue populaire : après des décennies de frustrations, le peuple ne croit plus que la rue puisse changer les choses.
• L’absence de relais efficaces : syndicats affaiblis, société civile divisée, partis sans ancrage réel.
• La résilience sociale : dans certaines régions, la solidarité communautaire atténue le besoin de s’exprimer collectivement.
Une opposition “radicale” seulement dans le discours
L’opposition dite radicale se distingue souvent par un langage dur, des critiques frontales contre le pouvoir, voire un rejet du cadre institutionnel. Pourtant :
• Elle reste peu présente sur le terrain : peu de manifestations organisées, peu d’actions concrètes.
• Elle parle souvent à un cercle restreint : élites politisées, diasporas connectées, mais pas au peuple rural ou marginalisé.
• Elle subit ses propres contradictions : divisions internes, querelles de leadership, manque de vision unificatrice.
À quoi sert alors cette opposition ?
• Elle maintient un contre-discours utile : même si elle n’est pas toujours suivie, elle évite le monopole du récit par le pouvoir.
• Elle sert de soupape politique : elle permet à certains mécontentements de s’exprimer sans éclater violemment.
• Elle prépare des alternatives futures : dans des contextes instables, une opposition, même molle, peut gagner en légitimité lors d’une ouverture soudaine.
• Mais elle risque aussi l’illusion : en prétendant incarner le changement tout en étant inefficace, elle peut nourrir la désillusion.
Le vrai défi : renouer avec la base populaire
Pour être crédible, une opposition — radicale ou non — doit :
• Être présente dans les quartiers, les villages, les marchés.
• Porter les revendications concrètes (eau, justice, emploi, égalité).
• Construire une pédagogie du changement, sans peur ni illusion.
• S’organiser sérieusement : stratégie, alliances, constance.
En somme, une opposition radicale sans action réelle devient un théâtre d’ombres, inoffensif pour le pouvoir, inutile pour le peuple. Ce n’est pas la radicalité du ton qui compte, mais la capacité à incarner une espérance crédible, à mobiliser sans diviser, à protester sans fuir le réel.
MOUGNE TAN WETOV
Sy Mamadou