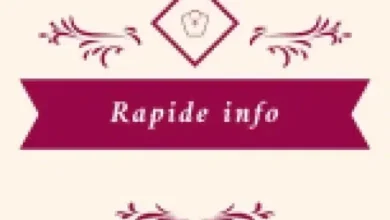Quand le Parlement devient l’écho du pouvoir : l’alerte de Ould Sidi Maouloud
Le député Mohamed Lemine Ould Sidi Maouloud dénonce une dérive grave au sein de l'Assemblée nationale mauritanienne : certains parlementaires agiraient en agents du gouvernement. Une alerte sur la confusion des rôles, le clientélisme et l'effacement du contre-pouvoir législatif.

Parlement
La déclaration de Ould Sidi Maouloud — selon laquelle certains députés espionneraient pour le compte de ministres, monnayant leur zèle à prix d’ami — jette une lumière sur une pathologie du régime représentatif : la confusion fonctionnelle entre représenter et servir. Le député cesse alors d’être un organe de contrôle pour devenir un prolongement de l’exécutif, un « agent double » qui abolit la verticalité du pouvoir législatif au profit d’une horizontalité clientéliste.
La dénonciation des applaudissements adressés aux membres du gouvernement dans l’hémicycle, aussi anecdotique semble-t-elle, a une portée symbolique considérable. Car dans un régime parlementaire sérieux, l’hémicycle n’est pas un stade ni une scène de théâtre. Applaudir l’exécutif, sans débat, sans interpellation ni contradiction, revient à renoncer à l’essence même de la fonction parlementaire : l’altérité institutionnelle. Dans ce contexte, l’applaudissement devient un acte politique — non pas de reconnaissance, mais de ralliement.
La référence implicite de Ould Sidi Maouloud ici est claire : certains députés semblent avoir oublié qu’ils sont le rempart du peuple, pas l’écho du pouvoir.
Lorsqu’il affirme que certains députés « ne savent pas s’ils sont les représentants du peuple face au gouvernement ou les représentants du gouvernement face au peuple », le député procède à une opération de clarification brutale. Cette phrase, digne d’un aphorisme constitutionnaliste, met en lumière une crise de rôle. Elle renvoie à une dépersonnalisation de la fonction : lorsque le député ne sait plus d’où il parle, ni pour qui, c’est tout l’édifice institutionnel qui vacille.
Ce constat renvoie à une logique d’inversion du mandat : au lieu de représenter ceux qui n’ont pas la parole, certains élus deviennent les relais de ceux qui n’ont pas besoin de voix supplémentaire. Ce brouillage des lignes compromet gravement l’équilibre des pouvoirs – fondement même de l’État de droit.
La réaction du vice-président de l’Assemblée nationale, El Hassan Cheikh Ould Baha, qui demande le retrait des propos au nom de la « protection de l’institution », illustre une autre tension : celle entre la liberté de parole parlementaire, principe cardinal du régime représentatif, et la tentation de censure préventive pour préserver l’image de l’hémicycle.
Mais c’est là tout le paradoxe : en voulant étouffer la dénonciation publique de pratiques occultes, on entérine leur existence souterraine. Ce que la forme condamne, le fond finit par bénir. Dans ce contexte, la demande de retrait devient un acte performatif de déni institutionnel.
Il est remarquable que toute cette séquence se soit enclenchée lors d’un débat sur la non-réalisation d’un projet aussi emblématique — la Grande Mosquée de Nouakchott annoncée depuis 2013. Il y a là un déplacement de la religion vers la politique, montrant que même les projets spirituels sont englués dans les lenteurs et les promesses non tenues du politique.
Ce que l’intervention de Mohamed Lemine Ould Sidi Maouloud révèle n’est pas seulement une indignation isolée. C’est une tentative de réactiver la fonction première du parlement : être une tribune de vigilance, un espace de contre-pouvoir, et non une chambre d’écho. Dans un contexte où les logiques d’alignement, de clientélisme convenu gangrènent l’espace public, sa parole — même contestée — retrouve une vertu : celle de la dissonance démocratique.
Les institutions solides ne sont pas celles qui évitent les scandales, mais celles qui savent les affronter sans tuer le messager.
Mohamed Ould Echriv Echriv