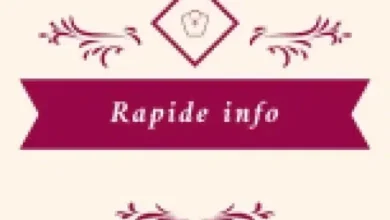Xénophobie ou bon voisinage ? Quand les discours enfiévrés défient la réalité des relations mauritano-maliennes

Xénophobie ou bon voisinage ?
Nouakchott – Bamako.
Il est des constats qui dérangent. Ces derniers mois, il n’est pas rare d’entendre, parfois jusque dans les cercles des élites, des voix maliennes ou mauritaniennes qui s’autorisent des relents de xénophobie. Des propos enflammés, souvent amplifiés par les réseaux sociaux, comme s’il fallait coûte que coûte allumer la mèche et transformer la fragilité régionale en brasier.
Cette crispation surprend, car elle contraste brutalement avec la ligne officielle des deux capitales. À Nouakchott comme à Bamako, les chefs d’État – Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et Assimi Goïta – multiplient les gestes de rapprochement, martelant leur attachement au bon voisinage. Coopération sécuritaire, échanges commerciaux, médiations discrètes : tout indique, dans les actes concrets, une volonté assumée d’apaisement.
Pourtant, une partie du discours public s’éloigne de cette réalité. Certains intellectuels, leaders d’opinion ou figures médiatiques s’autorisent des déclarations qui attisent les tensions et réactivent d’anciennes peurs. La rhétorique est simple, parfois brutale : l’autre est présenté comme un danger, un intrus, un concurrent menaçant.
Mais que valent ces cris d’alarme isolés, face à des décennies d’histoires partagées ? La frontière entre la Mauritanie et le Mali n’est pas qu’une ligne tracée sur une carte. Elle est un espace de vie, de brassage et d’échanges. Des familles y vivent entre deux pays, des marchés s’y tiennent chaque semaine, des caravanes de marchandises l’arpentent depuis des siècles.
« Circulez, il n’y a pas de feu », pourrait-on résumer, tant la politique des États reste à mille lieues de ces querelles verbales. Ghazouani comme Goïta, chacun à sa manière, a besoin de stabilité régionale. Le premier parce que la Mauritanie s’apprête à devenir un pôle énergétique avec l’exploitation gazière offshore ; le second parce que le Mali, enlisé dans une crise sécuritaire persistante, ne peut se permettre d’ouvrir un front diplomatique inutile.
Ce fossé entre le discours officiel et certaines dérives intellectuelles interroge. Est-ce le symptôme d’une frustration sociale ? D’une instrumentalisation politique ? Ou simplement l’effet grossissant de réseaux sociaux devenus caisse de résonance pour les colères brutes ?
Dans le brouhaha, une évidence s’impose : les destins de Nouakchott et de Bamako sont intimement liés. Et au-delà des discours enflammés, la réalité s’écrit chaque jour sur le terrain : commerçants, transporteurs, éleveurs et familles frontalières tissent un voisinage bien plus solide que les fantasmes d’exclusion.
Alors oui, certains veulent mettre « la baraque à feu et à sang ». Mais tant que la volonté politique demeure ferme, tant que les populations elles-mêmes refusent d’entrer dans ce jeu dangereux, la logique du bon voisinage reste la seule voie crédible.
En somme : circulez. La flamme nationaliste existe, mais elle se heurte à une réalité plus puissante – celle d’une interdépendance incontournable.
Rédaction Rapide info