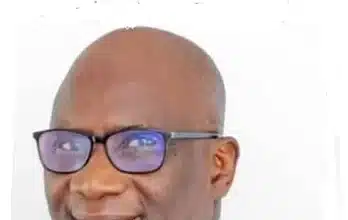Un militaire à la conquête du pouvoir civil: une gouvernance en mutation lente
Une gouvernance
Sur le plan politique, les signaux sont contradictoires. D’un côté, l’espace civique semble s’ouvrir : la presse respire un peu mieux, les arrestations d’opposants se font moins fréquentes, et les débats publics gagnent en vivacité. De l’autre, le système reste verrouillé : le parti présidentiel, El Insaf, domine les institutions, et les mécanismes de contrôle restent faibles. Le Parlement, pourtant renouvelé, peine à jouer son rôle de contre-pouvoir.
La lutte contre la corruption, pourtant érigée en priorité, avance à petits pas. Un rapport parlementaire explosif publié en 2020 a mis en cause la gestion des finances publiques sous Mohamed Ould Abdel Aziz. Ce dernier, convoqué par la justice, a été mis en examen pour détournements de fonds publics. Un tournant judiciaire sans précédent dans le pays. Mais pour beaucoup, le dossier piétine, et l’ancien président bénéficie encore de solides réseaux d’influence.
Une transition inachevée
Cinq ans après cette passation de pouvoir symbolique, la Mauritanie se trouve à la croisée des chemins. Le passage de l’uniforme au costume civil n’a pas encore débouché sur une transformation institutionnelle en profondeur. Ghazouani incarne une transition plus que réelle, mais incomplète. Sa présidence, marquée par une certaine prudence, semble osciller entre fidélité à un héritage militaire et volonté d’ouverture.
Les prochaines échéances électorales seront décisives. Elles diront si le pays poursuit sur la voie d’une démocratisation réelle, ou s’il retombe dans ses travers autoritaires. L’enjeu dépasse les seules figures du pouvoir : il concerne l’ensemble d’un peuple en quête de dignité, de justice sociale et d’avenir partagé.
Car derrière les jeux d’appareils, une exigence monte : celle d’un contrat social renouvelé, fondé sur l’inclusion, la mémoire apaisée et l’État de droit. En somme, une République où l’uniforme cédera, pour de bon, la place au costume civil.
La présidence de Mohamed Ould Ghazouani, arrivée au pouvoir en août 2019, s’inscrit dans un contexte politique mauritanien marqué par une évolution complexe entre héritage militaire et aspirations démocratiques. Dès ses premiers mois à la tête de l’État, l’ancien général, successeur de Mohamed Ould Abdel Aziz, met en œuvre une stratégie de décalage par rapport à son prédécesseur tout en adoptant une approche prudente, mesurée et, souvent, taciturne. S’il cherche à se distinguer de l’image de son prédécesseur, il s’attache aussi à maintenir un équilibre délicat, conscient des nombreux défis qui pèsent sur son mandat.
Un homme de consensus… ou un homme de pouvoir ?
Né dans une Mauritanie où l’armée a joué un rôle majeur dans la vie politique, Mohamed Ould Ghazouani semble avoir hérité d’un profil à la fois rassurant et pragmatique, mais aussi largement contraint par les structures du pouvoir militaire qu’il ne peut se permettre de remettre en cause de manière brutale. Dès les premiers mois de son mandat, le président s’efforce de se démarquer de Mohamed Ould Abdel Aziz, son prédécesseur, mais avec une prudence manifeste, et ce, malgré un ancrage commun dans le sérail militaire. Cette démarche met en lumière l’un des aspects les plus significatifs de sa présidence : une volonté de montrer qu’il n’est pas un simple prolongement de son prédécesseur, tout en conservant un attachement discret aux principes fondamentaux du régime qu’il a contribué à instaurer.
Au-delà de son discours sur la « rupture » et la « réconciliation », il déploie des initiatives qui oscillent entre ouverture et contrôle. Dès le début de son mandat, une série de gestes symboliques sont effectués en direction de l’opposition politique et de la société civile. Quelques figures de l’opposition, jusque-là marginalisées, sont invitées à participer à des discussions sur l’avenir du pays. Ce geste est salué comme un signe d’ouverture, mais le scepticisme reste de mise dans la classe politique. Cette tentative d’ouvrir un dialogue, bien qu’appréciée par certains, semble souvent être une démarche calculée et non une véritable rupture avec un système autoritaire que le président sait difficilement pouvoir déraciner de façon radicale.
Dans les faits, ces ouvertures demeurent timides et souvent limitées à des déclarations de bonne volonté sans changements concrets dans les rapports de force politiques. À l’inverse, les acteurs du pouvoir, principalement issus des rangs militaires et des partis favorables au régime, restent solidement installés dans les rouages de l’État, ce qui rend difficile une véritable dynamique démocratique.
Le paradoxe de la société civile
En parallèle, Mohamed Ould Ghazouani a également envoyé des signaux positifs à l’endroit de la société civile. Là encore, cette approche reste ambiguë. La société civile, bien que théoriquement plus libre d’exprimer ses revendications, se trouve souvent sous surveillance étroite, et les initiatives de réformes sont perçues comme fragiles. Les organisations de défense des droits humains et les ONG mauritaniennes, qui œuvrent dans un contexte où les libertés d’expression et d’association sont souvent restreintes, redoutent en silence que ce gouvernement, à défaut d’ouvrir véritablement l’espace politique, cherche à les coopter tout en les contrôlant étroitement.
Pourtant, ces dernières années, on peut observer des signes de désireux changements. Des discours sur le respect des droits humains, sur la lutte contre l’esclavage (dont l’abolition reste un combat de longue haleine), sur la place des femmes, ont pris une place plus importante dans les discours officiels. Mais ces avancées s’accompagnent de contradictions notables, car si des réformes sont évoquées, les actions concrètes restent souvent en deçà des attentes, le tout dans un climat politique où l’opposition à la présidence demeure discrète et surveillée.
Entre continuité et rupture : un président discret mais stratégique
La présidence de Mohamed Ould Ghazouani incarne donc ce paradoxe constant : celui d’un homme de consensus, ou du moins de façade, pris dans les contradictions d’un pouvoir militaire qui ne peut, à ce stade, se défaire totalement de ses racines autoritaires. Un équilibre précaire qui implique que la transition vers une démocratie véritable soit vue davantage comme un processus progressif, mais marqué par de multiples freins internes et externes. La transition démocratique en Mauritanie semble ainsi être une œuvre inachevée, où l’engagement du président envers les réformes constitutionnelles et politiques est mis à l’épreuve du réel.
En tant qu’ancien ministre de la Défense et figure militaire influente, Mohamed Ould Ghazouani ne peut échapper à l’héritage de son passé. La transition, bien qu’entamée sous son mandat, se heurte aux résistances structurelles d’un système politique façonné par des décennies de pouvoir militaire. Dans ce contexte, sa stratégie consiste à avancer de manière graduelle, tout en évitant les ruptures brutales qui pourraient fragiliser sa position ou déstabiliser l’équilibre précaire qu’il cherche à maintenir.
Cependant, ce qu’il manque peut-être dans sa présidence, c’est la volonté claire de tourner la page du passé et d’offrir à la Mauritanie un véritable contrat social, où le peuple serait réellement impliqué dans les décisions politiques. La légitimité de Mohamed Ould Ghazouani, acquise dans les casernes et sur le terrain militaire, semble moins évidente à transformer en une légitimité populaire durable.
Les défis d’une transformation profonde
Le véritable défi de la présidence de Mohamed Ould Ghazouani est de parvenir à concilier la légitimité qu’il détient grâce à son parcours militaire avec une gouvernance démocratique crédible. Il doit surmonter une série de défis politiques et sociaux : maintenir un climat de stabilité politique, encourager une transition démocratique efficace et offrir des réponses concrètes aux aspirations populaires. Mais la route est semée d’embûches, et les observateurs avertis restent méfiants quant à la possibilité d’une véritable réforme politique sous sa houlette.
Le discrédit vis-à-vis des anciens dirigeants du pays, marqué par les années Ould Abdel Aziz, pourrait être un levier pour Ould Ghazouani afin de redéfinir les bases de son autorité. Cependant, la transition qu’il incarne doit aller au-delà des gestes symboliques. Elle doit aussi traduire un changement tangible dans la gestion du pays, dans la participation politique et, surtout, dans la transparence et la répartition équitable des ressources.
À l’heure actuelle, la présidence de Mohamed Ould Ghazouani continue de jouer un jeu d’équilibre, dans un environnement où la moindre erreur pourrait avoir des conséquences dramatiques. Au cœur de cette gestion politique se trouvent des questions fondamentales : la Mauritanie pourra-t-elle, sous sa présidence, dépasser les dilemmes de son passé pour s’engager sur la voie d’une démocratie inclusive et véritablement respectueuse des libertés fondamentales ? La réponse à cette question déterminera, en grande partie, l’avenir de son mandat et celui du pays.
Conclusion
Ainsi, sous la présidence de Mohamed Ould Ghazouani, la Mauritanie semble se trouver dans une phase de transition, mais une transition marquée par de nombreuses ambiguïtés. Si les gestes d’ouverture existent, la réalité politique reste étroitement surveillée et contrôlée. Mohamed Ould Ghazouani doit trouver le juste équilibre entre les héritages du passé et les exigences d’une société en quête de réformes profondes. À ce titre, son avenir politique, et celui de la Mauritanie, reste étroitement lié à sa capacité à instaurer un véritable contrat social qui dépasse les clivages hérités du régime précédent.
Sources
Amnesty International (2020). Mauritanie : Droits humains sous surveillance. Amnesty International.
Ce rapport de l’ONG explore les défis liés à la liberté d’expression et aux droits humains en Mauritanie sous la présidence de Mohamed Ould Ghazouani.
Al Jazeera (2019). Mauritania’s Ould Ghazouani sworn in as president.
Article sur l’investiture de Mohamed Ould Ghazouani et les premières démarches de son gouvernement pour se différencier de l’administration précédente.
International Crisis Group (2020). Mauritania: A Fractured Transition.
Rapport sur les défis politiques, économiques et sociaux auxquels Mohamed Ould Ghazouani doit faire face, tout en soulignant les tensions entre continuité et changement.
Le Monde (2019). Mauritanie : Ould Ghazouani, l’héritier discret.
Article d’analyse sur la personnalité de Mohamed Ould Ghazouani et ses premières décisions en tant que président de la Mauritanie.
Freedom House (2021). Mauritania: Freedom in the World 2021.
Indicateurs sur l’état de la liberté en Mauritanie et les principales réformes politiques entreprises par le gouvernement.
BBC News (2020). Mauritania’s Ould Ghazouani faces challenge of ‘reconciliation’.
Article abordant les premières années de la présidence de Mohamed Ould Ghazouani, avec un focus sur ses efforts de réconciliation nationale et ses difficultés à instaurer une démocratie effective.
The National (2020). Mauritania: Ould Ghazouani’s path to legitimacy.
Un article qui met en lumière les stratégies politiques de Mohamed Ould Ghazouani pour renforcer sa légitimité tout en maintenant l’ordre militaire.
Le Calame (2021). Mauritanie : En quête de transition démocratique.
Analyse sur la transition politique en Mauritanie sous Ould Ghazouani et les défis auxquels la société civile et l’opposition sont confrontées.
Reporters Sans Frontières (2021). Mauritanie : Une presse sous contrôle.
Rapport détaillant les pressions exercées sur les médias en Mauritanie et les tentatives du gouvernement de réguler la liberté d’expression.
UNDP (United Nations Development Programme) (2020). Mauritania’s Development Challenges under Ghazouani.
Un rapport sur les enjeux de développement auxquels fait face la Mauritanie sous la présidence de Mohamed Ould Ghazouani, et les efforts pour moderniser l’économie tout en respectant les impératifs politiques.
Bibliographie
Barry, M. (2018). Les armées en Afrique : Entre pouvoir politique et contrôle social. Éditions L’Harmattan.
Ouvrage de référence qui analyse le rôle de l’armée dans la politique mauritanienne et son influence sur les régimes successifs.
Brachet, J. (2020). Mauritanie : Les dilemmes de la transition démocratique. Presses Universitaires de la Sorbonne.
Étude approfondie sur les difficultés rencontrées par la Mauritanie dans son cheminement vers la démocratie, particulièrement sous la présidence de Mohamed Ould Ghazouani.
Ndiaye, M. (2021). Mauritanie : La lutte pour l’égalité et les droits humains. Éditions Karthala.
Ouvrage qui met en lumière les réformes sociales et politiques entreprises par le gouvernement de Mohamed Ould Ghazouani, et les réactions de la société civile.
Daffé, A. (2020). L’héritage militaire dans la politique mauritanienne : Continuation ou rupture ? Editions Africaines.
Ce livre analyse la continuité et la rupture des dynamiques politiques en Mauritanie après le départ de Mohamed Ould Abdel Aziz, notamment sous la présidence de Ghazouani.
Messaoudi, A. (2019). Le rôle de l’opposition dans la transition politique en Mauritanie. Éditions du CNRS.
Étude sur la place de l’opposition dans le processus de transition politique, avec un accent particulier sur les premiers mois de la présidence de Mohamed Ould Ghazouani.
Sahraoui, H. (2022). La Mauritanie et les défis du XXIe siècle : Gouvernance, transitions et sociétés civiles. Editions L’Harmattan.
Ce livre offre une analyse comparative des transitions politiques en Mauritanie, avec un focus sur les efforts de modernisation et de démocratisation sous Ghazouani.
L’ascension par la discrétion et la fidélité
Vers la politique civile : Le virage du Ministère de la Défense
Un militaire à la conquête du pouvoir civil
Ahmed Ould Bettar
Rapide info