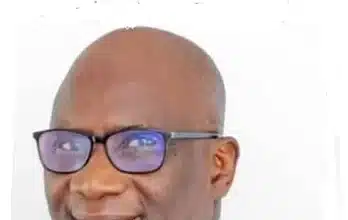Un militaire à la conquête du pouvoir civil

Pouvoir
Le 22 juin 2019, un événement marquant s’est déroulé en Mauritanie. Les électeurs se sont rendus aux urnes pour une élection présidentielle qui, pour la première fois depuis l’indépendance du pays en 1960, s’est tenue dans un cadre de transition politique pacifique. Ce scrutin a été le théâtre d’un double enjeu : la pérennisation d’une démocratie naissante et la mise à l’épreuve d’une élite politique encore teintée de pratiques autoritaires.
Le président sortant, Mohamed Ould Abdel Aziz, a respecté la Constitution qui limite les mandats à deux, ne se représentant pas, une décision qui a ouvert la voie à un nouveau leader. C’est Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, ancien ministre de la Défense et proche de l’ancien président, qui a été choisi pour porter les couleurs du pouvoir. La continuité politique semblait alors assurée, mais l’ombre des doutes et des tensions planait déjà sur le processus électoral.
Dès le premier tour, Ghazouani a été proclamé vainqueur avec 52 % des suffrages exprimés, mais cette victoire ne s’est pas déroulée sans heurts. Avant même que la Commission électorale nationale indépendante (CENI) annonce les résultats officiels, le candidat du régime a choisi de proclamer sa victoire. Une manœuvre inhabituelle qui en dit long sur le climat politique tendu de la Mauritanie, où la volonté de verrouiller la succession semble faire partie d’une stratégie bien orchestrée.
Les résultats, publiés quelques jours plus tard, ont confirmé la position de Ghazouani, mais ont également révélé une opposition déterminée. Biram Dah Abeid, militant anti-esclavagiste, et Sidi Mohamed Ould Boubacar, ancien Premier ministre, ont respectivement obtenu 18,59 % et 17,87 % des voix. Leur score a témoigné d’un désir de changement au sein de l’électorat mauritanien, mais également d’une fracture persistante entre le pouvoir en place et une opposition qui contestait la transparence du scrutin.
Les tensions ont rapidement débordé dans les rues. Des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes, opposant les partisans du régime et ceux de l’opposition. Les autorités ont réagi avec fermeté, procédant à l’arrestation d’une centaine d’étrangers accusés de s’être mêlés aux troubles. Cette réponse musclée a soulevé des inquiétudes quant à la gestion de la sécurité et à la tolérance des voix dissidentes. Les ambassades de pays voisins, tels que le Sénégal, le Mali et la Gambie, ont été mises en demeure de rappeler leurs ressortissants à l’ordre, illustrant ainsi la gravité des tensions qui secouent le pays.
Cette élection présidentielle de 2019 en Mauritanie représente un tournant significatif dans l’histoire politique du pays. Elle est le reflet d’un peuple qui aspire à un changement et à une gouvernance plus démocratique, mais elle met également en lumière les défis qui subsistent dans la quête d’une véritable stabilité politique. Alors que les acteurs politiques s’affrontent sur fond de contestation, la Mauritanie se trouve à un carrefour, avec l’espoir d’une transition pacifique mais le spectre de la violence et de la répression est toujours présent.
A suivre…
Ahmed OULD BETTAR
Un militaire à la conquête du pouvoir civil: une gouvernance en mutation lente