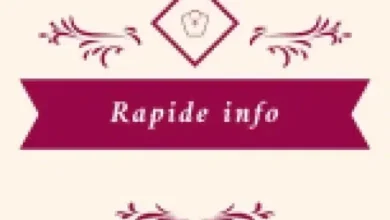Silence présidentiel en Mauritanie : un mutisme stratégique ou un refus de dialogue ?
Le silence des autorités mauritaniennes est-il une stratégie ou un aveu d’échec en matière de communication politique ? Cet article explore le mutisme du président Ghazouani et de son gouvernement, dans une démocratie où l'absence de dialogue alimente les frustrations.

Silence présidentiel en Mauritanie
Dans une Mauritanie où les micros restent souvent muets, le silence des plus hautes autorités intrigue autant qu’il inquiète. Entre mutisme présidentiel et discrétion gouvernementale, la communication politique semble reléguée au second plan, laissant place aux spéculations, frustrations et à un déficit criant de dialogue avec la population. Ce texte explore avec ironie et gravité les conséquences d’un pouvoir qui, à force de se taire, devient presque invisible.
Silence, on gouverne, et surtout, on ne se mouille pas ! Ah, la Mauritanie, cette terre de paradoxes où le président, cette figure si solennelle, se plaît à parler avec les chinois pas avec les « peshmergas ». Un jour, il parle, mais surtout, il ne dit rien. Un art subtil, une discipline olympique : le silence présidentiel en Mauritanie. On pourrait presque penser que Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani a élevé la pratique du mutisme en une forme d’art raffiné, entre le haïku politique et la chorégraphie de cabinet. Pas un mot de trop, ni une déclaration qui pourrait heurter la sensibilité de ses conseillers, ceux qui, eux, jonglent avec les micros comme des artistes de cirque.
Quant au Premier ministre, c’est une énigme à lui seul. Un vrai ninja de la parole, un hologramme programmé pour réciter les communiqués sans jamais sortir du cadre — une apparition aussi rare qu’un caméléon à Dakar. À force, on se demande s’il existe vraiment ou s’il n’est qu’un mirage, une projection dans le désert de la communication officielle.
Mais pourquoi ce silence radio ? Plusieurs théories circulent : une méfiance ancestrale envers des médias locaux jugés trop bruyants ou trop critiques (ou les deux, soyons honnêtes), un amour fou pour les discours solennels qui ne laissent pas de place à l’imprévu, ou encore une peur viscérale de ces fichus micros qui pourraient, un jour, révéler la vérité. La réalité, c’est que nos médias, entre autocensure, sous-financement et pressions invisibles, ne sont pas au sommet de leur forme olympique. Pourtant, dialoguer avec la presse, c’est dialoguer avec le peuple — même si cela pique un peu, parfois.
Dans cette démocratie à géométrie variable, le silence ne vaut pas or. Il engendre rumeurs, frustration et interrogations. Les Mauritaniens se demandent, tout simplement : « Pourquoi ils ne nous parlent pas ? » Alors que le président gère des milliards, rencontre des chefs d’État, promet des réformes sociales, il préfère faire la sourde oreille. Une stratégie qui, avouons-le, n’est pas très efficace. La radio, la télé et la presse écrite existent, mais elles semblent avoir décidé de faire la grève de l’interview.
Et si, juste un tout petit peu, on se décidait à changer la donne ? Imaginez une conférence de presse tous les deux mois, un passage télé national, une poignée de questions posées par des journalistes locaux, un peu de dialogue, un peu d’écoute. La démocratie, ce n’est pas un truc dangereux, c’est même une nécessité. La parole partagée, c’est la clé pour construire un avenir commun, pas un secret d’État.
Alors, messieurs les dirigeants, un petit mot au peuple, de temps en temps ? Pas pour vous demander votre recette secrète de tajine, hein ! Juste pour nous parler de l’avenir. Parce qu’au fond, le silence ne rend pas les politiques plus solides, il les rend invisibles. Et dans ce désert mauritanien, un peu de lumière, ça ne ferait pas de mal.
Qui sait, un jour peut-être, l’interview tant rêvée sera là, quelque part entre le Journal Télévisé du 20h et le dernier épisode de « Game of Thrones », version saharienne. En attendant, le public reste là, à attendre, à espérer que la parole, un jour, redeviendra d’or dans cette terre de silence.
Rapide info