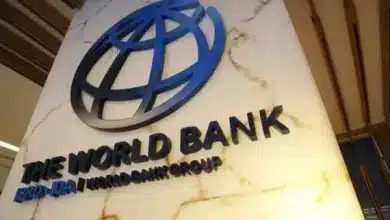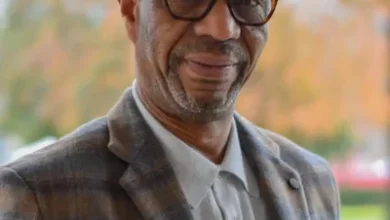Séparation entre l’armée et la politique : l’initiative de Biram Ould Dah face à un héritage militaire persistant
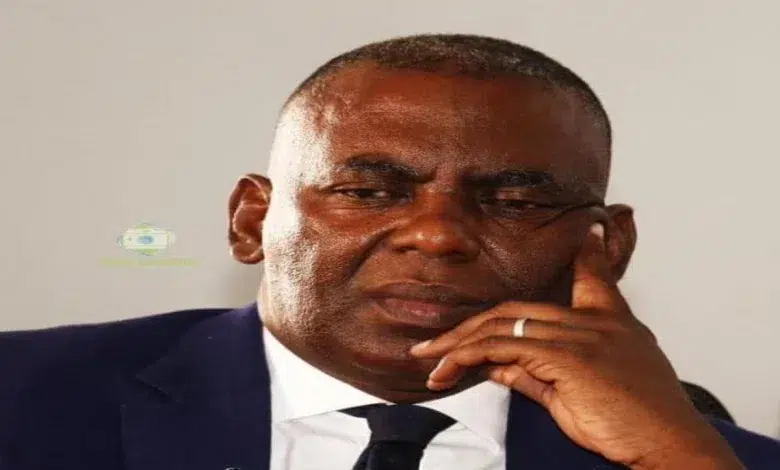
Biram Ould Dah a récemment formulé une proposition significative, qui n’a malheureusement pas suscité une attention suffisante. Selon cette initiative, il serait interdit aux officiers de l’armée de se présenter aux élections pendant une période de cinq ans après leur départ à la retraite. Cette suggestion soulève plusieurs points qui méritent d’être analysés sous différents angles.
D’un côté, cette proposition peut être vue comme un pas vers la séparation des sphères militaire et politique, un objectif fondamental pour garantir une démocratie plus équilibrée.
En interdisant aux anciens militaires de se présenter aux élections pendant cinq ans après leur retraite, la mesure pourrait réduire l’influence des anciens officiers sur les processus politiques, limitant ainsi les risques de dérives autoritaires ou d’ingérence militaire dans la politique nationale. Par ailleurs, une telle initiative pourrait également permettre de renforcer la stabilité politique en empêchant la concentration du pouvoir entre les mains de quelques acteurs militaires. En effet, en limitant l’accès des militaires retraités à des fonctions politiques, on favoriserait une plus grande diversité de profils au sein des institutions nationales, renforçant ainsi la légitimité démocratique.
Cette approche trouve un écho dans l’histoire politique de plusieurs pays, notamment la France sous la Troisième République, où les militaires, issus souvent des plus hautes sphères de l’armée, occupaient fréquemment des postes de responsabilité au sein des institutions civiles. Par exemple, le général Georges Boulanger, après avoir pris sa retraite, devint une figure politique majeure en France, menant des mouvements nationalistes qui faillirent déstabiliser le pays à la fin du XIXe siècle. De plus, des officiers de haut rang ont souvent occupé des fonctions ministérielles, parlementaires, voire des postes de gouverneurs et de préfets.
Le général Joseph Joffre, après avoir dirigé l’armée française pendant la Première Guerre mondiale et remporté une victoire clé à la bataille de la Marne, le général Joffre fut nommé gouverneur militaire de Paris. Bien que ce poste soit principalement militaire, il eut un rôle prépondérant dans l’organisation de la défense nationale et, par extension, dans la gestion du pays pendant une période de crise majeure. Par la suite, il poursuivit une carrière politique en tant que sénateur. Dans certains cas, cette présence militaire dans la sphère politique pouvait conduire à une confusion des rôles et à une centralisation excessive du pouvoir, exacerbant les risques de coups d’État ou d’influence indue sur les politiques publiques.
Cependant, cette mesure n’est pas sans controverses. D’un côté, certains pourraient la percevoir comme une restriction injustifiée de la liberté individuelle des militaires retraités, qui, après une carrière dans l’armée, souhaiteraient s’engager politiquement, selon leur expérience et leur expertise. En outre, il est important de souligner que l’institution militaire, tout comme l’institution civile, est composée de personnalités qui, bien que formées dans des contextes différents, peuvent disposer de compétences variées.
Nombre d’officiers sont aujourd’hui diplômés en politique, diplomatie ou gestion, et leur expertise peut être tout à fait pertinente dans des postes politiques. Dès lors, la simple appartenance à l’armée ne doit pas les priver de la possibilité d’exercer une fonction publique, sous prétexte de leur parcours militaire passé. Ainsi, la question centrale demeure : jusqu’où peut-on limiter l’accès à la politique pour des individus qualifiés, au seul prétexte de leur statut militaire passé ?
Il est également intéressant de noter qu’en 2009, le parlement mauritanien, dans ses deux chambres, avait voté une loi qui autorisait les officiers à exercer des fonctions politiques, diplomatiques et administratives. Cette loi avait été adoptée dans un climat marqué par un large consensus, avec des partis de toutes obédiences confondues qui avaient voté en faveur de son adoption. Toutefois, cette décision avait été prise dans un contexte où les débats se tenaient dans un silence relatif et sans véritables oppositions publiques, ce qui a alimenté une certaine incompréhension et méfiance quant à l’influence militaire sur les décisions politiques et institutionnelles du pays.
En outre, il est à noter que cette loi de 2009 a permis une plus grande présence des militaires dans les institutions civiles, un phénomène qui peut être perçu comme une continuation de l’ère où les militaires occupaient des fonctions de gouvernance, souvent en raison de leur formation et de leur expérience.
La question de la séparation entre la sphère militaire et la sphère politique reste donc complexe.
Bien que cette nouvelle initiative de Biram Ould Dah représente un progrès vers la réduction de l’influence militaire dans la politique, sa mise en œuvre et ses implications pratiques nécessitent une réflexion plus approfondie.
Il ne s’agit pas seulement de définir des limites strictes, mais de trouver un équilibre où les compétences des anciens militaires peuvent être valorisées sans pour autant qu’elles ne portent atteinte à la nécessaire séparation des pouvoirs dans une démocratie moderne. Ainsi, la question fondamentale demeure : comment permettre à l’institution militaire de conserver son rôle essentiel de défense, tout en préservant la primauté de la politique civile et démocratique ?
Ahmed Ould Bettar