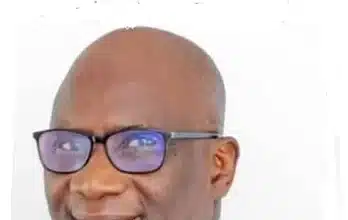« Relance Sahel » et réforme éducative : une ambition régionale à l’épreuve des réalités structurelles
Lancée à Nouakchott, l’initiative « Relance Sahel » vise une réforme éducative régionale ambitieuse. Entre intentions louables et défis structurels, une analyse critique s’impose pour évaluer sa portée réelle sur les populations marginalisées comme les CDWD.

Le projet « Relance Sahel », lancé conjointement par la Mauritanie et le Tchad avec le soutien de la Banque mondiale et de la coopération allemande, ambitionne de transformer l’éducation dans une région marquée par l’exclusion scolaire et les inégalités. Mais derrière cette dynamique institutionnelle, des doutes subsistent quant à la réelle inclusion des populations marginalisées, la soutenabilité des financements, et la capacité des États à garantir une souveraineté éducative. Analyse.
Par Cheikh Sidati Hamadi, Expert senior en droits des CDWD, Chercheur Associé, Analyste et Essayiste.
Ce 22 juillet 2025 à Nouakchott, les gouvernements Mauritanien et Tchadien ont officiellement lancé le projet régional « Relance Sahel », un programme ambitieux soutenu par la Banque mondiale, la coopération allemande et d’autres partenaires internationaux. Il prévoit notamment la création d’un Institut éducatif du Sahel et le déploiement d’une stratégie dite d’« école ouverte », censée répondre aux défis de l’exclusion scolaire, de la précarité éducative et de l’inégalité d’accès dans une région fortement fragilisée par l’insécurité, la pauvreté et les discriminations structurelles.
Ce programme s’inscrit dans le cadre des Objectifs de Développement Durable, en particulier l’ODD 4 (éducation inclusive, équitable et de qualité), l’ODD 5 (égalité entre les sexes), l’ODD 10 (réduction des inégalités) et l’ODD 17 (partenariats mondiaux efficaces). Mais derrière les intentions affichées, des zones d’ombre demeurent : absence de ciblage explicite des populations historiquement exclues comme les communautés discriminées sur la base du travail et de l’ascendance (CDWD), dépendance accrue aux financements externes, imprécisions dans la gouvernance des dispositifs proposés. Une lecture critique de cette relance éducative sahélienne permet d’en interroger les ambitions, d’en délimiter les risques et d’en dégager les conditions d’un véritable changement structurel.
Une vision ambitieuse mais encore floue
L’Institut éducatif du Sahel prévoit de répondre à quatre grandes missions : la formation du personnel éducatif, la formation des formateurs, la recherche sur les réformes éducatives et la facilitation du travail en commun entre pays sahéliens. La validation du plan stratégique en 2024, l’accord de siège approuvé le 22 juillet 2025, et le démarrage prévu au second semestre 2025 témoignent d’une certaine avancée institutionnelle.
Cependant, aucune précision budgétaire ni détail sur les partenaires techniques et financiers n’est clairement rendu public pour cet institut spécifique. Le flou demeure, alors même que les besoins sont massifs. Le projet régional « Relance Sahel », officiellement lancé à Nouakchott, apporte un éclairage partiel : il prévoit 137 millions de dollars de financement, dont 72,32 millions pour la Mauritanie (avec un prêt concessionnel de 44 millions USD par l’IDA, Banque mondiale et 12,9 millions USD de subvention allemande).
Cela illustre bien la dépendance de la stratégie régionale à l’aide extérieure. Or, comme souvent, ces financements sont assortis de conditions structurelles pouvant induire des réformes imposées, à l’instar de la contractualisation du personnel éducatif ou d’une privatisation rampante des services publics. L’appui allemand, via une coopération bilatérale de 56 millions USD, reste mieux perçu car moins contraignant politiquement. Il est cependant essentiel de garantir la souveraineté éducative des États bénéficiaires et de ne pas céder aux injonctions standardisées souvent déconnectées des réalités locales.
L’école ouverte : solution complémentaire ou palliatif précarisant ?
La composante dite « école ouverte », désormais intégrée au projet régional élargi, entend offrir une alternative flexible aux jeunes exclus du système éducatif classique via l’enseignement à distance, les CLOM, l’alphabétisation accélérée ou les tutorats numériques. Le projet vise 850 000 jeunes, dont 50 % de filles, ainsi que des populations nomades et réfugiées. Les objectifs sont répartis ainsi
400 000 pour l’alphabétisation primaire
130 000 pour l’éducation accélérée
40 000 pour le rattrapage secondaire
230 000 pour la formation technique et professionnelle
Mais à quels moyens réels ces ambitions sont-elles adossées ? Dans les zones rurales du Sahel, la connectivité Internet reste inférieure à 25 % selon l’UIT (2023), et l’accès à l’électricité demeure problématique, où près de 60 % des écoles ne sont pas électrifiées.
Par ailleurs, la certification des acquis, l’harmonisation des curriculums et l’inclusion linguistique (langues locales ou nationales) ne sont pas garanties. Sans un dispositif rigoureux de suivi-évaluation et une coordination efficace entre pays, l’école ouverte pourrait se muer en dispositif low-cost, réservé aux plus pauvres, légitimant de fait l’abandon progressif des structures éducatives traditionnelles.
Les oubliés du système : où sont les CDWD ?
Le texte officiel du projet « Relance du Sahel » met l’accent sur les jeunes « marginalisés », sans jamais définir clairement cette catégorie. Les communautés discriminées sur la base du travail et de l’ascendance (CDWD), historiquement exclues du système scolaire, restent invisibles dans la formulation stratégique.
En Mauritanie, les enfants issus de ces communautés continuent de faire face à un accès limité à l’éducation secondaire, à des discriminations dans les écoles urbaines, et à une quasi-absence d’établissements dans les zones périphériques où ils vivent. Selon l’UNESCO (2022), près de 60 % des enfants issus de groupes marginalisés au Sahel quittent l’école avant 12 ans. Sans action corrective ciblée, l’Institut éducatif du Sahel risque de reproduire ces inégalités au lieu de les corriger.
Recommandations pour une transformation inclusive et durable
Avant d’ouvrir les locaux ou d’élargir les chiffres cibles, il est urgent d’intégrer les recommandations suivantes :
Conditionnalité des financements à l’équité éducative : chaque prêt ou subvention (BM, Allemagne, autres) doit intégrer des critères de ciblage explicite en faveur des CDWD, filles, enfants en situation de handicap.
Cartographie rigoureuse des besoins éducatifs : les données doivent être désagrégées par genre, origine sociale, statut social et géographique, afin d’identifier les zones critiques.
Suivi-évaluation indépendant : un organe multipartite (sociétés civiles, syndicats enseignants, chercheurs, les CDWD ) doit être associé à l’évaluation de la gouvernance de l’institut et de la qualité des écoles ouvertes.
Infrastructure numérique de qualité : connectivité, accès à l’électricité, équipements numériques, outils en langues locales, formation numérique des enseignants.
Formation inclusive des formateurs : les formateurs doivent être sensibilisés aux réalités spécifiques des CDWD, à la lutte contre les discriminations systémiques, aux approches interculturelles et inclusives.
Alignement ODD : veiller à l’articulation claire avec l’ODD 4 (éducation de qualité), l’ODD 5 (égalité entre les sexes), l’ODD 10 (réduction des inégalités) et l’ODD 17 (partenariats mondiaux), à travers des indicateurs mesurables et publics.
Conclusion
Le projet d’Institut éducatif du Sahel et la stratégie d’école ouverte constituent, en apparence, des instruments novateurs pour faire face aux défaillances structurelles de l’éducation dans la région. Mais leur réussite dépendra moins de leur rhétorique institutionnelle que de leur capacité à transformer les rapports de pouvoir éducatifs, à réduire les inégalités structurelles, et à garantir une éducation inclusive, équitable et durable. Sans un ancrage clair dans les réalités sociales, linguistiques, numériques et politiques du Sahel, ces initiatives risquent de n’être qu’un mirage de plus dans le désert éducatif.
——————————————————–
Références
Banque mondiale (2025). Mauritania and Chad Launch the Sahel Recovery Initiative.
🔗 https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2025/07/22/sahel-recovery-launch
UNESCO (2022). Global Education Monitoring Report – Sahel Regional Focus.
🔗 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380725
UIT – Union internationale des télécommunications (2023). Measuring Digital Development: Facts and Figures.
🔗 https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx
Ministère mauritanien de l’Économie (2025). Plan d’action du projet Relance du Sahel.
🔗 https://www.economie.gov.mr/relance-sahel
GIZ – Coopération allemande en Mauritanie (2024).
🔗 https://www.giz.de/en/worldwide/mauritania.html