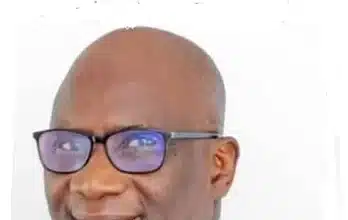Rapport 2022-2023 de la Cour des comptes mauritanienne : entre progrès, irrégularités et contexte de crise
Le rapport 2022-2023 de la Cour des comptes met en lumière des irrégularités dans plusieurs secteurs clés, mais aussi des progrès vers plus de transparence.

Le rapport annuel 2022-2023 de la Cour des comptes de Mauritanie dévoile des irrégularités dans les secteurs de l’éducation, des mines, de l’énergie et des infrastructures. Contrairement aux chiffres diffusés par certains médias, les montants en jeu s’élèvent à environ 113 milliards MRU – une somme essentiellement liée à la période Covid-19, dans un contexte d’urgence et de digitalisation encore inachevée de l’administration publique. La Cour insiste sur la nécessité d’un contrôle renforcé, d’une meilleure gouvernance et d’une modernisation du système financier public.
Mise au point chiffrée
Contrairement à certaines communications dans les médias et sur les blogs annonçant un montant de 410 milliards (MRU) de dysfonctionnements ou d’irrégularités, le rapport de la Cour fait état d’une somme d’environ 113 milliards MRU pour un compte spécifique de soutien au secteur des produits pétroliers raffinés. En effet, dans son chapitre consacré à ce « compte de soutien », la CdC note que « 85 % des dépenses enregistrées en 2022 n’avaient aucun lien avec l’objectif initial du compte », et chiffre la somme à 113 758 663 ouguiyas (soit environ 113 milliards MRU). (fr.madar.mr)
Il est utile de rappeler que ce montant essentiellement remonte à la période de la pandémie de COVID‑19, dans un contexte d’urgence, et que l’administration n’avait pas encore achevé sa digitalisation : des écritures comptables peuvent donc être manquantes ou erronées en raison de l’intervention rapide exigée par la crise. Cette nuance apparaît dans l’analyse globale et appelle à en tenir compte dans l’interprétation des constats de la Cour.
1. Éducation
Dans le secteur de l’éducation, le rapport de la CdC signale plusieurs types d’irrégularités.
- Le rapport note l’attribution de marchés par des entités non autorisées, la réalisation de marchés non enregistrés, ainsi que des retards dans les projets dirigés par la « Direction des projets d’éducation et de formation ». (fr.madar.mr)
- Il est mis en évidence que, malgré l’adoption d’une loi 2022 instaurant la gratuité et l’obligation scolaire pour les 6-15 ans, la mise en œuvre reste lente et marquée par des faiblesses dans le suivi budgétaire. (iiep.unesco.org)
- Le rapport appelle à améliorer la précision des prévisions budgétaires et à renforcer le contrôle interne dans les établissements scolaires, ainsi qu’à améliorer la reddition des comptes. (lauthentic.info)
- Une indication que l’augmentation des effectifs et des dépenses dans ce secteur (dans un contexte post-Covid) impose un suivi accru des ressources mobilisées.
Analyse
Le secteur de l’éducation reste donc marqué par des défis : la portée sociale des investissements est grande, mais le contrôle effectif de leur exécution est encore insuffisant. Le contexte d’urgence sanitaire et la pression démographique renforcent ces difficultés. En l’absence d’une administration entièrement digitalisée, certaines irrégularités sont à replacer dans un contexte de gestion d’urgence, sans toutefois les excuser.
2. Mines / Énergie
Ce secteur concentre une part significative des griefs relevés par la CdC.
- La Cour relève des « lacunes dans la conclusion des contrats d’exploration et d’exploitation dans le secteur des hydrocarbures ». (fr.madar.mr)
- Dans le cadre du compte dédié aux produits pétroliers raffinés, la Cour indique que 85 % des dépenses en 2022 ont été consacrées à des usages autres que l’objet du compte. (fr.madar.mr)
- Une faiblesse du recouvrement des redevances minières et un suivi insuffisant des obligations des opérateurs sont aussi mentionnés. (lauthentic.info)
- Sur les entreprises publiques, le rapport indique que dans le secteur mines/énergie, les fonds propres se concentraient massivement dans ce secteur (115 milliards MRU en 2022 pour les fonds propres des entreprises publiques, soit 78,2 % du total) : cela témoigne de l’importance du secteur mais aussi de la forte exposition aux risques.
Analyse
Le secteur des mines/énergie est stratégique pour la Mauritanie ; mais il est aussi celui où les failles de gouvernance apparaissent les plus fréquemment. L’urgence de mobiliser des recettes, la complexité des contrats internationaux, et l’absence d’une administration entièrement numérisée rendent le contrôle plus difficile. Dans ce contexte, certaines écritures peuvent manquer ou être erronées — ce ne dispense pas du contrôle mais incite à une interprétation nuancée : en situation d’urgence (Covid, fluctuations des prix, besoin de fonds rapides), les effets organisationnels se font sentir.
3. Infrastructures
Le rapport consacre une attention particulière à ce domaine, qui englobe routes, chantiers publics et grands travaux.
- Un exemple cité : le projet routier « Néma-Bassiknou-Fassala », où la Cour a pointé des retards injustifiés, des paiements à des entrepreneurs pour des travaux non exécutés et la non-application de pénalités de retard prévues par la loi. (Essada info)
- Le rapport dénonce également des marchés fractionnés, des ordres de service délivrés sans que les entreprises ne soient toutes conformes aux obligations légales, ainsi que des cas de travaux non réceptionnés correctement. (Mauriweb)
- La Cour appelle à renforcer la traçabilité des flux financiers liés aux infrastructures, à améliorer le suivi budgétaire dans le temps, et à veiller à ce que les pénalités contractuelles soient appliquées. (lauthentic.info)
Analyse
Le secteur des infrastructures est par nature exposé aux pressions : délais, importances financières, nécessité de résultats visibles. Ces caractéristiques peuvent favoriser des dysfonctionnements, surtout dans une administration qui n’est pas encore totalement digitalisée ou outillée pour un contrôle en temps réel. La gestion en « mode urgence », notamment liée aux effets de la pandémie (relance, fonds exceptionnels) peut expliquer un certain nombre d’écritures comptables manquantes ou erronées sans pour autant les justifier.
4. Secteur de l’énergie (spécifiquement)
Bien que lié au secteur mines/énergie déjà décrit, il convient de souligner quelques points propres à l’énergie « pure » : électricité, recouvrement, entreprises publiques.
- Le rapport mentionne que la Société mauritanienne d’électricité (SOMELEC) avait un taux de recouvrement des créances de seulement 53 % au premier semestre 2023, alors que l’objectif était de 95 %. (fr.madar.mr)
- Le rapport montre que la facturation, le suivi des abonnés et la comptabilité interne de certaines unités de l’énergie restent défaillants. (Mauriweb)
- Le rapport insiste sur la nécessité d’une meilleure gestion des grandes entreprises publiques du secteur, d’une traçabilité accrue des flux et d’un renforcement des contrôles internes.
Analyse
Dans un secteur comme l’énergie, où les coûts sont élevés et les enjeux nombreux (accès, subventions, recouvrements), les marges d’erreur sont plus grandes. Lorsque la digitalisation des processus de facturation, de comptabilité et de suivi n’est pas encore totalement réalisée, le risque d’erreurs, d’écritures manquantes ou d’imputations incorrectes s’accroît. Le contexte de pandémie et de crise énergétique mondiale peut avoir imposé des mesures d’urgence, ce qui doit être intégré dans l’interprétation du rapport.
Remarques transversales
- Le rapport de la CdC insiste sur l’importance de renforcer le contrôle interne, de digitaliser les administrations et d’améliorer la traçabilité des marchés et des dépenses publiques. (rapideinfo.mr)
- Le contexte de la pandémie de Covid-19 a profondément impacté les finances publiques : la rapidité des interventions, les fonds exceptionnels, les dispositifs de soutien aux populations ont créé des situations de gestion atypiques, où certaines écritures peuvent être manquantes, erronées ou tardives. Ces facteurs n’excusent pas les irrégularités mais les contextualisent.
- Beaucoup des irrégularités relevées concernent non seulement des fautes de bonne gestion mais aussi des lacunes institutionnelles : absence d’alerte, suivi insuffisant, manque de sanctions concrètes — ce qui, à terme, fragilise la confiance dans l’appareil de l’État. (Mauriweb)
- Le cadrage du montant (113 milliards) plutôt que 410 milliards permet de recentrer le débat sur les faits précis et sur les secteurs concernés, tout en ouvrant à une réflexion sur l’ampleur réelle des lacunes versus les perceptions médiatiques.
Conclusion
Le rapport 2022-2023 de la Cour des comptes de Mauritanie dresse un tableau globalement préoccupant : des secteurs clés (éducation, mines/énergie, infrastructures) présentent des faiblesses significatives en matière de gestion, de contrôle et de reddition des comptes. Toutefois, il importe de nuancer certains constats : le montant d’irrégularités mentionné dans un cas précis est d’environ 113 milliards MRU, et un bon nombre de dysfonctionnements s’expliquent — sans être justifiés — par le contexte de crise (Covid-19), l’urgence des interventions et une digitalisation de l’administration encore inachevée.
Pour avancer, il sera essentiel que les recommandations de la CdC soient mises en œuvre (renforcement des contrôles, sanctions effectives, digitalisation, transparence) et que la gestion d’urgence devienne progressivement une gestion normale, avec toutes les garanties institutionnelles et comptables attendues.
Rapide info
Source principale : Rapport officiel de la Cour des comptes (exercices 2022-2023)