Rapport Cour des comptes : quand le miroir de l’État révèle les fissures de la gouvernance publique mauritanienne
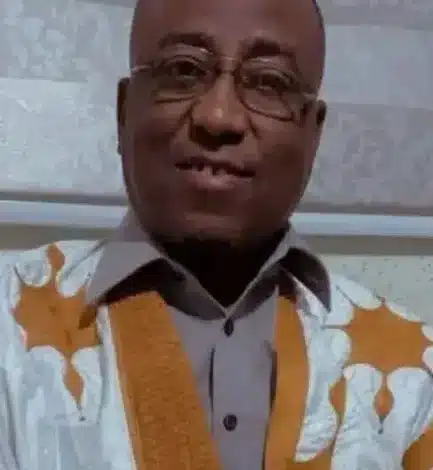
Rapport Cour des comptes
Par Cheikh Sidati Hamady
Expert Senior en Droits des CDWD , Chercheur associé, Analyste , Essayiste
Le 8 octobre 2025, le Président de la Cour des comptes, M. Hemid Ould Ahmed Taleb, a remis au Chef de l’État le rapport général annuel 2022-2023. Ce geste, apparemment cérémoniel, dissimule une alerte majeure pour la gouvernance nationale : la Cour révèle un appareil d’État où la corruption, l’inefficacité et l’impunité sont devenues structurelles, fragilisant le principe même de reddition de comptes. Chaque chapitre du rapport dissèque des pratiques illégales systématiques, des dépenses opaques aux contrats publics biaisés, et expose une administration incapable de contrôler ni ses ressources ni ses agents.
Ce document, d’une précision inédite, ne se limite pas à pointer des irrégularités comptables : il met en lumière l’échec de la Mauritanie à respecter les standards internationaux de bonne gouvernance, tels que définis par l’Agenda 2030. Les ODD 16 et 17, qui visent respectivement à construire des institutions efficaces, responsables et transparentes, et à renforcer les partenariats pour le développement, apparaissent ici en miroir inversé : loin d’être atteints, ils sont contournés ou ignorés, avec des conséquences directes sur la légitimité morale et institutionnelle de l’État et sur la confiance des citoyens et des partenaires internationaux. Plus qu’un bilan financier, ce rapport est un réquisitoire cinglant contre la dérive morale et structurelle de l’État mauritanien, et un signal clair : si la corruption systémique n’est pas contenue, elle menace d’éroder durablement les fondements mêmes d’une gouvernance responsable et des engagements internationaux du pays.
I. Un miroir tendu à la République
Dans une République où l’article 68 de la Constitution confie à la Cour des comptes la mission de veiller à la gestion saine des finances publiques, le rapport général annuel 2022-2023 s’impose comme un document d’alerte nationale. Sous la présidence de Hemid Ould Ahmed Taleb, la Cour assume le rôle que lui confère la loi organique n°2018-032 du 20 juillet 2018 : juger les comptes, évaluer la gestion et conseiller l’État.
Mais ce rapport va au-delà de la reddition technique. Il dévoile une crise morale de la gouvernance : l’administration publique dépense, recrute, signe des contrats, mobilise des fonds extérieurs, souvent hors cadre légal, sans se soucier de la traçabilité, ni du principe de responsabilité. La Mauritanie s’y découvre dans son miroir administratif le plus cru : un État qui a multiplié les textes de transparence, sans jamais en faire une culture.
II. Les chiffres d’un désordre organisé
En 2022, les recettes réalisées ont atteint 88,5 milliards MRU (91,4 % des prévisions), tandis que les dépenses exécutées s’élevaient à 100,7 milliards MRU (87,3 %). Le déficit global, de 12,27 milliards MRU, paraît maîtrisé. Mais la Cour révèle un détournement structurel de la transparence budgétaire : près de 10 milliards MRU de dépenses financées par des bailleurs extérieurs et 5,8 milliards MRU de recettes correspondantes n’ont pas été inscrits dans le Compte général de l’administration des finances (CGAF).
Cette omission viole le principe d’unité et d’universalité budgétaire, socle de la gestion publique moderne. La Cour note aussi l’existence de comptes parallèles, dépenses non justifiées et recettes non recouvrées, révélant un État budgétairement schizophrène : rigoureux dans les textes, mais opaque dans la pratique.
À cela s’ajoute la sous-évaluation chronique des recettes non fiscales, notamment celles issues des secteurs minier et halieutique, qui entretient un système où l’opacité financière profite aux initiés et fragilise les marges budgétaires nationales.
III. Les ministères : foyers d’irrégularités, d’arbitraire et de corruption
institutionnalisée
Le rapport 2022-2023 consacre plus de 240 pages aux contrôles des ministères, avec un constat implacable : près de 68 % des entités vérifiées présentent des irrégularités majeures de gestion. Ce chiffre résume à lui seul la gravité du problème : la corruption n’est plus marginale, elle est systémique.
Au Ministère du Pétrole, des Mines et de l’Énergie, la Cour constate que plus de 1,2 milliard MRU de dépenses n’ont pas été justifiées selon les normes comptables. Les redevances minières dues par certaines sociétés étrangères n’ont pas été recouvrées, représentant un manque à gagner estimé à 2,7 milliards MRU. Des contrats d’exploration ont été attribués sans appel d’offres, en violation du Décret n°2021-128 sur les marchés publics, et plusieurs conventions minières n’ont pas été soumises à l’avis du ministère des Finances comme l’exige la réglementation. La Cour note également que le Fonds de formation du secteur extractif, prévu par la loi, n’a pas été activé depuis 2019, privant le pays d’un mécanisme de montée en compétence pourtant stratégique.
Le Ministère de la Santé illustre, à lui seul, le naufrage du contrôle interne. Selon le rapport, plus de 800 millions MRU de dépenses n’ont pas été appuyées par des pièces justificatives conformes. La gestion du Programme PROPEP a été marquée par des achats directs, sans appel à concurrence, pour un montant supérieur à 300 millions MRU, notamment le contrat passé avec ROCHE, dont la Cour souligne l’absence de preuve de livraison complète. Le stock de médicaments essentiels présente des écarts physiques évalués à plus de 25 % des volumes achetés, témoignant d’un risque réel de détournement ou de péremption non comptabilisée.
Le Ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, de son côté, a ouvert un compte illégal au Trésor, numéro 430301047, pour le programme « Mihnati », en dehors de tout cadre réglementaire (violation de l’article 178 du Décret 186-2019). Le rapport chiffre à 121 millions MRU les montants transités sur ce compte sans ordonnancement préalable. La Cour relève aussi des recrutements non autorisés, des prêts sans garantie et des dépenses non justifiées liées à l’organisation de la CAN U-20 (2021). Ces pratiques, loin d’être anecdotiques, trahissent un mode opératoire : détourner le cadre budgétaire en créant des zones d’ombre où l’État devient son propre hors-la-loi.
Dans ces trois ministères, le rapport met en évidence une faible traçabilité, une absence de suivi des recommandations antérieures et une culture de l’impunité : aucune sanction administrative ou judiciaire n’a été prise malgré les constats répétés. Les ODD 16 et 17, qui visent respectivement à construire des institutions efficaces, responsables et transparentes, et à renforcer les partenariats pour le développement, apparaissent ici en miroir inversé : loin d’être atteints, ils sont contournés ou ignorés, avec des conséquences directes sur la légitimité morale et institutionnelle de l’État et sur la confiance des citoyens et des partenaires internationaux.
IV. Entreprises publiques : le gouffre de la rente
La Cour évalue les entreprises publiques comme un foyer de pertes cumulées et d’inefficience chronique. Parmi les 27 entités auditées, 21 affichent un résultat net négatif et 14 ne tiennent pas de comptabilité conforme.
SOMELEC enregistre des pertes cumulées de 1,8 milliard MRU, une facturation estimative sur 40 % des clients et plus de 2 milliards MRU d’arriérés envers le Trésor et les sociétés partenaires. La CNAM présente un déficit comptable de 630 millions MRU, une absence de base de données fiable et des recrutements irréguliers ayant généré une masse salariale supplémentaire de 126 millions MRU sans autorisation. Mauritania Airlines cumule une dette fiscale de plus de 1,2 milliard MRU, une absence d’audit externe depuis 2019 et des dépenses non justifiées liées à la maintenance des aéronefs pour un montant de 450 millions MRU. Le Fonds Covid-19, enfin, a affecté illégalement près de 300 millions MRU à des activités étrangères à son objet initial.
Ces chiffres traduisent un dysfonctionnement systémique : aucune entreprise publique n’a produit d’états financiers certifiés pour l’exercice 2022. Le contrôle interne est quasi inexistant et le suivi ministériel nominal. Cette situation viole directement les principes de redevabilité et d’efficacité des dépenses publiques au cœur de l’ODD 16, et montre l’absence de coordination institutionnelle évoquée dans l’ODD 17, où la transparence financière devrait être le socle des partenariats avec les bailleurs.
V. Le grand vide : l’absence de reddition et de sanction
Le rapport constate que seulement 7 % des irrégularités signalées lors du précédent exercice (2020-2021) ont fait l’objet d’un début de régularisation. Aucune poursuite judiciaire n’a été engagée pour les 24 cas de gestion de fait identifiés par la Cour. Les ministères concernés répondent, au mieux, par des lettres d’intention ou des engagements non suivis d’effet. Le Parlement, pourtant destinataire légal du rapport (article 67 de la loi organique), n’a organisé aucune séance de débat ni mis en place de commission d’enquête budgétaire depuis 2019.
Ce vide institutionnel crée un effet pervers : la transparence devient une façade, un rituel sans conséquence. Le contrôle parlementaire, pilier des institutions inclusives (ODD 16), s’efface devant la logique de connivence administrative. Quant à la coopération entre la Cour, le ministère des Finances et le Parlement, censée incarner l’ODD 17 sur le partenariat pour le développement, elle se réduit à un échange protocolaire sans contenu opérationnel.
En définitive, l’impunité n’est plus une défaillance, mais un mode de gouvernance. La reddition des comptes se vide de son sens, et la Cour des comptes, institution indépendante par texte, devient isolée dans la pratique, incapable de transformer ses constats en action corrective.
VI. Pour une refondation du contrôle public
La Cour des comptes a tiré la sonnette d’alarme. Reste à savoir si l’État saura écouter. Trois réformes s’imposent pour rompre avec l’impunité : accroître le pouvoir coercitif de la Cour afin qu’elle puisse saisir directement la justice en cas de faute grave ; rendre obligatoire le suivi parlementaire des recommandations, avec publication d’un rapport annuel sur leur mise en œuvre ; et institutionnaliser la certification indépendante des comptes publics, prévue pour 2026, en garantissant la traçabilité de toutes les dépenses.
À ces leviers techniques doit s’ajouter une révolution morale : réintroduire dans l’administration publique une culture de l’éthique budgétaire, où dépenser l’argent public sans justification serait perçu comme un délit, non comme une habitude.
Un cri institutionnel
Le rapport 2022-2023 de la Cour des comptes n’est pas un simple document de gestion, c’est un réquisitoire impitoyable contre un système public gangrené par la corruption, l’impunité et le mépris des règles. Les ministères et entreprises publiques auditées accumulent plusieurs dizaines de milliards de MRU de pertes et de malversations, révélant un État incapable de contrôler ses propres agents et détourné de sa mission première : servir l’intérêt public.
Chaque chiffre, chaque irrégularité dénoncée par la Cour témoigne d’une culture administrative perverse où la transparence est ridiculisée et où la loi devient un obstacle à contourner plutôt qu’un garde-fou. Les responsables politiques et administratifs, censés garantir l’intégrité des finances publiques, ferment les yeux ou se cachent derrière des promesses creuses. L’inaction du Parlement, l’absence de sanctions et le silence complice des institutions créent un climat où l’arbitraire et l’enrichissement personnel s’institutionnalisent.
La Mauritanie, à travers ces pratiques, se détourne des standards internationaux qu’elle a librement adoptés. Les ODD 16 et 17, censés promouvoir des institutions responsables, transparentes et efficaces et renforcer les partenariats pour le développement, sont piétinés avec un cynisme effarant. L’État ne se contente plus d’être laxiste, il devient le vecteur principal de sa propre corruption.
Un miroir, même brisé, renvoie la vérité. La question n’est plus technique : l’État mauritanien aura-t-il le courage de se regarder en face, de mesurer l’ampleur du désastre et de prendre enfin des mesures concrètes pour rétablir l’honneur, la transparence et la responsabilité dans ses institutions, ou continuera-t-il à laisser proliférer un système où l’impunité et la prédation sont devenues la norme ?
Références
Cour des comptes (Mauritanie) – Rapport général annuel 2022-2023, juillet 2025.
Loi organique n°2018-032 du 20 juillet 2018, relative à la Cour des comptes.
Constitution mauritanienne (article 68) – sur le contrôle des finances publiques.
Décret n°2021-128 du 29 juillet 2021, portant Code des marchés publics.
Loi n°2000-045 du 26 juillet 2000, portant Code de l’environnement.
Déclaration de Lima (INTOSAI, 1977) – sur l’indépendance des institutions supérieures de contrôle.
Nations Unies – Agenda 2030 : Objectifs de Développement Durable (ODD 16 et 17), 2015.




