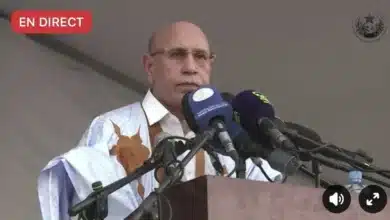Pourquoi les Haratine refusent de s’identifier aux maîtres
Un héritage trop lourd pour être effacé, Pourquoi ?

Pourquoi les Haratine refusent de s’identifier aux maîtres
Un héritage trop lourd pour être effacé.
Pendant des siècles, les Haratine ont été réduits à un statut servile au service des tribus beydanes. Leur condition sociale a été façonnée par la dépendance et la subordination. Dans un tel système, s’assimiler aux maîtres aurait signifié accepter une hiérarchie profondément inégalitaire. Le refus de se fondre dans l’ethnie dominante est donc un acte symbolique de rupture avec cet héritage de domination.
Le déni de dignité et de citoyenneté
Même après l’abolition officielle de l’esclavage (1981) et sa criminalisation (2007), les Haratine continuent d’être marginalisés :
• exclus des postes de responsabilité,
• limités dans l’accès à la terre et aux ressources,
• enfermés dans des stéréotypes d’infériorité et de dépendance.
Se dissoudre dans l’ethnie des maîtres reviendrait à accepter un système qui n’a jamais reconnu leur égalité réelle.
Une identité forgée dans la douleur et la lutte
Comme les Afro-Américains aux États-Unis, les Haratine portent une mémoire collective distincte, façonnée par l’expérience de la servitude et de la libération progressive. De cette mémoire est née une conscience politique : celle d’une communauté opprimée qui doit s’affirmer par elle-même et non à travers ses anciens maîtres.
L’instrumentalisation politique des maîtres
Les élites beydanes ont souvent instrumentalisé la question haratine :
• en refusant de reconnaître leur autonomie politique,
• en tentant de les diluer dans une arabité abstraite,
• en entretenant des alliances clientélistes pour perpétuer la dépendance.
Le refus de s’y fondre est une manière de dénoncer cette instrumentalisation et d’affirmer une autonomie politique légitime.
La quête de dignité et de reconnaissance
Les Haratine aspirent à être reconnus comme une composante spécifique de la nation mauritanienne, avec une mémoire et des revendications propres. Cela ne signifie pas un rejet de l’unité nationale, mais un refus de l’effacement identitaire. Leur affirmation de soi est un acte de libération et de justice.
• Amílcar Cabral : « Revendiquer notre identité, c’est refuser de disparaître. »
• Nelson Mandela : « La liberté n’est pas seulement l’absence de chaînes, mais le droit de vivre dans le respect de sa dignité. »
• Messaoud Ould Boulkheir : « Les Haratine ne sont ni des esclaves d’hier, ni des maîtres de demain, mais des citoyens à part entière. »
Le droit universel d’affirmer son identité
Affirmer son identité n’est pas un privilège, mais un droit universel inscrit dans l’histoire et le droit international. Nul État, nulle majorité dominante ne peut imposer une identité contre la volonté d’un groupe.
Dans le monde, les Afro-Américains, les Noirs sud-africains ou les écrivains de la Négritude ont montré que l’égalité commence toujours par l’affirmation de soi. La Déclaration de l’ONU sur les droits des peuples autochtones (2007) et l’UNESCO rappellent que la diversité culturelle et linguistique est un patrimoine commun à protéger.
Une résonance particulière en Mauritanie
Depuis l’indépendance, l’État mauritanien a tenté d’imposer une identité unique, au détriment de la pluralité réelle du pays :
• Les Haratine, héritiers d’une histoire douloureuse, revendiquent le droit de s’affirmer comme une composante spécifique de la nation. Refuser cette auto-identification, c’est prolonger l’assignation à l’invisibilité.
• Les communautés négro-mauritaniennes (Pulaar, Soninké, Wolof) ont elles aussi été victimes d’une arabisation forcée niant leurs langues et leur culture. En 1966, les lycéens noirs protestaient déjà contre l’imposition exclusive de l’arabe dans l’enseignement. En 1989, la crise dite « des événements » révéla une identité nationale fragile, construite sur l’exclusion.
• Même dans les symboles de l’État — hymne, drapeau, billets de banque —, l’effacement de la diversité est manifeste. Une partie du peuple n’y reconnaît ni son histoire ni ses visages.
Identité et République : une question de survie nationale
La République se renforce lorsque chaque citoyen peut dire librement : « Voilà qui je suis », sans craindre la stigmatisation ni le silence imposé. Amílcar Cabral rappelait : « Il n’y a pas de révolution sans culture. » De même, il n’y aura pas de Mauritanie républicaine solide sans reconnaissance et respect des identités réelles qui la composent.
Les Noirs américains n’ont pas affirmé leur différence par rejet gratuit, mais parce qu’ils étaient niés comme égaux. Leur identité fut une stratégie de survie et de dignité. Comme le disait Malcolm X : « Nous ne pouvons pas penser à l’intégration tant que nous ne nous sommes pas d’abord respectés nous-mêmes. »
Conclusion : l’affirmation comme condition de justice
Si les Haratine refusent de se fondre dans l’ethnie des maîtres, c’est parce qu’ils savent qu’il n’y a pas d’égalité sans reconnaissance de leur singularité. Accepter l’assimilation, ce serait accepter de voir leur histoire et leur lutte niées.
L’affirmation haratine n’est pas un facteur de division, mais une condition de dignité, de justice et de démocratie. Une nation ne se construit pas en imposant l’uniformité, mais en garantissant à chacun la liberté d’être soi….wetov
Sy Mamadou