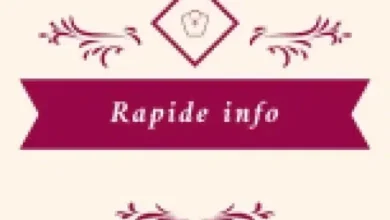Pourquoi les ministres se réfugient derrière le président en cas d’échec ?
Quand l’échec frappe un ministère, c’est souvent le président qui est invoqué en bouclier. Une dérive politique qui gangrène la culture de responsabilité.

Pourquoi les ministres se réfugient derrière le président en cas d’échec ?
Par la rédaction de Rapide Info

Récemment encore, un ministre contesté s’est défendu en invoquant l’aval présidentiel à ses choix et orientations. Plus troublant encore : le Premier ministre lui-même est intervenu pour soutenir son collaborateur, au nom d’une supposée « cohérence de l’action gouvernementale », alors que les faits dénoncés relèvent d’une faillite manifeste. Ce réflexe défensif interroge. Pourquoi défendre l’indéfendable ? Et surtout, pourquoi impliquer le président dans un échec qui aurait dû être assumé à titre personnel ou ministériel ?
Dans un État fonctionnel, la chaîne des responsabilités est claire : chaque ministre est responsable devant le Parlement et le peuple. Le président, garant de l’unité nationale, ne saurait être utilisé comme un paravent systématique à tous les manquements techniques ou politiques. Mais dans nos démocraties encore fragiles, cette responsabilité se dilue souvent dans des jeux d’alliances opaques, où la légitimité ne repose plus sur les résultats, mais sur les allégeances.

Ce phénomène ne peut être interprété que comme un symptôme d’un mal plus profond : la gangrène de l’irresponsabilité politique. Un mal entretenu par une élite qui, au lieu de se soumettre aux principes de transparence et de reddition de comptes, préfère verrouiller les critiques en se réclamant d’une fidélité présidentielle supposée. Le Premier ministre, censé incarner l’autorité et la cohérence du gouvernement, devient alors un figurant chargé de calmer les vagues, non de trancher avec rigueur.
La question fondamentale est donc la suivante : quel modèle d’État voulons-nous construire ? Celui où chaque défaillance devient l’affaire du chef, transformant la présidence en mur porteur des échecs collectifs ? Ou celui d’un État moderne, où les fonctions ministérielles s’accompagnent d’une obligation de résultats et d’un devoir de rendre des comptes ?
Ce n’est pas au président de justifier les erreurs de ses ministres, ni au Premier ministre de couvrir les dérives de ses pairs. C’est à chaque membre du gouvernement d’être jugé sur ses actes, ses résultats, et son intégrité. La République ne peut être réduite à un théâtre de connivences, où la loyauté politique efface la vérité et la responsabilité.
Tant que cette logique de fuite et de couverture prévaudra, nous resterons prisonniers d’une gouvernance opaque, déconnectée des exigences d’un État de droit moderne. Il est temps d’en finir avec les boucliers artificiels, et de redonner à la fonction publique son sens premier : servir l’intérêt général, dans la clarté, l’exemplarité et la responsabilité.