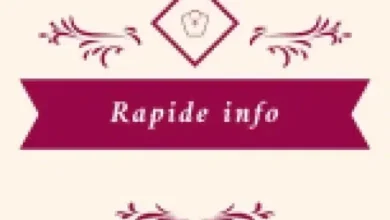Mauritanie – Une Loi de Finances Rectificative 2025 sous le signe de la prudence budgétaire ou de la résignation politique ?

Par Cheikh Sidati Hamadi – Expert senior en droits des CDWD, chercheur associé, analyste, essayiste.
Ce Mercredi 30 juillet 2025, l’Assemblée nationale a adopté la Loi de finances rectificative (LFR) pour l’exercice 2025, marquant une inflexion modeste mais révélatrice dans la trajectoire budgétaire du pays. Présentée par le ministre des Finances, cette LFR actualise le budget initial adopté en décembre 2024, qui s’élevait à 116,87 milliards MRU, pour prendre en compte des ajustements conjoncturels, tant sur le plan des recettes que des dépenses. Le nouveau montant global s’élève à 119,12 milliards MRU, soit une hausse de 2,25 milliards MRU représentant +1,92 %. Ce réajustement s’inscrit dans une volonté affichée de rigueur. Mais à y regarder de plus près, cette rigueur budgétaire peine à masquer certaines fragilités structurelles.
📎 Source officielle : AMI – Adoption de la LFR 2025 par l’Assemblée nationale
1. Une hausse modérée des recettes, portée par le capital
Selon les chiffres communiqués, les recettes totales ont connu une hausse globale de 9,87 % par rapport à la loi de finances initiale (LFI), grâce notamment à une augmentation substantielle des recettes en capital, qui progressent de 225,64 millions MRU, soit +19,29 %. Les recettes fiscales et non fiscales ont donc été dépassées par cette croissance du capital, alors même que les subventions extérieures sont restées stables à 8,8 milliards MRU.
Ce dynamisme relatif du capital pourrait traduire des opérations ponctuelles, comme des cessions d’actifs ou une mobilisation accrue de prêts, mais il reste peu structurant pour un État dont l’économie demeure vulnérable aux chocs exogènes et fortement dépendante des recettes minières.
2. Un déficit maîtrisé, mais à quel prix ?
L’élément le plus spectaculaire réside dans la réduction drastique du financement du déficit, qui passe de 6,37 milliards à 2,16 milliards MRU, soit une baisse de 66,06 %. Cette diminution est saluée par les autorités comme le signe d’une gestion responsable. Le soutien budgétaire des partenaires reste quant à lui stable à 1,53 milliard MRU.
Pourtant, cette baisse du déficit n’est pas le fruit d’une augmentation des recettes courantes, mais davantage d’un ajustement ciblé des dépenses dans certains secteurs. Elle interroge dès lors sur la soutenabilité réelle des politiques publiques face aux défis sociaux structurels, notamment en matière de santé, d’éducation ou de justice sociale.
3. Des dépenses en légère hausse… mais sans ambition transformatrice
Les dépenses totales s’élèvent désormais à 119,12 milliards MRU, contre 116,87 milliards MRU dans la LFI, soit une augmentation de 2,25 milliards MRU (+1,92 %). Cette hausse est principalement portée par les dépenses d’investissement, qui augmentent de 2,38 milliards MRU (+4,66 %).
Dans le même temps, on note une baisse des crédits alloués aux pouvoirs publics et à la gestion administrative, amputés de 500 millions MRU (-0,90 %), ainsi qu’une réduction significative des intérêts de la dette à hauteur de 153,13 millions MRU (-5,28 %). Si cette réduction peut refléter une gestion plus efficace de l’endettement, elle doit être examinée à l’aune des conditions de refinancement et de l’exposition extérieure du pays.
4. Une loi rectificative sans cap socio-économique
Au-delà des chiffres, cette LFR semble guidée davantage par une logique d’ajustement comptable que par une vision stratégique du développement. L’absence de réallocation ambitieuse vers des secteurs clés, en particulier l’éducation, la lutte contre l’exclusion sociale ou la réforme foncière, constitue un angle mort préoccupant. Dans un pays où les inégalités d’accès aux services publics et les discriminations structurelles restent vives, notamment envers les communautés discriminées sur la base du travail et de l’ascendance (CDWD), il est regrettable que la rectification budgétaire ne s’accompagne pas d’un volet social renforcé.
5. Des défis persistants en toile de fond
Rappelons que la croissance du PIB a été révisée à la baisse, passant de 3,3 % à 2,8 % pour 2025 selon les projections du ministère, tandis que l’inflation prévue a été contenue à 2,5 %, contre 4 % dans la LFI. Ces ajustements, s’ils traduisent un certain réalisme, n’en révèlent pas moins les fragilités économiques profondes, notamment la dépendance vis-à-vis du secteur extractif et les difficultés à élargir l’assiette fiscale.
Conclusion : une LFR d’équilibre plus que de vision
En définitive, la LFR 2025 offre un visage d’équilibre budgétaire maîtrisé, mais aussi de résignation politique face aux impératifs structurels. Le gouvernement mauritanien semble soucieux de contenir ses engagements et de rassurer ses partenaires extérieurs, au détriment d’une relance sociale ambitieuse. En l’absence d’un débat public inclusif et d’une stratégie claire de transformation économique, cette rectification apparaît davantage comme un exercice de prudence qu’un levier de développement.
Il est temps que la Loi de finances, même rectificative, cesse d’être un simple outil de calibrage budgétaire et devienne un véritable instrument de redistribution, de justice sociale et d’équité territoriale.
🔗 Références utiles :
🗎 AMI – Loi de Finances Rectificative 2025 (article officiel du 29 juillet 2025)
🗎 Loi de Finances Initiale 2025 – Budget général (décembre 2024)
🗎 Ministère de l’Économie et des Finances – Projections macroéconomiques (juillet 2025)
🗎 Banque centrale de Mauritanie – Rapport Trimestriel Q2 2025