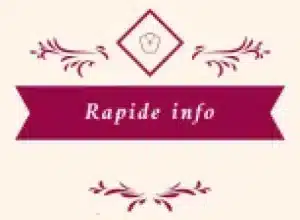Mauritanie : un an après la présidentielle, la démocratie sous tension
Un an après la réélection contestée du président Mohamed Ould Ghazouani, la Mauritanie reste profondément divisée. Dans cette tribune, Ahmed Ould Bettar revient sur les tensions post-électorales, l’absence de l’opposition au dialogue national, et les risques d’une démocratie fragilisée par l’exclusion.

Tribune d’opinion – Par Ahmed OULD BETTAR – 4 juillet 2025
Une élection qui devait apaiser… et qui fracture encore
Le 29 juin 2024, la Mauritanie pensait tourner la page en reconduisant Mohamed Ould Ghazouani dès le premier tour, crédité officiellement de 56,12 % des voix. Un an plus tard, la contestation n’a pas faibli : le principal challenger, Biram Dah Abeid (22,10 %), n’a jamais reconnu sa défaite et continue de porter la bannière d’une « mascarade électorale ».
Dans les rues de Kaédi et d’ailleurs, les célébrations spontanées d’une victoire espérée de l’opposition ont viré au drame : au moins six morts selon des sources locales, trois selon le ministère de l’Intérieur, et des centaines d’arrestations majoritairement de jeunes issus des quartiers périphériques.
Silence numérique, répression classique
La nuit du 2 juillet 2024, une coupure complète d’internet mobile étouffe toute contestation pendant vingt-trois jours. Aucun communiqué officiel n’en explique la raison. Dans un pays où les réseaux sociaux demeurent l’ultime soupape démocratique, cette censure rappelle celle déjà imposée en 2019 : même président, même réflexe d’autorité.
Biram Dah Abeid : la voix de la rupture
Ancien prisonnier politique, figure mondiale de la lutte contre l’esclavage, Biram Dah Abeid campe sur une position de rupture totale. À ses yeux, la légitimité institutionnelle est en lambeaux ; accepter le dialogue national reviendrait à « cautionner l’illégitime ». Il dénonce aussi un chantage du ministère de l’Intérieur : la reconnaissance légale de son parti serait conditionnée à l’acceptation du scrutin… et à la rupture avec Samba Thiam (FPC). Tout un symbole.
Un dialogue voulu « inclusif », mais déjà contesté
Côté palais, la communication se veut rassurante. Sid’Ahmed Ould Mohamed, président du parti INSAF, martèle que le chef de l’État entend « réunir les différents fils de la Nation » pour préserver l’intérêt suprême du pays. « Pas de crise, Dieu soit loué, mais une initiative préventive », affirme-t-il dans un entretien à l’AMI.
Pour garantir la réussite du processus, le président Ghazouani aurait identifié la principale erreur des dialogues passés : une préparation bâclée. D’où la désignation de Moussa Fall pour consulter tous les acteurs et rédiger un document-cadre. « Ce n’est pas une faveur du pouvoir, insiste Sid’Ahmed Ould Mohamed, mais une rencontre d’égal à égal entre représentants politiques ; les conclusions seront mises en œuvre, point. »
Reste qu’en l’état, l’une des principales forces d’opposition – le mouvement IRA de Biram – demeure absente et ses militants disent subir arrestations et intimidations. Un dialogue sans contradicteur crédible peut-il mériter le qualificatif de « national » ?
Entre façade consensuelle et autoritarisme assumé
Les autorités brandissent l’ouverture ; l’opposition majeure dénonce la mascarade ; la société civile oscille entre lassitude et colère. Un an après le scrutin, la fracture est plus morale que numérique : il faudra davantage qu’un tour de table pour recoudre la confiance.
La démocratie ne se résume pas à déposer un bulletin, mais à accepter que ce bulletin puisse, parfois, renverser l’ordre établi. Tant que cette évidence demeurera suspecte, la Mauritanie avancera en funambule : une main tendue vers le dialogue, l’autre crispée sur le levier sécuritaire.
À suivre : quand la politique aura-t-elle le courage de prendre acte de ses propres échecs ? Le pays, lui, n’attendra pas indéfiniment que la classe dirigeante trouve le chemin d’une légitimité partagée.