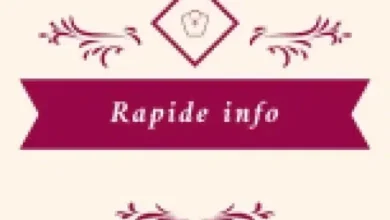Mauritanie : refonder l’État pour construire une nation unie et équitable
Face aux fractures historiques et sociales, la Mauritanie doit repenser ses institutions et bâtir un État unitaire fondé sur l’égalité, la justice et un projet collectif partagé. Une tribune lucide sur l'urgence d’une nation à inventer.

Construire une nation unie et équitable
Dans un pays où les héritages tribaux et hiérarchies sociales pèsent encore lourdement sur le quotidien, la Mauritanie peine à bâtir une véritable nation unie. Nana Mint Cheikhna appelle à une réflexion lucide et inclusive sur la refondation de l’État, pour sortir d’un entre-deux historique et jeter les bases d’un avenir commun, équitable et durable.
Dans l’immensité du Sahara occidental que l’on nomme aujourd’hui Mauritanie, il n’existait, avant la conquête, ni État centralisé ni autorité politique unificatrice . Aucune structure ne fédérait les tribus nomades, les communautés sédentaires ou les chefferies locales qui coexistaient sur ce vaste territoire, à la croisée du Maghreb et de l’Afrique subsaharienne. La notion même de frontière relevait d’une géographie mouvante, définie moins par des lignes fixes que par l’extension fluctuante de l’autorité d’un chef, d’une tribu ou d’une ethnie.
Le tissu social mauritanien s’est historiquement structuré autour de logiques d’allégeance lignagère, tribale et religieuse. Le pouvoir se fondait sur la naissance, l’appartenance à un lignage prestigieux ou à une caste reconnue, qu’il s’agisse de grandes tribus ou d’ethnies dominantes. Ces hiérarchies sociales, profondément enracinées dans toutes nos communautés, continuent encore aujourd’hui de marquer la vie quotidienne, là où l’école républicaine, les services publics et l’égalité formelle des droits n’ont pas suffisamment pénétré. Or, aucune nation ne peut se bâtir durablement sans ancrer la notion de citoyenneté dans l’égalité de statut, loin des classements absurdes et injustes hérités des castes et des hiérarchies traditionnelles.
Ainsi, malgré l’indépendance formelle acquise en 1960, la construction de l’État s’est greffée sur un socle fragmenté, sans qu’un véritable processus d’unification nationale n’ait été mené. L’État postcolonial, en dépit d’efforts considérables et de réalisations particulièrement audacieuses pour l’époque — nationalisation de la Miferma, révision des accords avec la France, création de notre monnaie nationale — s’est d’abord présenté comme la continuité bureaucratique de l’appareil colonial, reconverti aux exigences de la souveraineté, mais sans refondation profonde du lien civique entre les citoyens. Il n’est pas né d’un contrat social endogène, mûri par les populations elles-mêmes, mais d’une transition de forme, imposée par l’urgence de l’indépendance, empêchant ainsi l’émergence progressive d’un élan populaire capable d’accoucher d’une véritable nation.
L’islam, certes, a constitué un socle spirituel commun. Mais en l’absence d’unification politique durable dans l’histoire musulmane de la région, ce legs religieux ne s’est pas traduit par une convergence institutionnelle, ni par l’émergence d’une conscience nationale intégrée. Il a fondé des valeurs partagées, sans pour autant déboucher sur une structure politique unitaire.
Ce passé, loin d’être figé, continue de peser lourdement sur notre présent. Les inégalités héritées des structures traditionnelles, les clivages identitaires latents, l’absence d’un récit national commun, et les dysfonctionnements persistants de l’appareil étatique constituent autant d’obstacles à la cohésion nationale. L’État mauritanien peine encore à s’imposer comme le garant impartial du bien commun, équitablement distribué entre toutes ses composantes.
Il est donc devenu impératif d’ouvrir une réflexion nationale profonde, lucide et inclusive sur les fondements mêmes de notre vivre-ensemble. Quelle structure étatique unitaire , efficace et adaptée pour une société orientée vers le progrès et le développement ?
Comment refonder nos institutions sur des bases véritablement démocratiques et représentatives ? Quels mécanismes mettre en place pour garantir l’égalité réelle des droits, des chances et des devoirs ? Ces questions ne relèvent pas de l’utopie. Elles sont au cœur de la survie même de notre communauté politique.
Faute de les affronter avec courage, la Mauritanie risque de s’enliser durablement dans un entre-deux : ni pleinement unie, ni franchement fragmentée , une société suspendue, tiraillée entre des passés qui résistent et un avenir qui hésite à se dessiner. Et chacun sait que, dans toute société multiethnique, le clair-obscur signifie une zone d’ombre, d’ambiguïté — et, pour tout dire, un risque permanent.
Il est temps d’ouvrir un nouveau cycle. Non pas en niant les héritages, mais en les dépassant vers un horizon commun. Non pas en reproduisant les anciennes hiérarchies sous des formes modernisées, mais en bâtissant un État équitable, porteur d’un projet collectif assumé.
Le temps est venu d’inventer la nation.
Et si nous le voulons vraiment, les fondations existent déjà. Nous partageons un socle commun, souvent oublié mais toujours vivant. Nous sommes tous musulmans. Nous célébrons les mêmes fêtes, prions dans la même langue, et nous reconnaissons dans une même éthique de vie. Nos cultures, bien que diverses, résonnent entre elles. Nos musiques, nos boubous, nos contes populaires, nos proverbes, nos manières d’habiter le désert ou la vallée tissent une trame d’expériences partagées. Nos mémoires, parfois douloureuses, parfois glorieuses, racontent les mêmes croisements de peuples, les mêmes épreuves historiques, les mêmes aspirations à la dignité.
C’est là notre richesse, à condition de la reconnaître, de l’assumer, et d’en faire le socle d’un nouvel imaginaire collectif. Mais cela ne pourra se faire sans un regard lucide sur ce que nous sommes. Sans préjugés. Sans complaisance. Sans méfiance. Si nous avons le courage d’ouvrir les yeux sur nos blessures, de les nommer, de les comprendre, alors nous pourrons les soigner. Et ce pays, que certains croient encore condamné à l’échec, montrera au contraire qu’il est porteur de promesses, capable de surmonter ses blocages et d’écrire une autre histoire.
Alors, oui : si nous acceptons d’aller de l’avant ensemble, nous ferons mentir ceux qui prétendent que rien ne changera. Que tout est joué d’avance. Il suffira que les gouvernants et la classe politique comprennent qu’aucune œuvre commune ne peut naître sans concessions partagées, sans un effort sincère pour construire du commun à partir de nos différences. Le sursaut viendra, non d’un pouvoir imposé, ni d’une contestation éparse, mais d’une volonté collective d’unir nos mémoires, d’harmoniser nos aspirations, et de refonder nos institutions sur une base juste. C’est ainsi que la Mauritanie pourra se réconcilier avec elle-même et choisir, enfin, son avenir.
Un avenir sûr et prometteur.
Nana Mint CHEIKHNA