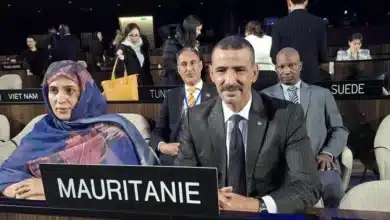Les Haratines : une identité forgée dans la douleur, la résistance et l’espérance

Les Haratines : une identité forgée dans la douleur, la résistance et l’espérance
En Mauritanie, le discours national dominant tend encore trop souvent à présenter les Haratines comme une simple extension culturelle de l’arabo-berbèrité. Cette lecture réductrice ne rend pas justice à la complexité et à la richesse d’une communauté dont l’identité s’est construite dans la marginalisation, mais aussi dans une lutte courageuse pour la dignité et la reconnaissance. Les Haratines ne sont ni des “Arabes noirs” ni des figures folklorisées d’un passé esclavagiste révolu : ils sont les porteurs d’une identité propre, forgée dans la douleur, la résistance et l’espérance.
Une histoire douloureuse et occultée
Les Haratines sont issus d’un système esclavagiste ancestral profondément enraciné dans les structures sociales mauritaniennes. Bien que l’abolition de l’esclavage ait été proclamée à plusieurs reprises — en 1981, puis criminalisée en 2007 —, les séquelles de ce système persistent. Elles se traduisent par des discriminations systémiques dans l’accès à l’éducation, à la terre, aux postes de pouvoir, et même à la reconnaissance symbolique dans le récit national.
Comme l’a souligné le chercheur Abdel Wedoud Ould Cheikh : « Les Haratines ne sont pas seulement les produits d’un système ; ils en sont les critiques vivants, les témoins d’une autre mémoire, d’une autre lecture de l’histoire nationale. » Cette mémoire est douloureuse, mais elle est aussi fondatrice d’une conscience historique distincte, souvent ignorée dans les constructions identitaires officielles de l’État mauritanien.
La résistance : une quête d’autonomie et de reconnaissance
Loin d’être passifs face à leur condition, les Haratines ont très tôt entamé un combat pour leur libération et leur reconnaissance. Dès les années 1970, le mouvement El Hor (les libres) a incarné cette volonté d’émancipation. En rompant le silence imposé par les structures traditionnelles et politiques, El Hor a permis l’émergence d’une parole haratine autonome, articulée autour des droits civiques, de l’égalité et de la justice sociale.
Boubacar Ould Messaoud, militant des droits humains et figure de cette lutte, affirmait : « El Hor a été la matrice d’une parole haratine autonome, celle qui refuse l’assignation à l’invisibilité. » Ce mouvement a également contribué à briser le monopole identitaire de l’élite arabo-berbère sur la définition de la nation, en affirmant que les Haratines sont des citoyens à part entière, et non des dépendants ou des “clients” politiques.
La résistance haratine s’est aussi exprimée à travers l’engagement institutionnel, notamment avec des figures comme Messaoud Ould Boulkheir, premier président de l’Assemblée nationale issu de cette communauté. Son parcours symbolise cette volonté de transformation sociale à partir des institutions, tout en gardant une fidélité aux luttes populaires.
Les haratines, une identité en construction et une espérance nationale
Loin d’être figée, l’identité haratine est en constante évolution. Elle ne se réduit pas à un simple héritage victimaire, mais s’ancre dans une dynamique de dépassement, de projection et de participation à l’avenir commun. Comme l’écrivait le sociologue Samba Thiam : « Les Haratines portent une vision de la Mauritanie où la liberté n’est pas un privilège, mais un droit commun. »
Dans ce sens, les Haratines ne cherchent pas à se replier sur eux-mêmes, mais à participer pleinement à l’édification d’une nation plurielle, juste et inclusive. Leur combat est celui de tous les opprimés, de toutes les marges, et à ce titre, il interpelle la conscience nationale.
Reconnaître les Haratines comme porteurs d’une identité propre, ce n’est pas fragmenter la nation, c’est au contraire lui donner la profondeur historique et la richesse humaine qui font les grandes sociétés. Comme le soulignait récemment un intellectuel mauritanien : « Une nation ne se construit pas dans l’uniformité imposée, mais dans l’harmonie négociée de ses diversités. »Wetov.
Sy Mamadou