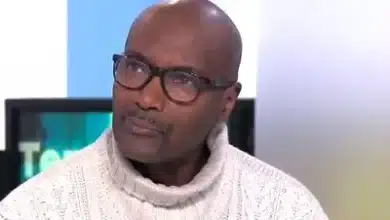Le déclassement des Noirs en Mauritanie : une mécanique systémique
Le déclassement des Noirs en Mauritanie : une mécanique systémique

Opinion libre
Le déclassement des Noirs en Mauritanie n’est pas une anomalie isolée ni une conséquence d’événements ponctuels. Il s’agit d’un système pensé et reproduit, une mécanique de marginalisation collective visant à maintenir l’ordre racial et social en faveur d’une élite arabo-berbère.
L’illusion de l’exception individuelle
Beaucoup de Noirs mauritaniens, y compris parmi mes proches, se persuadent qu’ils seront épargnés. Ils pensent que leur loyauté envers le régime, leur arabité revendiquée ou leur réussite sociale les protègera. Ils croient que le déclassement n’est réservé qu’aux autres – les plus pauvres, les plus visibles dans leurs revendications ou les moins « intégrés ».
Mais l’histoire récente a démontré que cette croyance est une illusion. Car le système ne vise pas des individus : il vise toute une communauté, en tant que groupe racial et culturel.
Des exemples historiques révélateurs
• Les purges de l’armée et de la fonction publique (1987-1991) : des milliers d’officiers et de fonctionnaires noirs ont été radiés, exilés, ou exécutés dans les casernes. Certains étaient pourtant des cadres compétents, patriotes et loyaux envers l’État. Leur seul « tort » fut leur appartenance ethnique. Ces événements ont montré que la loyauté ou l’intégration individuelle ne suffisaient pas à briser la logique raciale.
• Les expropriations foncières dans la vallée du fleuve Sénégal : au nom de la « réforme agraire » et de la redistribution, des terres cultivées par des communautés halpulaar, wolof et soninké depuis des générations ont été confisquées au profit de groupes maures. Même des notables noirs liés au pouvoir n’ont pas échappé à cette dépossession, preuve que la mécanique du déclassement dépasse les alliances individuelles.
• Le blocage des initiatives économiques et financières : tous les projets de banques portés par des Soninkés ou des Halpulaaren ont été refusés par l’État. Le cas emblématique est celui d’un milliardaire soninké vivant au Nigeria, qui, malgré ses moyens colossaux, n’a jamais pu obtenir d’agrément bancaire en Mauritanie. Feu Ba Mamoudou Samboly, l’un des pères de la nation, a lui-même rapporté ces injustices, révélant leur caractère structurel.
Une mécanique théorisée par les penseurs africains
La marginalisation des Noirs en Mauritanie s’inscrit dans une logique coloniale plus large.
• Frantz Fanon, dans Peau noire, masques blancs, écrivait : « Le Noir n’est pas reconnu dans son humanité, mais réduit à une fonction dans l’imaginaire du dominant. » En Mauritanie, cette fonction est celle du citoyen subalterne, toléré mais jamais reconnu à égalité.
• Cheikh Anta Diop rappelait dans Nations nègres et culture : « La véritable indépendance d’une nation passe par la reconnaissance de tous ses enfants comme égaux. » Or, la Mauritanie postcoloniale a reproduit un modèle d’État-nation exclusif, arabo-centré, niant sa pluralité africaine.
Une mécanique collective, non sélective
Le déclassement des Noirs n’est pas sélectif. Il peut frapper l’intellectuel comme le paysan, l’officier comme l’étudiant, le milliardaire comme le migrant. Chacun peut penser être « à l’abri », mais l’appartenance raciale demeure le critère ultime qui détermine l’accès ou non aux droits, aux ressources et à la reconnaissance.
En Mauritanie, le déclassement des Noirs est une mécanique politique qui vise à maintenir un ordre inégalitaire. Croire que l’on est protégé individuellement est une illusion. Comme le montre l’histoire récente, tôt ou tard, le système rattrape tout le monde, car il ne vise pas des individus isolés mais l’ensemble de la communauté noire.
C’est pourquoi le combat pour la dignité ne peut pas être individuel. Il est nécessairement collectif, enraciné dans la mémoire des injustices passées et tendu vers un avenir de justice et d’égalité…Wetov.
Sy Mamadou