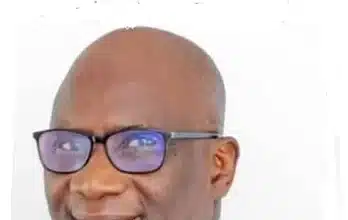L’article de Nana Mint Cheikhna : Une pertinence inouïe entre avertissement et responsabilité
Cet article explore la profonde analyse de Nana Mint Cheikhna sur les failles du modèle d’État en Mauritanie, révélant des enjeux de gouvernance et de responsabilité sociale. Un appel à la prise de conscience collective et à l’engagement citoyen pour transformer le pays.
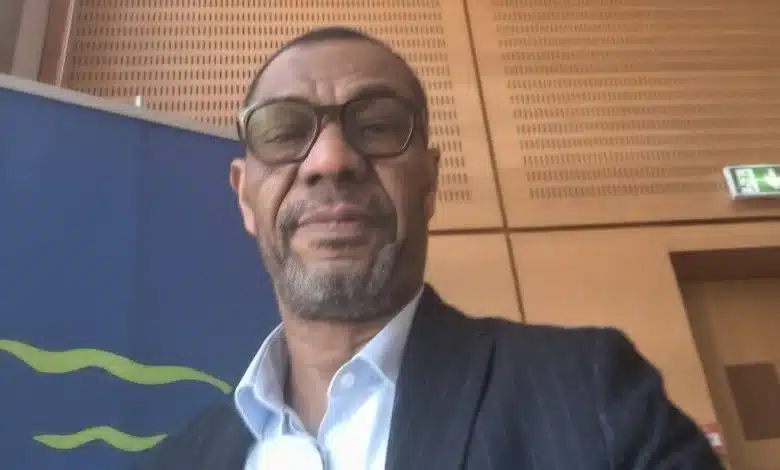
l’article de Nana Mint Cheikhna et d’une pertinence inouïe : entre avertissement et responsabilité
L’article de Nana Mint Cheikhna frappe juste : il expose, avec une rare lucidité, les failles structurelles de notre modèle d’État, qui oscille entre façade institutionnelle et réalité tribalo-rentière. Comme elle le rappelle, la Mauritanie vit un décalage permanent entre ses promesses constitutionnelles et la pratique d’un pouvoir dominé par la logique du clan, du réseau et de l’allégeance.
Mais si son analyse décrit fidèlement le mal, il est nécessaire d’y ajouter une vérité encore plus dérangeante : nous ne sommes pas seulement les victimes d’un système ; nous en sommes trop souvent les complices silencieux.
1. Plus qu’un problème de gouvernance : une culture de résignation
Il est vrai que les élites se partagent les richesses, que l’armée verrouille le pouvoir et que l’école agonise. Mais le problème n’est pas uniquement au sommet. Le tribalisme, le clientélisme et l’informel fonctionnent parce qu’ils trouvent un terrain fertile dans la société elle-même.
Dans les nominations, les marchés publics, voire les élections, la tribu et le clan l’emportent régulièrement sur l’intérêt général parce que beaucoup acceptent encore cette logique comme la norme. Le citoyen attend rarement de l’État un droit ; il sollicite un « piston », un « intermédiaire », un « grand frère » qui parle à sa place. Tant que la demande sociale reste prisonnière du clan, l’offre politique ne se libérera pas.
2. L’éducation, oui, mais pas seulement
Nana Mint Cheikhna a raison de placer l’éducation au sommet des priorités. Sans école publique solide, aucune société ne se modernise. Mais il faut être clair : une école n’est pas seulement une infrastructure ni un salaire pour les enseignants, c’est une vision de société.
Or ce qui a manqué, ce n’est pas d’abord l’argent, c’est la conviction qu’instruire un enfant, qu’il soit arabe, peul, soninké ou wolof, est un acte national et non une concession communautaire.
La vérité est là : tant que l’éducation est instrumentalisée dans des rapports de domination linguistique, ethnique ou politique, l’école restera un terrain de fracture au lieu d’être un socle commun.
3. Ressources et rente : le vrai visage du “pays riche et peuple pauvre”
La Mauritanie n’est pas seulement victime d’une prédation de ses ressources, elle est prisonnière d’un modèle rentier. Les élites se contentent de redistribuer des miettes de la rente minière, halieutique et, bientôt, gazière, sans valorisation réelle dans l’économie locale.
Le parallèle avec le Soudan est juste, mais il faut souligner que le danger vient moins du manque de ressources que de l’absence totale de projet industriel, agricole ou éducatif capable de les transformer en capital humain.
Encore une fois, nous gaspillons parce que nous n’investissons pas dans l’homme, et non simplement parce que les caisses sont pillées.
4. Souveraineté et indépendance : un slogan sans contenu
L’autre vérité qu’il faut dire est que nous « jouons à l’État ». Officiellement, nous avons une Constitution, une démocratie, une armée régulière. En pratique, l’économie est externalisée, la sécurité repose en partie sur des partenariats étrangers, la migration est négociée comme un service à l’Europe, et l’identité nationale reste fragmentée en blocs tournés vers d’autres horizons (Maghreb, Afrique de l’Ouest, Monde arabe).
La souveraineté proclamée n’aura de sens que lorsque l’État sera réellement fondé sur la citoyenneté, et non sur l’appartenance communautaire.
5. La vérité finale : le salut ou l’abandon dépendra de la jeunesse
La plus grande différence entre le Soudan hier et la Mauritanie aujourd’hui, c’est notre jeunesse. Elle est massive, brillante pour une partie, désespérée pour beaucoup. Elle constitue la bombe à retardement du système, mais aussi la seule chance de le transformer.
Le danger, ce n’est pas la division ethnique seulement, ni le laxisme institutionnel — c’est le fait que cette jeunesse se détourne chaque jour davantage de la Mauritanie, non par rejet de son pays mais par perte d’espérance.
Tant que ses énergies sont gaspillées dans l’exil, l’informel ou la révolte désordonnée, aucune réforme profonde ne verra le jour.
Mais si elle parvient à transformer ses frustrations en projet politique, social et économique — si les jeunes refusent d’être des supplétifs d’un système de rente — alors seulement la Mauritanie évitera le sort du Soudan.
Bref !
Nana Mint Cheikhna a raison : l’histoire n’avertit pas deux fois.
Mais la vérité est plus implacable encore : aucun sauveur, aucun homme providentiel, aucun accord extérieur ne nous sauvera. Seule une refonte profonde de la relation entre l’État et ses citoyens — par l’éducation, par la citoyenneté et par la rupture avec le tribalisme comme moteur politique — peut donner une chance à la Mauritanie.
Il ne s’agit pas d’accuser un système de l’extérieur mais d’affronter notre part de responsabilité collective.
Sinon, oui : un matin viendra où nous découvrirons que nous ne sommes plus un État, mais une fiction administrative posée sur un désert..
Abdoulaziz DEME
Rouen le 03 septembre 2025