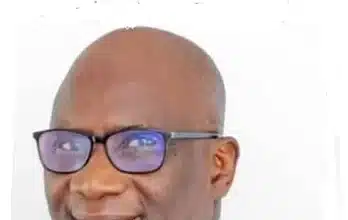La corruption en Mauritanie : un fléau réveillant un volcan endormi
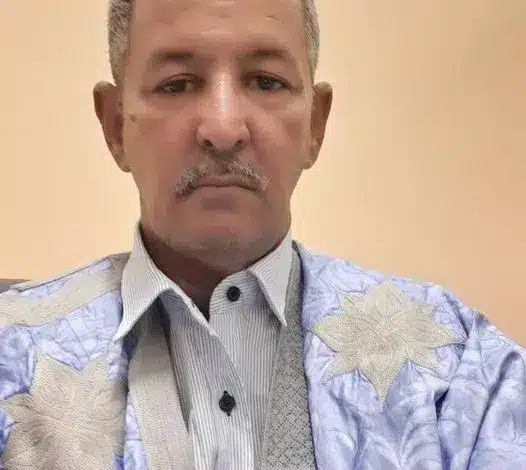
La corruption en Mauritanie : un fléau réveillant un volcan endormi
La corruption, véritable poison de la gouvernance, gangrène l’économie et le tissu social de la Mauritanie. Telle un tyran invisible, elle affaiblit les institutions, alimente les inégalités et mine la confiance des citoyens envers l’État. Longtemps perçue comme un mal tolérable, elle réveille aujourd’hui un volcan qui menace d’engloutir les fondements de la nation.
Un système enraciné dans les pratiques administratives
En Mauritanie, la corruption est présente à tous les niveaux de la société : favoritisme dans les nominations, détournements de fonds publics, passations de marchés opaques et pots-de-vin sont monnaie courante. L’absence de transparence et le manque de contrôle favorisent cette dérive, transformant les institutions en véritables instruments de rente pour une élite privilégiée.
Selon Transparency International, en 2022, la Mauritanie était classée 130e sur 180 pays dans l’Indice de perception de la corruption. L’Afrique subsaharienne perd chaque année près de 50 milliards de dollars à cause des flux financiers illicites, selon la Commission économique pour l’Afrique de l’ONU. Plusieurs affaires ont mis en évidence des détournements massifs de fonds publics, notamment dans les secteurs des pêches, des mines et des infrastructures.
L’affaire Petrobras au Brésil a révélé des détournements estimés à 2 milliards de dollars, démontrant l’ampleur de cette problématique, tout comme l’affaire des « votes truqués » en Russie qui a alimenté une méfiance généralisée envers le système politique.
Les conséquences : un frein au développement et une menace pour la stabilité
La corruption en Mauritanie a des répercussions profondes :
- Sur l’économie : en privant les secteurs stratégiques de financements essentiels, elle empêche la réalisation de projets vitaux et freine la croissance. Selon la Banque mondiale, les pays corrompus affichent un taux de croissance inférieur de 1 % à 2 % par rapport aux pays où la corruption est limitée.
- Sur la démocratie : en faussant le jeu électoral et en encourageant le clientélisme, elle affaiblit les institutions et empêche l’émergence d’une gouvernance transparente et responsable. Des cas de fraude électorale et d’achat de voix ont été signalés lors des dernières élections.
- Sur la cohésion sociale : en creusant les inégalités et en favorisant un sentiment d’injustice, elle nourrit la frustration populaire et expose le pays à des tensions sociales croissantes. En Mauritanie, la mauvaise gestion des fonds publics a entraîné une détérioration des infrastructures éducatives et sanitaires, alimentant un mécontentement généralisé.
Quelles solutions pour un changement durable ?
Pour lutter contre ce fléau, plusieurs mesures s’imposent :
- Renforcer l’indépendance de la justice : instaurer des mécanismes judiciaires transparents et impartiaux pour sanctionner les actes de corruption. La Commission nationale de lutte contre la corruption en Mauritanie doit être dotée de plus de moyens pour fonctionner efficacement. La Commission nationale anti-corruption au Nigéria a récupéré plus de 3 milliards de dollars d’actifs volés en une décennie.
- Une transparence accrue : les gouvernements doivent instaurer des politiques de transparence budgétaire et permettre un accès libre aux informations publiques. En Estonie, la digitalisation des services publics a réduit les opportunités de corruption et augmenté la confiance des citoyens.
- L’éducation et la sensibilisation : inculquer les valeurs d’intégrité dès l’école est un rempart contre la banalisation de la corruption. Le Rwanda a introduit des cours de civisme et de gouvernance transparente dans ses programmes scolaires.
- Le rôle des médias et de la société civile : en enquênt et en dénonçant les pratiques illégales, ces acteurs deviennent des garde-fous indispensables. L’affaire « Panama Papers » a exposé un vaste réseau d’évasion fiscale, mettant en lumière l’importance du journalisme d’investigation.
La Mauritanie a mis en place plusieurs mesures pour lutter contre la corruption, parmi lesquelles :
1. Création d’institutions de contrôle
– La Cour des Comptes, chargée d’auditer la gestion des finances publiques.
– L’Inspection Générale d’État (IGE), qui contrôle l’administration et détecte les irrégularités.
– La Commission Nationale de Lutte contre la Corruption (CNLC), visant à coordonner les efforts de transparence.
2.Renforcement du cadre juridique
– Adoption de la loi anti-corruption en conformité avec les conventions internationales.
– Obligation pour certains hauts fonctionnaires de *déclarer leur patrimoine*.
3. Numérisation des services publics
– Mise en place de systèmes électroniques pour réduire les manipulations directes d’argent et limiter la corruption administrative (exemple : modernisation des finances publiques).
4. Enquêtes et poursuites judiciaires
– Plusieurs personnalités publiques et hommes d’affaires ont été poursuivis pour corruption, notamment dans le cadre de la gestion des ressources publiques.
5. Collaboration avec des organismes internationaux
– Engagement dans des programmes de bonne gouvernance soutenus par la Banque mondiale et le FMI.
– Ratification de la Convention des Nations Unies contre la corruption.
Ces mesures restent perfectibles et la lutte contre la corruption demeure un défi nécessitant un suivi constant et une réelle volonté politique.
En somme, la corruption ne se combat pas en un jour, mais chaque mesure prise pour la contenir contribue à éviter l’éruption du volcan social. Car si elle n’est pas stoppée à temps, elle finit toujours par consumer les régimes qu’elle a corrompus et plonger les nations dans le chaos.
Ahmed Ould Bettar