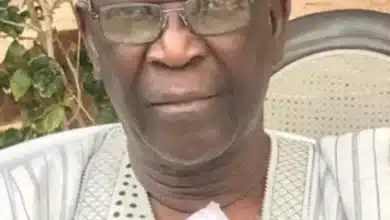Banjul 2025 : L’impact des injustices historiques sur les droits des CDWD au Maghreb et en Mauritanie
À Banjul, des experts ont débattu des injustices historiques et de leurs effets persistants sur les droits des communautés discriminées par ascendance et travail.

85e Session de la CADHP : Réflhttps://rapideinfo.mr/wp-admin/post-new.phpexion sur l’impact des injustices historiques sur les droits des CDWD au Maghreb et en Mauritanie , Banjul 18 octobre 2025
Lors de la 85e session ordinaire de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples à Banjul, un panel co-organisé par Gfod, Avocats sans frontières Canada et TEMEDT (Mali) s’est penché sur l’impact durable des injustices historiques — esclavage, colonisation et discriminations héréditaires — sur les droits des communautés discriminées sur la base du travail et de l’ascendance (CDWD) au Maghreb et en Mauritanie.
L’expert Cheikh Sidati Hamady y a plaidé pour des réformes structurelles, une justice réparatrice et la reconnaissance de ces héritages comme conditions d’une égalité réelle.
Panel sur l’impact des Injustices historiques sur les Droits des CDWD organisé par Gfod , Avocats sans frontieres Canada, TEMEDT ( Mali )
Quel impact les injustices historiques ont-elles sur les droits des communautés discriminées sur la base du travail et de l’ascendance (CDWD) au Maghreb, et en Mauritanie particulièrement ?
Par Cheikh Sidati Hamady
Expert Senior en Droits des CDWD, Chercheur, Specialiste des Discriminations Structirelles , Analyste, Essayiste
Les injustices historiques constituent les strates profondes sur lesquelles reposent bien des inégalités contemporaines. Elles ne relèvent pas seulement du passé : elles structurent encore aujourd’hui les sociétés, les mentalités et les institutions. Dans le Maghreb, et particulièrement en Mauritanie, ces injustices prennent racine dans une histoire longue et plurielle, où s’entrecroisent l’esclavage interne africain, l’esclavage arabo-musulman, la traite négrière occidentale et le système colonial.
Bien avant les grandes traites transsahariennes ou atlantiques, des formes d’esclavage endogène existaient déjà sur le continent africain, souvent liées aux conflits entre royaumes et chefferies traditionnelles, à la dette, à la captivité ou au travail forcé. Ces systèmes, parfois intégrés aux structures politiques locales, furent ensuite captés, intensifiés et marchandisés par les réseaux esclavagistes arabo-musulmans, puis par la traite transatlantique organisée par les puissances européennes. Ces différents courants ont fini par institutionnaliser l’idée d’une hiérarchie fondée sur la naissance, la couleur et le travail, donnant une apparente légitimité culturelle ou religieuse à la domination et à la servitude.
La colonisation, loin d’abolir ces logiques, les a souvent consolidées : en classant les populations selon leurs statuts coutumiers, en maintenant les chefferies hiérarchiques, et en intégrant les anciens ordres esclavagistes dans son système d’administration indirecte. En Mauritanie, cette stratification s’est cristallisée dans un ordre social complexe, marabouts, guerriers, tributaires, griots, forgerons, affranchis et esclaves, dont les effets demeurent visibles dans la répartition du pouvoir, de la richesse et du prestige.
Les Communautés discriminées sur la base du travail et de l’ascendance (CDWD) portent encore aujourd’hui les stigmates de cette longue histoire. Leur marginalisation n’est pas seulement économique, mais aussi juridique, culturelle et symbolique : accès limité à l’éducation, à la propriété, à la justice, à la représentation politique et à la reconnaissance identitaire. Ces discriminations structurelles traduisent la persistence d’un ordre social hérité de l’esclavage, souvent refoulé dans le discours public mais toujours opérant dans les pratiques sociales.
Dans cette perspective, ce panel d’aujourd’hui se veut un espace de réflexion, de vérité et de responsabilité collective. Il s’agit non seulement d’examiner la continuité historique de ces injustices et leurs impacts multiformes sur les droits fondamentaux des CDWD, au Maghreb et en Mauritanie, mais aussi de réfléchir aux moyens concrets de transformation. Cela suppose d’identifier les réformes institutionnelles, éducatives, économiques et juridiques capables de rompre avec les logiques d’exclusion, de reconstruire la mémoire collective sur des bases de vérité et de dignité, et de promouvoir une justice réparatrice fondée sur l’égalité réelle.
En posant la question : « Quel impact les injustices historiques ont-elles sur les droits des communautés discriminées sur la base du travail et de l’ascendance (CDWD) au Maghreb, et en Mauritanie particulièrement ? », nous engageons une réflexion lucide sur la continuité entre mémoire et citoyenneté, histoire et justice, reconnaissance et refondation. Comprendre le passé, c’est déjà en affronter les héritages pour bâtir un avenir affranchi des chaînes invisibles, fondé sur l’égalité des droits, la solidarité et la dignité humaine.
1. L’esclavage intra-africain et la stratification sociale
Bien avant la traite arabo musulmane , atlantique et la colonisation, de nombreux royaumes et empires africains pratiquaient l’esclavage et la servitude héréditaire. Les esclaves et autres groupes subalternes étaient assignés à des métiers spécifiques(forgerons, griots, artisans) transmis de génération en génération. En Mauritanie, la société arabo berbère illustre cette structuration hiérarchique : Zwaya (marabouts), Eerab (guerriers), Znaga (tributaires), Iguawen (griots), M’almine (forgerons), Hratin (affranchis) et Abid (esclaves). Les Komo( esclaves) chez les Soninké, les Maccudo ( esclaves ) chez les Pulars et les Diam ( esclaves) chez les Wolofs ainsi que les castes de professionnelles ( Niakhamala, Gnegnbe et Gnegno ) ont été également assignés à des positions subalternes, distinctes des esclaves, mais frappées de discriminations sociales, culturelles et économiques (Amnesty International – Mauritanie).
Au Maghreb, les descendants d’esclaves subsahariens, tels que les Gnawa au Maroc et les Bou’khari ou Shoucha en Tunisie, ont subi une marginalisation durable, confinés à des métiers artisanaux ou à des quartiers périphériques (Princeton University – Gnawa, Minority Rights Group – Tunisia).
2. La traite transsaharienne
La traite transsaharienne a duré plus de 12 siècles (du VIIIe au XIXe siècle), déplaçant entre 10 et 15 millions de personnes de l’Afrique subsaharienne vers le Maghreb et le monde arabe (UNESCO – Traite transsaharienne). Les captifs étaient soumis au travail agricole, domestique ou militaire. Les femmes étaient souvent affectées à des tâches domestiques et reproductives, consolidant ainsi des hiérarchies basées sur l’ascendance et la couleur de peau. Cette dynamique a durablement structuré la société dans des pays comme le Maroc, la Tunisie, l’Algérie, la Libye et même l’Égypte, où les Nubiens ont été relégués dans des positions marginales et stigmatisées (Minority Rights Group – Egypt).
3. La traite atlantique
Indépendamment de la traite transsaharienne, la traite atlantique, du XVe au XIXe siècle, a arraché plus de 12 millions d’Africains vers les Amériques, touchant directement les populations de l’Afrique noire en général. Les conséquences ont été profondes : traumatismes collectifs, fragmentation des communautés, et renforcement de la stigmatisation des descendants d’esclaves dans leurs sociétés d’origine. La mémoire de cette traite a contribué à institutionnaliser des systèmes de discrimination héréditaire (Anti-Slavery International – Mali et Niger).
4. Colonisation et marginalisation institutionnelle
La colonisation européenne a renforcé ces hiérarchies en favorisant certaines élites locales et en marginalisant systématiquement les CDWD. En Mauritanie, les administrateurs français ont consolidé la hiérarchie Arabo berbère et les castes supérieures en limitant l’accès des Haratines ou Abid , Komo, Maccudo et Diam à la terre, à l’éducation et aux postes de décision. Au Maghreb, des politiques similaires ont exclu les Gnawa, Bou’khari, Shoucha et autres descendants d’esclaves de l’accès à l’emploi qualifié et à la représentation politique (Human Rights Watch – Mauritanie).
5. Impacts contemporains sur les CDWD et lien avec les ODD
Aujourd’hui, ces injustices historiques se traduisent par une marginalisation persistante des CDWD, qui limite leur accès à la terre, à l’éducation, à l’emploi à la participation politique et par l’émergence d’un esclavage moderne qui se repend sous differentes formes . En Mauritanie, près de 70 % des Haratines et 60 % des Komo et Maccudo vivent sous le seuil de pauvreté (Banque mondiale – Mauritanie), tandis que le taux d’analphabétisme chez les adultes Haratines et Komo et Maccudo dépasse 65 % (UNICEF Mauritanie). Dans le Maghreb, les Gnawa au Maroc représentent environ 5 % de la population et restent majoritairement confinés à des métiers artisanaux (Princeton University – Gnawa).
Ces réalités compromettent directement plusieurs ODD de l’Agenda 2030 : la pauvreté (ODD 1), l’éducation (ODD 4), l’égalité des sexes (ODD 5), la réduction des inégalités (ODD 10) , la justice et institutions efficaces (ODD 16), car l’accès à la justice reste limité et les lois anti-esclavage sont peu appliquées (SOS Esclaves, IRA Mauritanie).
6. Recommandations
Les injustices historiques, esclavage intra-africain, traites transsaharienne et atlantique, colonisation, ont façonné des sociétés hiérarchisées qui continuent de marginaliser les CDWD au Maghreb et en Mauritanie. Rompre ce cycle nécessite des mesures concrètes, mesurables et temporellement définies.
Application stricte des lois anti-esclavage en Mauritanie : audits annuels des tribunaux spécialisés pour garantir l’efficacité des sanctions.
Réforme foncière inclusive : délivrer des titres fonciers sécurisés à 80 % des familles CDWD rurales d’ici 2027.
Éducation ciblée : atteindre 90 % de scolarisation des enfants CDWD d’ici 2030 avec programmes d’alphabétisation et d’éducation inclusive.
Inclusion politique : instituer des quotas garantissant 15 % de représentation des CDWD dans les instances décisionnelles.
Coopération régionale : échanges entre États du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest sur les bonnes pratiques pour réduire la discrimination héréditaire.
Références cliquables
ONU – Rapport sur les formes contemporaines de l’esclavage, 2022
Amnesty International – Mauritanie
Human Rights Watch – Mauritanie
SOS Esclaves
IRA Mauritanie
Anti-Slavery International – Mali et Niger
Princeton University – Études sur les Gnawa
Minority Rights Group – Tunisia
UNESCO – Traite transsaharienne
Banque mondiale – Mauritanie
UNICEF Mauritanie
Afrobarometer – Mali, Mauritanie, Sénégal