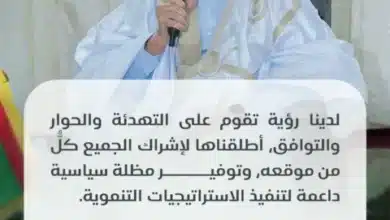Éditorial : En Mauritanie, l’environnement paie le prix fort de la ruée minière
L’industrie minière en Mauritanie accélère la dégradation environnementale. Entre pollution et désertification, un modèle à repenser d’urgence.

Environnement et industrie minière
Par la rédaction
Dans l’immensité désertique de la Mauritanie, les entrailles de la terre renferment des trésors qui attirent depuis des décennies des multinationales et des États en quête de matières premières. Fer, or, cuivre, uranium, et plus récemment lithium : le sous-sol mauritanien est un eldorado géologique. Mais si ces ressources représentent une manne économique, elles ont un coût environnemental et social de plus en plus insoutenable.
Les industries minières, pilier de l’économie nationale — représentant plus de 25 % des exportations — sont aussi les premières responsables d’une dégradation environnementale accélérée. Dans les régions du nord, notamment autour de Zouérate, de F’derîck et dans le bassin minier de Tasiast, les paysages se transforment : forages à ciel ouvert, poussières toxiques, pollution des nappes phréatiques, destruction de la faune et de la flore saharienne. À l’ère où le climat devient une priorité mondiale, la Mauritanie semble prise dans une contradiction brutale : valoriser son potentiel extractif sans hypothéquer son avenir écologique.
La pollution de l’air, causée par les émissions de poussières fines et les fumées industrielles, affecte directement les populations locales, souvent reléguées à la périphérie des zones d’exploitation. Les maladies respiratoires augmentent, les terres agricoles sont stérilisées, et les éleveurs, déjà menacés par la désertification, voient leurs pâturages disparaître sous l’effet des activités industrielles. Le silence des autorités face à ces atteintes à l’environnement et à la santé publique est assourdissant.
Pire encore, les réglementations environnementales, pourtant inscrites dans le Code minier mauritanien, sont peu appliquées. Les études d’impact environnemental, exigées par la loi, sont souvent bâclées, inaccessibles au public, ou validées sans contrôle indépendant. Les sociétés minières, qu’elles soient publiques comme la SNIM ou privées comme Kinross Gold, bénéficient d’un traitement préférentiel et d’un cadre juridique permissif, leur permettant de contourner leurs obligations environnementales.
Dans un pays où les institutions de contrôle sont faibles et les communautés locales marginalisées, l’extractivisme se transforme en prédation. On sacrifie l’environnement pour des recettes budgétaires immédiates, sans vision à long terme. Et pourtant, la Mauritanie est l’un des pays du Sahel les plus vulnérables aux changements climatiques : avancée des dunes, sécheresse chronique, rareté de l’eau. En accentuant ces menaces, l’industrie minière, si elle reste incontrôlée, aggrave une crise écologique déjà structurelle.
Il est urgent de repenser la gouvernance environnementale en Mauritanie. Cela passe par un renforcement des institutions de régulation, une transparence totale des contrats miniers, l’implication des communautés dans la surveillance des projets, et l’adoption de normes contraignantes sur la dépollution et la réhabilitation des sites exploités. Il est aussi temps de diversifier l’économie, au lieu de dépendre exclusivement d’un modèle extractif daté, inégalitaire et écocidaire.
L’exploitation minière ne doit pas être une malédiction, mais une opportunité maîtrisée. Cela exige un sursaut politique, un engagement citoyen, et une pression internationale. L’environnement mauritanien, déjà fragilisé par la nature, ne peut plus être sacrifié à l’autel de la rente minière.
Dans ce contexte préoccupant, l’initiative gouvernementale d’organiser, du 31 juillet au 6 août 2025, la Semaine nationale de l’arbre, placée sous le thème « Mobilisons-nous pour une Mauritanie verte », apparaît comme un signal encourageant, bien que symbolique. Sous le haut patronage du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, cette campagne entend mobiliser les citoyens autour de la reforestation, avec des actions concrètes telles que la plantation d’arbres, la création de pépinières forestières, l’ensemencement par drones et des activités de sensibilisation à travers les médias et les réseaux communautaires. Si cette mobilisation constitue une étape importante dans la lutte contre la désertification, elle ne saurait masquer l’urgence de réformes structurelles dans les secteurs à forte empreinte écologique, au premier rang desquels se trouvent les industries minières.
P.S
Cet éditorial est un appel à la responsabilité : celle des entreprises, des autorités publiques, mais aussi de la société civile. L’urgence environnementale n’est pas une abstraction lointaine — elle se vit ici et maintenant, dans la poussière des mines et le silence des dunes.
Rapideinfo