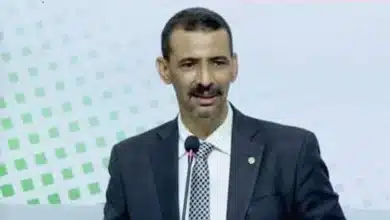ÉDITORIAL – Mauritanie : L’État de citoyenneté, entre volontarisme présidentiel et vieilles inerties administratives

Il est des notions que l’on convoque sans les habiter pleinement. La « citoyenneté » en Mauritanie demeure encore, trop souvent, un mot noble condamné à cohabiter avec des pratiques anciennes, peu compatibles avec les exigences modernes d’égalité et de service public. Pourtant, l’heure n’est plus aux slogans : la société réclame un État qui soit réellement au service de tous, sans distinction ni condition.
Or, dans ce domaine, il faut reconnaître qu’un mouvement nouveau semble se dessiner au sommet de l’État. Depuis quelque temps, le pouvoir exécutif affiche la volonté de rompre avec certaines habitudes administratives et de rapprocher l’État du citoyen. Et la récente rencontre du Président de la République avec les walis s’inscrit précisément dans cette dynamique.
Un moment institutionnel important : quand le centre interpelle la périphérie
En effet, cette réunion entre le Chef de l’État et les représentants de l’administration territoriale n’était pas un banal exercice protocolaire. Bien au contraire, elle marque une tentative de donner une réalité concrète aux orientations politiques ambitieuses annoncées ces dernières années.
Le Président est allé au-delà des déclarations de principe :
- il a demandé aux walis de devenir des courroies actives entre l’État et les citoyens,
- il a insisté sur l’amélioration réelle de l’accès aux services publics,
- et il a rappelé que l’appartenance nationale devait primer définitivement sur les fidélités secondaires qui fragmentent le pays.
Ainsi, cette réunion constitue, au moins sur le plan symbolique, une étape importante. Après tout, un État de citoyenneté ne se décrète pas depuis un palais : il se construit d’abord là où vit le citoyen, dans son école, sa mairie, son dispensaire, son commissariat.
De la parole politique vers le terrain : un gouvernement mis devant ses responsabilités
Par ailleurs, au-delà des orientations générales, le Chef de l’État a également invité le gouvernement à accompagner ces ambitions. Autrement dit, il n’est plus question que les revendications locales remontées par les walis se perdent dans les labyrinthes administratifs ou les liturgies interminables des dossiers en instance.
À présent :
- chaque ministère est appelé à traiter les problèmes concrets transmis depuis les wilayas,
- la coordination centrale doit être renforcée,
- et les solutions doivent se traduire en améliorations visibles pour la population.
Ainsi, non seulement les walis sont responsabilisés, mais les ministères aussi. Ce n’est pas un détail : cela révèle une volonté d’obliger toute la chaîne administrative à rendre des comptes. Pour un pays où l’impunité bureaucratique a souvent été la règle, cette orientation constitue une rupture potentielle.
Cependant, la lucidité s’impose : les résistances existent encore
Toutefois, si cette dynamique mérite d’être saluée, il serait naïf – et même complice – d’ignorer les difficultés qui persistent.
De fait, la Mauritanie reste marquée par des mécanismes hérités du passé :
- accès inégal à la justice,
- poids des intermédiaires sociaux,
- administration paternaliste,
- clientélisme à peine masqué,
- et asymétries profondes dans la distribution des ressources publiques.
Dès lors, la question essentielle est la suivante : les walis, même motivés, auront-ils la capacité réelle de bousculer ces puissantes inerties ? Le cynisme peut répondre « pas encore », mais la raison invite à dire « pas si les engagements présidentiels se limitent au discours ».
Car un État de citoyenneté ne se mesure pas à l’éloquence de ceux qui l’annoncent, mais à la transformation réelle vécue par ceux qui le subissent ou l’attendent.
Une perspective plus large : ce que l’histoire nous enseigne
Pour éclairer ce moment historique, il n’est pas inutile de convoquer ici une leçon classique. Montesquieu rappelait que les institutions ne fonctionnent durablement que lorsqu’elles façonnent les comportements. Autrement dit :
un décret ne suffit pas si les mentalités ne suivent pas,
une directive est inutile si les pratiques profondes ne changent pas.
Ainsi, si la rencontre avec les walis doit produire ses effets, elle devra s’accompagner :
- d’une justice réellement indépendante,
- de sanctions contre les abus d’autorité,
- de récompenses pour les administrateurs exemplaires,
- et d’une évaluation régulière des résultats sur le terrain.
Sans cela, l’initiative présidentielle, aussi prometteuse soit-elle, risque de rejoindre la longue liste des « réformes qui n’ont changé que les dossiers ».
Conclusion provisoire : l’espoir n’est pas interdit, mais le suivi sera décisif
En définitive, saluons ce qui doit l’être :
oui, le Président de la République a envoyé un signal fort en réunissant les walis ;
oui, le gouvernement est publiquement mis devant l’obligation de servir plus efficacement ;
et oui, cette orientation marque une volonté d’inscrire la gouvernance dans une logique de citoyenneté.
Mais pour que cette rupture soit réelle, il faudra désormais aller au-delà de l’intention.
Car la Mauritanie n’a plus le luxe de rater ce rendez-vous avec elle-même.
L’État de citoyenneté ne demande pas seulement des discours, mais des preuves. Et si la société mauritanienne commence à espérer, elle commence surtout à exiger.
Ahmed Ould Bettar
Rapide Info – Mauritanie