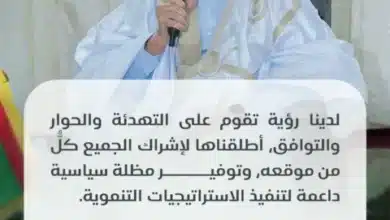Quand la parole divise : dérive d’un discours anti-mauritanien sur la TFM
Une émission en wolof sur TFM a servi de tribune à un discours clivant sur la Mauritanie, porté par Youssoupha Mbengue. Analyse critique d’un moment de télévision où la provocation a pris le pas sur la raison, menaçant les équilibres fragiles entre deux nations liées par l’histoire.

Une émission de la chaîne sénégalaise TFM, censée valoriser la diaspora, a viré à la tribune provocatrice. L’ancien président des Sénégalais de Libye, Youssoupha Mbengue, y a tenu des propos dangereux mêlant fantasmes raciaux, incitation voilée à l’ingérence et méconnaissance flagrante de la réalité mauritanienne. Décryptage d’un moment télévisuel aussi confus que préjudiciable.
Il est des moments où la parole, plutôt que d’éclairer le débat, l’assombrit dangereusement. L’émission en wolof diffusée sur la chaîne de télévision sénégalaise TFM, consacrée à la diaspora, aurait pu – aurait dû – être un espace de réflexion, de partage d’expériences et de construction d’un avenir commun. Elle s’est transformée, hélas, en tribune d’un discours clivant, chargé de ressentiments mal digérés et de fantasmes géopolitiques aussi irréalistes qu’inacceptables.
Car que faut-il penser d’un invité, en l’occurrence l’ancien président des Sénégalais de Libye, M. Youssoupha Mbengue, qui se permet de suggérer – sans trembler – une ingérence sénégalaise dans les affaires internes de la Mauritanie ? Et ce, au nom d’une lecture raciale de la démographie, comme si l’Histoire pouvait être réduite à une simple équation chromatique ? Ce n’est plus de l’analyse, c’est une provocation. Ce n’est plus un témoignage, c’est une incitation.
Le décor lui-même en disait long. Une émission en wolof, ouverte par l’animatrice Kebs Thiam qui, avant même d’ouvrir la bouche, s’appliquait à redresser son collier en pacotille, ajuster son boubou couleur Coca-Cola et recadrer ses sandales roses : un carnaval de tons mal accordés, comme si la palette avait été mélangée par un peintre daltonien sous acide. Face à elle, Youssoupha, drapé dans un boubou moutarde aux reflets poussiéreux, coiffé d’un bonnet sénégalais bleu roi, campé dans des sandales d’un bleu criard. Un cocktail visuel qui n’a rien à envier aux expérimentations cubistes — sauf qu’ici, il ne s’agissait pas d’art, mais d’un désastre chromatique télévisé.
Et le contenu, hélas, n’a rien rattrapé. L’invité, sûr de lui comme seuls les ignorants savent l’être, s’est lancé dans une série de contrevérités avec une aisance désarmante. Il évoque le rapatriement impossible des Sénégalais de Libye, donne des chiffres sortis d’on ne sait quel chapeau, et ponctue ses absurdités par la formule typique des menteurs expérimentés : « Si je ne me trompe pas… » — ce qui, vu l’expression de son visage, relevait moins du doute que du rituel.
Ce Youssoupha, qui affirme avoir passé « 15 ans en Libye », semble en effet marqué par un exil intérieur non résolu. L’homme parle comme s’il avait pris le Livre Vert de Kadhafi pour une constitution personnelle. Verbe confus, mémoire sélective, raisonnement circulaire : les cicatrices de Tripoli sont visiblement encore fraîches. Et au lieu de panser ses plaies, il choisit de projeter ses troubles sur des peuples voisins.
Mais avant de vouloir « dresser » la Mauritanie, ne serait-il pas plus sain de régler d’abord ses comptes avec la réalité ? Avec ses chiffres, son rôle passé, ses responsabilités ? La dignité ne commence-t-elle pas par une parole vérifiée, pesée, respectueuse ? Or ici, nous n’avions ni données, ni lucidité, ni même décence.
La Mauritanie n’est pas un théâtre de projection pour les frustrations régionales, encore moins un échiquier sur lequel les citoyens d’autres États pourraient déplacer les pions à leur convenance. La souveraineté d’un peuple n’est pas un bien meuble. Elle ne se prête pas, ne se vend pas, ne se partage pas à la carte. Elle s’affirme, se construit, se défend, parfois dans la douleur, mais toujours dans la dignité.
Le tissu riche de la société mauritanienne ne peut être réduit à des lectures binaires. Ce serait oublier l’histoire, les résistances, les métissages, les alliances politiques et les luttes partagées. Ce serait aussi trahir la mémoire des intellectuels, des artistes, des militants – noirs, blancs, métis – qui, depuis l’indépendance, ont bâti ensemble une République aux contours bien réels.
Ce pont symbolique et concret entre les deux Rosso n’a pas été construit pour devenir le support de discours haineux ou d’intentions subversives. Il est le rappel d’une histoire partagée, de familles éparpillées de part et d’autre du fleuve, d’économies imbriquées et de cultures entrelacées. Menacer cet équilibre par des mots mal pesés, c’est jouer avec une corde tendue entre deux peuples frères.
Et s’il fallait un rappel : quiconque viendrait, l’esprit gonflé d’arrogance, prétendre « changer la donne » en Mauritanie, découvrirait que le pont de Rosso, s’il relie les peuples, sait aussi suspendre haut les illusions, parfois même les plus intimes. Il est des lieux où la suffisance se désintègre en silence.
La liberté d’expression ne peut être invoquée pour justifier le sabotage des équilibres nationaux. Il ne s’agit pas ici de polémiquer, mais de prévenir. L’incendie commence toujours par une étincelle. À ceux qui, par ignorance ou calcul, s’imaginent qu’on peut manipuler des tensions intercommunautaires comme on anime un débat de plateau, il faut répondre par la rigueur, la fermeté, et surtout par la hauteur.
Car si les mots ont un poids, alors ils ont aussi une responsabilité. Et certains devraient apprendre à les porter avant de prétendre les imposer aux autres.
Mohamed Ould Echriv Echriv