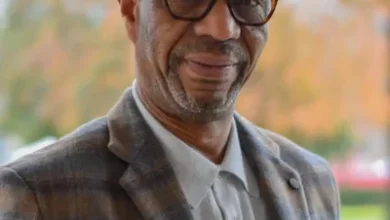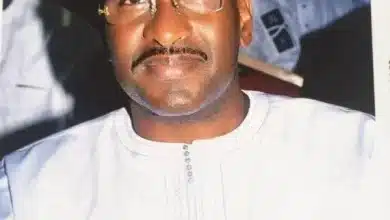Dialogue national en Mauritanie : Une vision de la majorité sur la table, mais des interrogations persistent sur l’inclusivité du processus

Dialogue national en Mauritanie : Une vision de la majorité sur la table, mais des interrogations persistent sur l’inclusivité du processus

Le document, présenté comme une plateforme de propositions sur les grandes questions nationales, entend baliser la voie vers un consensus. Accueillant favorablement cette initiative, M. Fall a salué l’effort de convergence des partis au pouvoir, soulignant la portée d’une telle démarche dans un contexte où l’unité d’intention peut faciliter la construction d’un dialogue « responsable et respectueux ». Il a également rappelé les avancées politiques du pays et la nécessité de s’inscrire dans cette dynamique avec rigueur et lucidité.
La majorité a tenu à exprimer son alignement derrière le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qu’elle qualifie de garant du dialogue inclusif. Pour ses porte-parole, cette cohésion traduit une volonté affirmée d’aborder les défis nationaux dans un esprit d’ouverture et de continuité. Dans un pays où les équilibres politiques demeurent sensibles, cette initiative se veut un signal fort en faveur de la stabilité.

Même son de cloche du côté de la société civile. Des ONG, des syndicats et des groupes citoyens pointent un manque de transparence dans la préparation du dialogue et appellent à une participation active de toutes les composantes du tissu social, notamment des jeunes, des femmes et des groupes historiquement marginalisés. Le risque, selon eux, est que le dialogue ne devienne un simple mécanisme de légitimation, plutôt qu’un espace de refondation.
La communauté internationale, qui observe ce processus avec attention, y voit une opportunité de renforcer la stabilité politique du pays. Plusieurs partenaires au développement ont exprimé leur espoir de voir émerger un consensus national propice à un climat de confiance et à l’amélioration des conditions de gouvernance. Néanmoins, ils insistent sur la nécessité d’un cadre équitable, où les droits à l’expression et à la participation sont garantis pour tous les acteurs.
Les médias, quant à eux, rappellent que la réussite de ce dialogue dépendra en grande partie de sa capacité à être transparent et inclusif. Certains organes de presse regrettent de ne pas avoir été associés aux premiers échanges, tandis que des éditorialistes appellent à une vigilance constante pour éviter que l’initiative ne soit accaparée par les élites.

En définitive, la présentation d’une vision unifiée par la majorité représente une avancée sur le plan symbolique. Mais pour que ce dialogue réponde véritablement aux attentes des Mauritaniens, il devra intégrer les voix dissidentes et traduire la diversité de la nation. C’est à ce prix que le processus pourra dépasser le simple cadre politique pour devenir un véritable projet de société. La balle est désormais dans le camp de l’ensemble des acteurs nationaux : sauront-ils s’élever au-dessus des intérêts partisans pour inscrire la Mauritanie sur la voie d’un avenir partagé ?
AOB