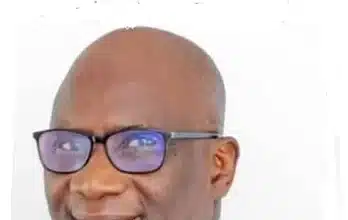Un débat télévisé en Hassānīyya dissèque la corruption en Mauritanie : entre diagnostic, morale et responsabilité
Un débat télévisé en Hassānīyya sur TTV a réuni intellectuels, politiques et experts autour de la question de la corruption en Mauritanie. Des échanges denses et sincères ont révélé les tensions entre gouvernance, morale publique et justice.

Corruption en Mauritanie
#Corruption #Mauritanie #BonneGouvernance #DébatTTV #Transparence #Gabegie #SociétéCivile #RéformesAdministratives #Hassaniya
Hier soir, nous avons assisté à un débat télévisé en Hassānīyya sur la chaîne TTV , réunissant des intellectuels de haut niveau , s’exprimant sans langue de bois .
Ce fut un échange dense et mesuré , où le temps de parole compté n’a pas empêché la profondeur des analyses . Le plateau rassemblait des représentants de la majorité , de l’opposition , de la société civile ainsi que des experts reconnus .
Le débat s’est ouvert par l’intervention de Mohamed Abba Jeilani chargé de mission à la Primature, qui a déclaré que « Toute erreur de gestion est considérée par la loi comme un acte de gabegie passible de sanctions. »
La déclaration de Mohamed Abba , introduit une thèse audacieuse qui brouille volontairement les frontières entre faute administrative et délit pénal . En affirmant que toute erreur de gestion équivaut à un acte de gabegie , il place la question de la gouvernance au cœur du droit moral : non plus seulement le vol , mais la défaillance dans la gestion devient acte corrupteur .
Mohamed Abba rappelle, par une formule lapidaire, que le mal administratif n’est pas seulement une déviance, mais une matrice du délit .
« Le vol direct de l’argent public ne représente qu’environ 2 % des cas de gabegie en Mauritanie, tandis que la corruption sous forme de pots-de-vin atteint 10 %. »
Ce chiffre , s’il est exact , inverse la hiérarchie classique du mal : le voleur devient anecdotique, l’influence devient centrale. La corruption n’est plus un geste de main , mais une culture de l’échange inavoué . Mohamed Abba introduit ici un diagnostic quantitatif qui met à nu la sociologie du compromis : même la bienveillance administrative devient monnaie .
« Tous les dossiers mentionnés dans le rapport de la Cour des comptes ont été transmis à la justice.»
Cette affirmation, qu’il faut lire entre les lignes, est plus performative que descriptive : elle cherche à attester la forte volonté politique de l’exécutif , tout en réaffirmant le rôle du judiciaire comme ultime arbitre de la probité nationale. C’est une déclaration de loyauté administrative avant d’être un constat objectif .
Mohamed Ould Mohamed El Hacen expert économiste et Président de l’Institut 2IRES, déclare que « La corruption se manifeste à plusieurs degrés. La plus grave est celle des politiciens et des hautes sphères du pouvoir. La plus faible est le petit bakchich reçu par un fonctionnaire modeste. »
L’expert économiste introduit une typologie verticale de la corruption. Il distingue non pas le légal de l’illégal, mais le poids moral des actes.. Le » bakchich » devient ici presque une réaction de survie dans une économie de pénurie , tandis que la corruption politique, elle, relève d’une prédation consciente et systémique .
« Certaines personnes, mus par une évidente mauvaise foi , ont tenté de tromper l’opinion publique en faisant circuler le chiffre fictif de 400 milliards d’ouguiyas , présenté comme représentant les détournements relevés dans les départements audités par la Cour des comptes , alors qu’un tel chiffre n’apparaît nulle part dans le rapport officiel . »
Cette phrase est une mise en garde contre la corruption du discours. Ould Mohamed El Hacen déplace la bataille du terrain des faits vers celui de la narration . Il y a là un constat lucide : dans la société numérique, la manipulation de l’opinion est devenue un instrument de pouvoir aussi redoutable que le détournement de fonds .De nombreux experts partagent son point de vue, et même le président de la Cour des comptes a confirmé que le chiffre colossal de 400 milliards d’ouguiyas n’existe pas. Il est largement supérieur au budget cumulé des départements audités .
« Il faut instaurer un contrôle discret sur les organes de contrôle. »
Cette proposition révèle l’ambivalence du modèle mauritanien : la transparence par le centre, non par la décentralisation. Un idéal de vertu pyramidale, qui ignore les vertus du contre-pouvoir .
Mohamed Yahya Ould Horma vice-président du parti El Insaf déclare que « La bonne gouvernance est une condition incontournable pour tout État moderne. »
Ould Horma réinscrit le débat dans la théorie de l’État rationnel. Sa vision s’apparente à celle d’un fonctionnalisme républicain.
« Certains cadres intègres et compétents sont parfois écartés précisément en raison de leur honnêteté. »
Il arrive que le régime les marginalise ou les limoge, les condamnant à de longues périodes de chômage, bien plus longues que leurs temps de service — une situation qui décourage profondément la jeune génération d’administrateurs .
Ce constat , brise le tabou de l’ingérence des » réseaux « dans la gestion administrative . Elle expose une réalité connue mais tue : l’administration mauritanienne souffre moins d’un manque de compétences que d’une instabilité organisée . La loyauté y est souvent moins récompensée que la docilité.
Quant à El Hassan Ould Mohamed vice- président de Tewassoul, il a déclaré lors de ce débat télévisé que « Certains fonctionnaires déjà impliqués dans des affaires de corruption ont été réintégrés dans l’administration . »
Le vice-président de Tewassoul met en lumière la reproduction du capital corrupteur . Dans cette société, le scandale n’exclut pas : il recycle . Le fonctionnaire déchu devient conseiller, le coupable d’hier devient le mentor de demain .
« La corruption remonte à la fin des années 1970 et est devenue systémique. »
Cette historicisation du mal est essentielle : la corruption cesse d’être un accident pour devenir structure. Elle est, comme la rouille, endogène à la machine. Le discours d’El Hassan Ould Mohamed se rapproche ici d’une sociologie du pillage d’État, où les institutions elles-mêmes deviennent outils d’extraction.
« On voit des fonctionnaires , posséder des villas et des voitures luxueuses. »
Phrase d’une ironie tragique : le luxe devient preuve. Dans cette phrase, le sociologue devine le moraliste — et derrière le moraliste, le désespoir d’un citoyen qui voit l’éthique remplacée par l’ostentation .
Mohamed Abdallah Belil, président de l’Observatoire Mauritanien de Lutte contre la Corruption, a affirmé dans son intervention au cours du débat : « Je mets au défi tout chercheur de produire un diagnostic plus précis et exhaustif que celui de la nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption et du document sur la bonne gouvernance. »
Belil revendique ici le monopole du diagnostic . Sa posture est celle du technocrate en croisade : pour lui, l’analyse est close, il ne reste que l’action. Mais cette clôture du débat scientifique sur la corruption est dangereuse : elle fige la réflexion en dogme administratif.
« L’heure n’est plus au diagnostic mais à l’action.»
L’homme de la société civile se fait ici stratège . Il traduit l’épuisement d’une génération d’analystes qui voient les rapports s’empiler sans effets . Toutefois , en dénonçant la nomination de personnes incompétentes dans vingt institutions , il montre que l’action qu’il appelle de ses vœux reste prisonnière des mêmes cercles de cooptation .
Belil a également ajouté qu’il existe des personnes qui se portent à la défense de certains individus cités dans le rapport de la Cour des comptes, invoquant leur honnêteté .
Il a précisé en avoir compté sept cas, avant de déplorer une telle attitude, qu’il juge inappropriée et contraire à l’esprit même de la transparence .
Moustapha Sidatt, ancien sénateur et secrétaire général de l’ONG Transparence Inclusive, véritable sage connu pour son franc-parler, a affirmé que « La lutte contre la gabegie est une cause d’unité nationale et de consensus et ne doit pas être politisée . »
Cette phrase, d’apparence consensuelle, est d’une profondeur stratégique . Sidatt propose de transformer la lutte contre la gabegie en symbole fédérateur , un mythe civique autour duquel la nation se refonde . Il refuse l’approche partisane pour y substituer une éthique collective .
« Il faut distinguer la gabegie administrative, politique, morale, communautaire et environnementale. »
Rare est l’intellectuel mauritanien à avoir osé une telle cartographie du mal. En introduisant la gabegie environnementale et la gabegie communautaire , Sidatt élargit le champ moral de la responsabilité : la mauvaise gestion des écosystèmes naturelles et la manipulation des identités deviennent aussi graves que les détournements budgétaires .
« Le Président doit disposer d’un dossier exhaustif sur tous les responsables déjà impliqués dans le détournement des fonds publics . »
Cette recommandation n’est pas qu’administrative : elle est symbolique. Elle traduit une demande de mémoire institutionnelle . Dans un pays où le passé administratif s’efface à chaque remaniement à chaque nouveau régime , Sidatt réclame un registre de la faute — une archive de la responsabilité .
« La société civile prépare un Front national de soutien à la lutte contre la corruption. »
Le mot front n’est pas anodin : il militarise la vertu. La société civile se prépare à devenir une force d’encerclement éthique, une conscience organisée . Mais son efficacité dépendra d’une condition : qu’elle reste indépendante du pouvoir qu’elle prétend soutenir .
Ce débat, révèle une vérité simple et douloureuse : la corruption en Mauritanie n’est pas seulement un crime contre la loi , mais une fracture du lien civique .
Entre les technocrates qui parlent de diagnostic, les politiques qui invoquent la bonne gouvernance, et les militants qui exigent l’action , se dessine une trame plus profonde : celle d’une société en quête d’un nouveau contrat moral .
La corruption n’est plus une affaire de juges ni de ministres — elle est devenue un prisme à travers lequel se réfléchit la conscience nationale .
Et dans ce miroir brisé, chaque intervenant de ce débat a tendu à la Mauritanie un fragment de vérité .
Mohamed Ould Echriv Echriv