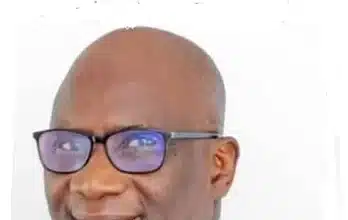De l’uniforme au costume civil : la Mauritanie à l’épreuve de l’après-Aziz

De l’uniforme au costume civil
Nouakchott – 1er août 2019. Dans l’enceinte solennelle du palais présidentiel, le président sortant Mohamed Ould Abdel Aziz remet officiellement les clés du pouvoir à son ancien compagnon d’armes, Mohamed Ould Ghazouani. Une poignée de main, quelques sourires protocolaires, et un passage de relais qui, à première vue, semble se dérouler sans accroc. Mais derrière cette mise en scène maîtrisée s’ouvre une page incertaine de l’histoire mauritanienne. Pour la première fois depuis l’indépendance, un président élu succède à un autre président élu sans coup d’État ni rupture institutionnelle. Ce moment, qualifié d’historique, cristallise autant d’espoirs que de doutes.
La fin d’un cycle autoritaire
L’image de Mohamed Ould Abdel Aziz quittant la présidence, costume civil sur le dos, contraste avec celle du militaire en treillis qui, en 2008, avait pris le pouvoir par la force, après avoir évincé Sidi Ould Cheikh Abdallahi. L’ancien général, resté onze ans à la tête du pays, a imprimé sa marque sur toutes les sphères du pouvoir. Sous son autorité, la Mauritanie connaît une certaine stabilité, notamment face aux menaces jihadistes venues du Sahel. Mais cette stabilité a un prix : répression des oppositions, musellement de la presse, gestion opaque des ressources publiques.
Avant de se retirer, Mohamed Ould Abdel Aziz déclare son patrimoine à la commission de transparence. Une obligation légale, certes, mais dont le contenu reste confidentiel. Un silence assourdissant qui alimente les soupçons d’enrichissement personnel. L’homme fort d’hier s’efface dans une semi-opacité, laissant derrière lui une démocratie fragile, à la fois en chantier et en sursis.
Un successeur, mais aussi un héritier
Mohamed Ould Ghazouani, ancien chef d’état-major, ministre de la Défense, figure du sérail militaire, est plus qu’un successeur. Il est le produit d’un système qu’il connaît intimement. Son élection, en juin 2019, s’est faite dans la continuité de son prédécesseur. Même cercle, même méthode, même discours de stabilité. Pourtant, dès les premières semaines de son mandat, un subtil virage semble s’amorcer.
Ghazouani adopte un ton plus posé, davantage tourné vers le dialogue. Il tend la main à certaines figures de l’opposition, consulte les syndicats, rencontre des ONG. Cette posture nouvelle tranche avec le style autoritaire de Mohamed Abdel Aziz, mais suscite aussi l’attente d’actes forts. L’armée continue de jouer un rôle central, bien que moins ostensible. Le président, tout juste débarrassé de son uniforme, doit maintenant se forger une stature d’homme d’État civil, avec tout ce que cela implique en matière de gouvernance, de transparence et de réformes structurelles.
Une stabilité sous haute tension
Sur le front sécuritaire, la Mauritanie fait figure d’exception dans un Sahel en flammes. Les attaques terroristes y sont rares, la surveillance des frontières est stricte, et les partenariats avec les puissances occidentales, notamment la France, l’Espagne et les États-Unis, sont solides. Le pays est membre actif du G5 Sahel, même si les résultats concrets de cette coopération demeurent limités.
Mais cette stabilité apparente repose sur une gestion sécuritaire rigide, une surveillance étroite des populations et un contrôle renforcé des médias. Dans les régions frontalières, notamment à l’est, les populations peules et soninkés dénoncent un sentiment d’abandon, voire de stigmatisation. La paix relative tient plus du couvercle maintenu sur la marmite que d’une véritable pacification des territoires.
Une société fragmentée
Au-delà de la sécurité, les défis sociaux restent vertigineux. La pauvreté touche bon nombre de la population. Les inégalités se creusent entre la capitale, en pleine expansion, et les régions rurales délaissées. La jeunesse, majoritaire, est confrontée au chômage massif, à la précarité et à un horizon souvent bouché. Beaucoup rêvent de partir, vers l’Europe ou ailleurs, au péril de leur vie.
La question identitaire demeure explosive. La Mauritanie est un carrefour de cultures : arabo-berbère au nord, subsaharienne au sud. Mais cette richesse est aussi source de tensions. La mémoire des violences de la fin des années 1980 – expulsions massives, exécutions sommaires, disparitions forcées – reste vive, notamment chez les communautés négro-africaines. Si l’État a mené quelques gestes symboliques de réconciliation, les réparations concrètes se font attendre.
Et puis, il y a la plaie béante de l’esclavage. Officiellement aboli depuis 1981, criminalisé en 2007, il n’en demeure pas moins une réalité pour plusieurs milliers de Mauritaniens, selon les ONG. Les haratines, descendants d’esclaves, continuent de subir discrimination sociale, précarité économique et marginalisation politique. Ghazouani a bien promis une lutte « sans concession » contre ce fléau, mais les poursuites restent rares, et les condamnations encore plus.
Lire aussi : La victoire de Mohamed Ould Ghazouani à l’élection présidentielle : un enjeu complexe pour la Mauritanie
Ahmed OULD BETTAR
Un militaire à la conquête du pouvoir civil
A suivre…