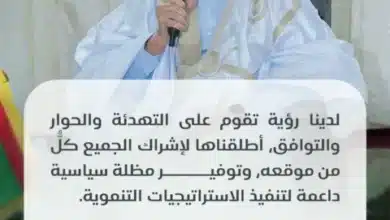Crise énergétique : quand l’échec d’un ministre devient le fardeau du président
À Nouakchott, la gestion chaotique de l’électricité expose les dérives d’un pouvoir où les échecs ministériels sont couverts par le Premier ministre lui-même.

Face aux coupures d’électricité à Nouakchott, le ministre de l’Énergie est sous le feu des critiques. Mais au lieu d’assumer l’échec, le Premier ministre le couvre publiquement, entraînant l’institution présidentielle dans une crise de responsabilité. Une dérive symptomatique d’un système où la loyauté prime sur les résultats.
Mohamed Ould Mohamed Malainine Ould Khaled, ministre de l’Énergie et du Pétrole, figurait récemment, dit-on, parmi les noms évoqués pour remplacer Moctar Ould Diay dans une éventuelle recomposition gouvernementale. Une perspective visiblement mal digérée par le chef du gouvernement, qui voit d’un mauvais œil toute ambition trop visible. Mais au-delà de ces manœuvres internes, c’est le bilan du ministre qui fait grincer des dents.
Sa gestion du secteur énergétique a été tout sauf rassurante. Nouakchott vit depuis des mois au rythme erratique de délestages chroniques, plongeant la capitale dans le noir… et ses habitants dans une soif intenable, en plein été saharien. Un désastre que l’opinion publique qualifie déjà de « grande soif » — métaphore amère d’un naufrage administratif.
Face à cette colère grandissante, on aurait pu attendre du ministre concerné une prise de parole claire, des excuses assumées, voire une remise en question. Il n’en fut rien. Pire : c’est le Premier ministre lui-même qui a pris la plume sur sa page Facebook pour défendre son collaborateur défaillant, dans un élan de flatterie jugé embarrassant jusque dans les rangs de la majorité.
« Toutes les ressources ont été mobilisées pour une solution radicale », promet Moctar Ould Djay dans un communiqué publié en ligne. Il y égrène projets, chiffres et chantiers à venir, allant jusqu’à souligner que « Son Excellence le président suit personnellement la situation ». Une tentative de dédouanement collectif qui masque difficilement l’échec individuel.
Dans cette mise en scène politique, les faits s’effacent derrière les formules. Le discours officiel évoque des causes « structurelles » et « circonstancielles » aux interruptions d’électricité — sans jamais nommer les erreurs humaines, les retards de planification ou les déficits de gestion qui gangrènent le secteur.
Mais le plus préoccupant n’est pas tant l’échec en lui-même, que la façon dont il est assumé — ou plutôt, éludé. Car en Mauritanie, le réflexe de protection est devenu une mécanique bien huilée : dès qu’un ministre vacille, le pouvoir s’emploie à le sanctuariser derrière l’autorité présidentielle. Le président devient alors non plus le garant de l’unité nationale, mais le paravent commode de toutes les défaillances ministérielles.
Ce modèle de gouvernance, fondé sur la loyauté plus que sur la compétence, éloigne dangereusement l’administration de l’exigence républicaine. À force de flatter les égos plutôt que de faire parler les résultats, l’État donne l’image d’un système fermé, où l’impunité prospère sous couvert de solidarité gouvernementale.
Moctar Ould Djay, nommé Premier ministre en août 2024, incarne cette nouvelle vague de technocrates portés au sommet de l’État. Mais son attitude face à la crise énergétique laisse entrevoir une autre facette de ce profil : celle d’un chef de gouvernement qui préfère apaiser les tensions internes plutôt que trancher avec rigueur. En soutenant publiquement un ministre désavoué, il s’inscrit dans une logique de couverture mutuelle qui sape la confiance du public et dévoie la mission de l’exécutif.
Dans une démocratie fonctionnelle, chaque ministre doit répondre de ses actes devant le Parlement et les citoyens. Mais dans le contexte mauritanien, cette responsabilité semble se diluer dans des jeux d’alliances opaques, où la fidélité au chef l’emporte sur toute exigence de résultats.
Le drame est là : on n’attend plus des ministres qu’ils réussissent, mais qu’ils plaisent. On ne les juge plus à l’aune de leurs actions, mais à la chaleur de leurs réseaux. Et le président, censé être au-dessus des contingences partisanes, se retrouve enrôlé dans des batailles de protection qui le discréditent indirectement.
Il est donc urgent de reposer la question essentielle : quel État voulons-nous construire ? Un État où chaque échec devient « l’affaire du président », banalisant ainsi les fautes ? Ou un État moderne, responsable, où chaque fonction publique s’accompagne d’un devoir de rendre des comptes — sans bouclier ni fard ?
La République ne peut être réduite à une scène de théâtre où les acteurs politiques masquent leurs insuffisances derrière la bannière présidentielle. À terme, ce jeu dangereux ne profite à personne, si ce n’est à la médiocrité. Il est temps que la transparence, la compétence et la redevabilité redeviennent les piliers de l’action publique. Et que chacun, du ministre au chef du gouvernement, retrouve le courage d’assumer ce qu’il fait… ou ce qu’il ne fait pas.
Ahmed Ould Bettar