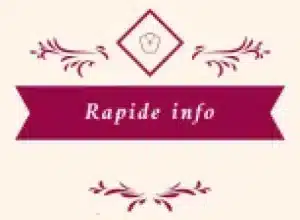Rapport 2022-2023 de la Cour des comptes : entre rigueur nécessaire et excès médiatique
Le rapport 2022-2023 de la Cour des comptes secoue l’administration mauritanienne, entre transparence louable et méthode contestée.

Nouakchott – Le rapport 2022-2023 de la Cour des comptes secoue l’administration mauritanienne. Nécessaire dans sa mission, il regroupe les constats majeurs issus des missions de contrôle, les réactions des ministères concernés et une évaluation des politiques publiques conduites.
Mais parfois excessive dans sa méthode, l’institution semble avoir privilégié le bruit médiatique à la rigueur du dialogue administratif, au risque d’altérer la portée pédagogique de son travail.
Un pilier du contrôle public, pas une institution sacrée
En Mauritanie, la Cour des comptes reste la vigie des finances publiques, gardienne de la transparence et de la bonne gouvernance. Sa mission est essentielle : auditer, corriger, alerter. Elle rappelle que chaque ouguiya dépensée doit être justifiée et que l’État n’est pas un coffre sans clé.
Mais il faut le dire clairement : les observations de la Cour ne sont pas des vérités absolues. Elles constituent des analyses, parfois pertinentes, parfois discutables, toujours perfectibles.
Or, dans son rapport 2022-2023, la Cour semble avoir endossé le rôle de procureur plus que celui de juge des comptes, s’exposant ainsi à des critiques sur sa méthode et son ton.
Cette perception se renforce à la lecture de certains exemples précis, où la frontière entre contrôle administratif et mise en cause publique paraît s’être estompée.
L’hôpital de Rosso, un cas révélateur
Le ministère de la Santé, et plus particulièrement l’hôpital de Rosso, se retrouve au centre des observations de la Cour des comptes pour une enveloppe d’environ 40 millions d’ouguiyas, allouée en urgence afin d’assurer la couverture médicale, le fonctionnement des ambulances et l’approvisionnement en médicaments essentiels.
Sur le plan comptable, certaines écritures peuvent prêter à confusion. Cependant, la Cour, dans son rapport, formule ses critiques sans nuance en période de confinement et d’apparition de nouveaux variants, laissant planer un soupçon injustifié sur des cadres compétents du ministère, étrangers à toute décision budgétaire et qui n’étaient ni ordonnateurs ni signataires des opérations incriminées.
Les réponses fournies par ces responsables apparaissent pourtant précises, étayées et cohérentes, démontrant une volonté claire de transparence et de collaboration.
Un contrôle rigoureux demeure nécessaire, certes, mais il ne doit jamais se muer en mise au pilori publique. En l’occurrence, la démarche de la Cour semble s’être éloignée de sa vocation d’évaluation administrative pour glisser vers une orchestration médiatique, où l’exposition publique supplante la rigueur institutionnelle.
Cette méthode unilatérale, notent plusieurs observateurs, préfigure un manquement plus préoccupant encore : l’absence de mise en demeure préalable avant la publication du rapport, une étape pourtant essentielle pour garantir le respect du contradictoire.
Une procédure écourtée qui interroge la méthode de la Cour des comptes
Selon plusieurs sources concordantes, la Cour des comptes n’aurait pas adressé de mises en demeure préalables avant la publication de son rapport. Or, cette étape constitue une garantie essentielle du droit de réponse : elle permet aux administrations concernées de présenter leurs explications, de corriger d’éventuelles erreurs factuelles et d’éviter que l’opinion publique ne se forge une image biaisée de leur gestion.
En écartant cette phase contradictoire, la Cour fragilise le fondement même du contrôle public, qui repose sur l’échange, la transparence et la proportionnalité. Le rapport perd alors sa vocation première d’outil de réforme et de gouvernance pour se transformer en document de communication, davantage orienté vers l’impact médiatique que vers la pédagogie institutionnelle.
Une telle démarche comporte un double risque : celui de miner la crédibilité de la Cour elle-même et d’affaiblir la confiance des citoyens dans le processus de reddition des comptes – un pilier pourtant essentiel de la démocratie administrative.
Contrôler, oui. Délégitimer, non.
La transparence est un pilier de toute démocratie, pas un instrument de mise en scène ou de règlement de comptes.
Le rôle de la Cour des comptes n’est pas de stigmatiser, mais de corriger. Son rapport devrait éclairer l’action publique, non alimenter la suspicion. Il devrait encourager la réforme et la responsabilité, plutôt que décourager l’initiative et le sens du service.
En transformant la reddition des comptes en tribune médiatique, la Cour prend le risque d’affaiblir ce qui fait sa force : sa crédibilité morale et sa neutralité institutionnelle.
Le contrôle n’a de valeur que s’il suscite la confiance. Or, celle-ci se construit sur la rigueur, la mesure et le respect du contradictoire.
C’est dans cet équilibre entre exigence et équité que le contrôle public trouve sa véritable légitimité et contribue réellement à la transparence de l’État.
Une institution clé, mais une méthode à rééquilibrer
Malgré les controverses qu’il suscite, le rapport 2022-2023 de la Cour des comptes reste un maillon essentiel de la gouvernance publique. Il dresse un diagnostic précis des faiblesses structurelles de l’administration mauritanienne et propose un ensemble de recommandations qui, si elles étaient mises en œuvre, pourraient renforcer la transparence et la performance de l’État.
Parmi ces orientations, figurent notamment :
la redynamisation des systèmes de contrôle interne au sein de toutes les entités publiques ;
le respect scrupuleux des lois, codes fiscaux et procédures de passation des marchés ;
la mise en place d’une comptabilité fiable et transparente, adossée à des inventaires réguliers du patrimoine public ;
la garantie de la traçabilité des projets financés par des ressources extérieures ;
le respect rigoureux des normes environnementales dans les secteurs minier, pétrolier et gazier ;
la désignation des gestionnaires sur la base de la compétence et de l’intégrité ;
la promotion d’une véritable culture du résultat et de la responsabilité administrative.
Ces orientations vont dans le bon sens. Elles traduisent une volonté de modernisation réelle, mais mettent aussi en lumière les défis profonds auxquels l’État reste confronté : une bureaucratie encore lourde, une coordination institutionnelle souvent défaillante et un suivi insuffisant des politiques publiques.
Pour une culture du contrôle juste et équilibrée
La Mauritanie a besoin d’une Cour des comptes forte, respectée et respectueuse – une institution capable d’alerter sans stigmatiser, de critiquer sans déformer, et de sanctionner sans céder à la tentation du spectacle.
Car la protection des deniers publics repose avant tout sur la crédibilité des institutions, non sur le bruit médiatique.
Le contrôle est indispensable. Le dénigrement, inutile.
La transparence n’est pas une mise en scène, c’est une culture qui se construit patiemment, dans la rigueur et le respect du contradictoire.
C’est à ce prix que la Cour des comptes pourra redevenir un levier central de la modernisation apaisée, crédible et durable de l’État mauritanien.