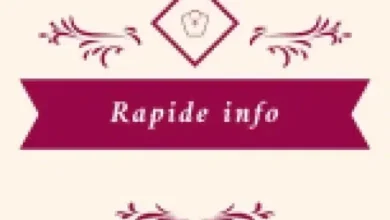Biram Dah Abeid : Paris, héritages croisés et enjeux mauritaniens
Analyse des propos de Biram Dah Abeid à Paris, entre mémoire coloniale, identité beydane et recomposition politique en Mauritanie.

Depuis Paris, Biram Dah Abeid évoque justice et alliances. Mais son discours sur les « Beydanes » révèle les tensions entre héritage colonial, identité culturelle et stratégie politique mauritanienne. Analyse de Mohamed Ould Echriv Echriv.
Dans son message depuis Paris, Biram Dah Abeid se place dans une rhétorique où la ville des Lumières est présentée comme le berceau des luttes héroïques des peuples opprimés. Mais l’anthropologue averti sait que Paris est aussi – et peut-être surtout – l’un des hauts lieux où furent scellées les décisions stratégiques qui ont façonné, morcelé, et parfois brisé les trajectoires politiques, économiques et culturelles des pays africains. S’il y eut des voix de justice dans les salons intellectuels, il y eut aussi, dans les bureaux de ses ministères et de ses conseils coloniaux, des cartographies froides où l’Afrique fut découpée, segmentée et administrée. L’histoire ne permet donc pas de simplifier Paris à un simple creuset de liberté : il est également la forge où se sont affûtées les lames de l’ordre colonial. Ce double héritage invite à interroger l’intérêt que Biram souhaite voir la France préserver, intérêt qui oscille entre reconnaissance internationale et recherche d’alliances pour peser sur la scène mauritanienne.
L’un des passages les plus polémiques de son texte tient à sa désignation des « Beydanes ». Ici, l’anthropologie sociale et l’histoire mauritanienne imposent de rappeler que le terme beydane contrairement à ce que croit Biram ne désigne pas une couleur, mais une culture, celle façonnée par les Hassans et leur matrice poético-guerrière. Être beydan, c’est appartenir à un système de valeurs, à un habitus linguistique et à une esthétique sociale codifiée par la langue hassaniya, la poésie de l’azawan, l’éthique des nomades. On peut y accéder par immersion culturelle, quelle que soit son origine biologique.
L’exemple de Doudou Seck est à cet égard éclairant. Fils de Bou el Moghdad, ancien interprète de Faidherbe, et de Coumba Anne, il fut envoyé, à l’âge de neuf ans, dans le Trarza, chez les Oulad Dayman, fraction des Idabum, auprès de la famille des Ahl Lamana. Là, il apprit la langue, les codes et les subtilités de la culture beydane jusqu’à en devenir l’un des représentants les plus éloquents, ambassadeur et défenseur d’un héritage qui, à ses yeux, transcendait toute référence à la couleur de peau. La culture beydane se transmet comme se transmettent les arts de la tente, du verbe et du geste : par apprentissage, par adoption, par imprégnation.
Comprendre la Mauritanie impose donc de dépasser les lectures figées en termes de pigmentation pour se plonger dans la fluidité de ses structures sociales. Comme l’écrivait le poète de la Nation Ahmedou Ould Abdel Kader dans « La Tombe inconnue », au cœur de la société maure réside la capacité au changement de rôle : les marabouts peuvent devenir guerriers, les guerriers marabouts, et les Znaga accéder au rang noble, selon les contextes historiques et les recompositions du pouvoir. Cette plasticité des statuts est aussi vraie pour la culture : celui qui désire et maîtrise ses codes devient en droit un beydan.
Dans son discours, Biram affirme que la domination n’a pas de couleur. Cette affirmation, sur le plan analytique, est juste, car le pouvoir, en Mauritanie comme ailleurs, se nourrit de réseaux, de clientèles et de capital symbolique plus que de teinte épidermique. Mais elle heurte frontalement la ligne de certains de ses partisans les plus radicaux, qui structurent leur lecture politique autour d’un schéma binaire où le « blanc » dominerait nécessairement le « noir ». Or, en érodant ce schéma, il risque de perdre une partie de cet électorat, pour qui la lutte se définit avant tout comme un affrontement chromatique.
S’il souhaite élargir sa base en y intégrant une frange des beydans, il lui faudra aussi affronter un autre défi : celui de la mémoire orale. La société maure est un monde où le verbe a une densité presque sacrée, où l’oralité fonctionne comme un registre officiel de la mémoire collective. Dans ce contexte, les propos passés où il a associé le terme « beydan » à des qualificatifs injurieux demeurent vivants dans les consciences. L’adage hassanien rappelle : « La plaie se cicatrise, mais la mauvaise parole ne guérit pas ». Sans un geste de clarification, voire d’excuse, ce passé verbal pourrait freiner toute tentative de rapprochement.
Le message de Biram, au-delà de ses accents de dénonciation, se situe donc dans une tension anthropologique profonde : comment mobiliser un imaginaire de justice et d’égalité qui transcende les appartenances, tout en respectant les sensibilités mémorielles et les identités culturelles façonnées par des siècles d’histoire ? La réponse, s’il la trouve, pourrait déterminer sa capacité à passer du registre de la contestation à celui de la recomposition nationale.
Mohamed Ould Echriv Echriv