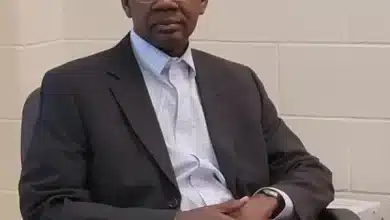Béchir Ben Yahmed et les despotes du continent (3/5)

Béchir Ben Yahmed et les despotes du continent (3/5)
03 mai 2021 à 16h28 | Par Christophe Boisbouvier Mis à jour le 03 mai 2021 à 19h43
« Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Jeune Afrique » (3/5). Censure, finances, Houphouët, Hassan II, Ben Ali, Mobutu, Chirac… Entretien exceptionnel avec Béchir Ben Yahmed, fondateur de « Jeune Afrique ».
Nous republions cet entretien avec Béchir Ben Yahmed, initialement réalisé en novembre 2010 à l’occasion des 50 ans de Jeune Afrique. Le fondateur du journal, décédé ce 3 mai 2021 à l’âge de 93 ans, y revenait alors sur cinq décennies de l’histoire du continent, ses relations avec les personnalités africaines et sa vision du journalisme.
Jeune Afrique : De tous vos éditoriaux et « Ce que je crois », quel est celui dont vous êtes le plus fier ?
Je suis fier de l’un de mes premiers éditos, qui m’a valu l’ire de Bourguiba, auquel pourtant je vouais un grand respect et qui m’aimait beaucoup. C’était en 1961.
Il a été publié sous le titre « Le pouvoir personnel ». Et il est resté célèbre à ce jour : j’y stigmatisais la concentration de pouvoir entre les mains d’un homme. Fût-il éclairé, le despote finit toujours par devenir dictateur…
Un édito qui vous a coûté cher, puisque Jeune Afrique a dû déménager en Europe…
Oui, ça nous a coûté cher, mais je m’y attendais. Ma ligne, c’était de nous opposer au concept dominant du parti unique. Le parti unique, c’était la règle dans une grande partie du monde. En tout cas, en URSS, à Cuba et dans l’ensemble du Tiers Monde.
Je n’y ai jamais adhéré et je m’en félicite : j’ai déchiré ma carte du Néo-Destour quand il est devenu parti unique. C’était instinctif. Nous étions les seuls dans le Tiers Monde à nous opposer au parti unique. Même dans les démocraties, nombreux étaient ceux qui, comme Chirac, soutenaient que c’était une étape nécessaire : « Ces gens-là ont besoin de cette forme autoritaire de pouvoir, ils ne peuvent pas se développer sans cela. »
En 1967, en pleine guerre du Vietnam, quand vous allez interviewer Pham Van Dong à Hanoi, n’êtes-vous pas fasciné par le parti unique vietnamien ?
Non, pas du tout, j’étais fasciné par la lutte de ce peuple, et à juste titre. J’étais fasciné par ce combat de David contre Goliath, et ce que j’ai vu là-bas, sous les bombardements des B-52, a renforcé mon admiration. À l’époque, j’ai été le seul non-communiste, voire anticommuniste à être reçu par Ho Chi Minh et Pham Van Dong ensemble. Quand « l’oncle Ho » est venu à ma rencontre, je l’ai salué en disant « monsieur le président ». Il m’a dit : « Si vous êtes communiste, appelez-moi camarade. » J’ai dit : « Non, je ne suis pas communiste. » « Cela ne fait rien, si vous êtes anti-impérialiste, appelez-moi camarade. »
Comme moi, beaucoup d’Africains – et non des moindres – étaient sensibles à l’héroïsme des Vietnamiens et à leur génie militaire.
À mon retour du Vietnam, j’ai rapporté dans mes articles ce que j’avais vu et ressenti. Peu après, le président camerounais, Ahmadou Ahidjo, que je ne connaissais pas à l’époque, a dépêché au journal un émissaire pour me faire dire : « Merci beaucoup. Vous dites et vous écrivez ce que nous ne pouvons pas dire, et vous exprimez notre pensée. »
C’est une facette d’Ahidjo qu’on ignore complètement car, officiellement, il était dans le camp américain.
Oui, j’étais épaté. Il m’avait envoyé quelqu’un de Yaoundé juste pour me dire ça. Nous véhiculions donc en Afrique une sensibilité qui n’était exprimée par personne.
Quand les Chinois ont fait exploser leur bombe atomique en 1964, j’ai écrit un édito d’approbation, de fierté. Pour la première fois, une puissance non blanche arrivait pratiquement toute seule au nucléaire militaire par sa technologie. Tous mes amis français – je m’en souviendrai toute ma vie –, dont le socialiste Alain Savary, m’ont dit : « Comment, vous, Béchir, pouvez-vous écrire cela ? Ce n’est pas possible ! » Et pourtant, c’est ce que je ressentais. C’est ce que ressentaient tous les peuples du Tiers Monde. Que la Chine soit communiste ou non, ce n’était plus le problème. Elle faisait notre fierté. Et ça, c’est impossible à faire comprendre à un Européen.
C’est vrai que, dans vos éditos d’il y a vingt ou trente ans, vous anticipiez la montée en puissance de l’Asie. Comme Alain Peyrefitte. Quels sont, en revanche, les éditos où vous vous êtes trompé ?
Sans fausse modestie, je vous réponds : il n’y en a pas beaucoup. Mais j’ai sous-estimé la résilience, comme on dit en anglais, de Hassan II et de Kadhafi. Jamais je n’aurais pensé que Kadhafi tiendrait quarante ans. Je pensais que ces hommes d’État faisaient fausse route et qu’ils ne pouvaient pas durer. Or cela s’est révélé inexact. Si on sait y faire, on peut être dans le tort et durer. C’est aussi le cas de Fidel Castro. J’ai pris mes désirs pour des réalités. C’est un écueil que nous, commentateurs, devons éviter. J’ai appris ça.
Les astrologues ont une explication : ils disent qu’ils sont « protégés » ; toute tentative pour les écarter est vouée à l’échec.
Sinon, très franchement, stratégiquement comme vous dites, je crois qu’on allait dans la bonne direction : les causes que nous avons soutenues étaient généralement les bonnes. À l’inverse, les idées et les hommes que nous avons combattus – Bokassa, Idi Amin Dada, Sékou Touré, Mobutu ou Kadhafi – étaient de piètres dirigeants.
Quand Houphouët s’est montré compréhensif avec l’apartheid de Vorster, nous avons dit notre désapprobation.
N’avez-vous pas sous-estimé la force montante des extrémistes islamistes et d’Al-Qaïda ?
Oui, et le seul qui m’ait corrigé là-dessus, c’est le président Ben Ali. Au début, j’étais sensible à leur combat. Avec leur petite internationale, je les ai tout de suite comparés aux communistes. Quand ils venaient me voir, à Tunis ou à Paris, ils se déplaçaient toujours par deux, comme les communistes : l’un surveillait l’autre, témoignerait, le cas échéant, pour ou contre lui.
Ils m’ont paru intègres, détachés de l’argent. Cela m’a impressionné, cela m’impressionne toujours.
Les gens d’Ennahdha ?
Oui, et un beau jour, en 1990, leur chef, Rached Ghannouchi, qui avait été interviewé par Hamid Barrada dans les locaux de Jeune Afrique, est venu me voir et m’a dit : « Je veux me réconcilier avec Ben Ali. Pouvez-vous m’aider à organiser ça ? » À l’époque, il était déjà en exil à Paris et à Londres. Il m’a séduit et j’ai accepté de faire quelque chose.
J’ai téléphoné de Paris à Ben Ali. Je lui ai dit : « Ghannouchi me dit être prêt au dialogue, est-ce que vous acceptez de le voir ? » Il m’a dit : « Je ne veux pas parler de cela au téléphone, venez me voir. » Ce que j’ai fait. Il m’a alors dit : « Si Béchir, vous vous trompez complètement. Ghannouchi se présente comme un modéré, il vous fait croire qu’il est modéré. Mais il n’y a pas d’islamiste modéré ! Cela n’existe pas. Où ils font semblant d’être modérés, et c’est de la duplicité, ou bien ils le sont, et alors ils se font éliminer. » Et il m’a ouvert les yeux. J’ai constaté par la suite qu’il avait raison sur ce plan. Ben Ali est un connaisseur, un vrai expert en matière d’islamisme.
Aujourd’hui, pensez-vous que ce mouvement risque de durer ?
Je pense d’abord que c’est une maladie de l’islam. Et que les musulmans devraient s’en préoccuper davantage pour en guérir. Les membres d’Al-Qaïda sont des musulmans exaltés, intégristes, mais, contrairement à ce que certains pensent, ce sont des musulmans, et qui se croient meilleurs que les autres. Les hommes qui ont commis les attentats du 11 septembre 2001 sont des musulmans. J’ai lu le texte testamentaire de Mohamed Atta, leur chef, qui pilotait l’un des avions qui ont percuté les Twin Towers, c’est un vrai musulman, pas un fou ni même un exalté. Il était déterminé à tuer et à mourir.
Quand vous acceptez de tuer indistinctement trois milles personnes – juifs, musulmans, chrétiens… –, quand vous faites du terrorisme aveugle, ce n’est pas acceptable et cela ne peut pas marcher à la longue. Cela ne peut que rassembler contre vous de plus en plus de gens.
Et moi, comme presque tout le monde et tous les musulmans, je n’accepte pas ça par principe.
J’ai toujours su que les islamistes radicaux n’auraient pas les musulmans avec eux. Mais si 5 % des musulmans les soutiennent, cela fait déjà 150 millions de personnes. Je pense qu’ils ont eu, au début, 5 % de sympathisants parmi les musulmans. Mais, au fil des années, ils les ont perdus. Aujourd’hui, c’est une toute petite minorité de desperados qui va faire du mal et durer longtemps.
Longtemps ? Combien de temps ?
J’ai la faiblesse de croire – un petit peu, pas complètement – à l’astrologie. Des astrologues ont indiqué, il y a près de quinze ans, que cela allait durer quelque vingt-cinq ans. L’analyse politique donne la même durée : le mouvement devrait se rétracter ou s’étioler dans la décennie 2011-2020.
Al-Qaïda existe encore, a une résonance, sévit ici et là, mais elle est dans une impasse stratégique.
Y a-t-il des régimes que Jeune Afrique a contribué à faire tomber ?
Je pense que nous avons contribué à contenir les effets néfastes du régime de Sékou Touré, même s’il est mort au pouvoir. Jeune Afrique, et pas seulement par l’action de Siradiou Diallo, a contribué à ouvrir les yeux d’une partie des Africains sur cette dictature ignoble, mais aussi sur les dérapages de Mobutu et de Bokassa.
Je pense qu’actuellement Jeune Afrique joue un rôle important pour faire comprendre aux Africains que Kadhafi, c’est une fumisterie.
Au Mali, beaucoup pensent que nous avons aidé à faire tomber Moussa Traoré, en 1991. Avant son arrivée au pouvoir, je me souviens qu’ATT, alors colonel et inscrit à l’École de guerre à Paris, a voulu venir nous voir à Jeune Afrique. C’était un samedi, donc c’était fermé, et on ne l’a pas vu. Mais après son coup d’État de mars 1991, il est revenu à Paris et nous a rendu visite. Il m’a dit : « Vous nous avez beaucoup aidés à faire tomber la dictature et à instaurer la démocratie au Mali. Nous avons une dette envers vous. » Et pendant cette année de transition où il a gouverné, je l’ai incité à ne pas revenir tout de suite, à attendre. Je crois avoir été écouté à titre personnel, car il avait de l’amitié pour moi, et me faisait confiance. C’est un vrai démocrate.
C’est-à-dire que, quand ATT part volontairement du pouvoir en 1992, vous faites partie des gens dont il a écouté les conseils ?
Oui, je pense qu’il nous a également écoutés pendant la période où il a eu une relation délicate avec Alpha Oumar Konaré, devenu président du Mali.
Ce dernier a trouvé le meilleur moyen qu’on puisse imaginer de reconnaître notre modeste contribution à l’avènement de la démocratie malienne en nous invitant, ma femme et moi, à partager avec lui et son épouse, Adame Ba, leur dernier dîner à la présidence. À l’issue du repas, le plus démocratiquement du monde, il a passé le témoin à ATT, qui venait d’être élu, et a quitté la présidence, mission accomplie, sans chauffeur ni garde du corps, pour redevenir un citoyen honoré.
Quoi de plus beau et de plus rare en Afrique qu’une telle pratique de la démocratie.
Entre Diouf et Senghor, il y a eu aussi des relations difficiles, après que ce dernier eut volontairement quitté le pouvoir. Tout au long des années 1980, leurs entourages les montaient l’un contre l’autre, et je pense avoir joué un rôle de facilitateur. Comme entre Alpha et ATT, je crois. Vous savez, les entourages sont très néfastes…
Y a-t-il des gens que Jeune Afrique a aidés à sortir de prison ?
Oui, il y en a certainement. Dès 1960, nous avons aidé la Mauritanie, et d’une manière assez efficace, je crois. Elle était menacée par le Maroc, et c’est le président Bourguiba qui, le premier, l’a soutenue contre ce qui apparaissait alors comme de l’hégémonisme marocain. Je ne connais pas ses motivations, mais il nous a inculqué cela. La Mauritanie était une sorte de protégée de la Tunisie, et moi, je voulais connaître Moktar Ould Daddah. Je suis allé là-bas, il m’a décoré – à l’époque c’était une mode et Senghor l’avait fait avant lui, ainsi que le maréchal Tito de Yougoslavie. Depuis, je me suis fait une règle de n’accepter aucune décoration. Moktar Ould Daddah et moi sommes devenus amis.
En 1978, victime d’un coup d’État, il a été enfermé dans un fort très éloigné de la capitale. Par chance, à ce moment-là, j’ai rencontré Giscard avec quatre ou cinq de mes collaborateurs, dont Hamid Barrada et Siradiou Diallo, alors condamnés à mort dans leurs pays, ce qui a horrifié Giscard quand je le lui ai révélé. Il m’a demandé à la fin de l’entretien : « Qu’est-ce que je peux faire pour que l’opinion africaine se rende compte du rôle positif de la France ? » Il s’apprêtait à se rendre en Guinée pour sceller la réconciliation avec Sékou et voulait que Jeune Afrique soutienne sa démarche. Je lui ai dit : « Il y a une initiative facile que vous pouvez prendre. Un chef d’État respecté, intègre, Moktar Ould Daddah, que des militaires ont déposé, croupit actuellement dans un cachot. La France a les moyens de le sortir de là et de l’héberger. » Je lui ai dit : « Vous pouvez même faire cela avec le président Bourguiba, qui est actuellement hospitalisé en Allemagne. » Il l’a fait dans la semaine.
Ould Daddah a été libéré. Il est arrivé à Paris en plein hiver, en boubou, et sans même un sous-vêtement ! Je me souviens que Jacques Foccart, qui n’était plus en fonction à l’époque, est allé lui acheter un costume. Moktar Ould Daddah était malade et a été opéré au Val-de-Grâce. Après un ou deux mois, les militaires mauritaniens de l’époque ont regretté leur geste et ont eu le mauvais goût de dire à Giscard : « Maintenant que les soins médicaux sont terminés, vous nous le ramenez. » Giscard a eu une très belle réponse : « La France n’est pas une annexe des prisons mauritaniennes. » Il a donc refusé.
Plus tard, Giscard, Houphouët et Hassan II ont pensé le faire revenir au pouvoir. Ils l’ont même convoqué à une réunion. Mais il n’a pas marché. « Je ne suis pas David Dacko », leur a-t-il dit, se référant à l’homme que Giscard a installé à la place de Bokassa.
Source: Jeune Afrique