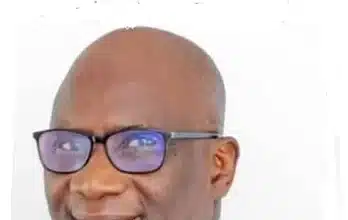Aziz, Bouamatou et Ghazouani : du pouvoir à la réconciliation, la Mauritanie face à ses fractures
De l’amitié à la rivalité, le parcours d’Aziz, Bouamatou et Ghazouani illustre les fractures du pouvoir mauritanien. Mais sous Ghazouani, une ère d’apaisement et de réconciliation semble possible.

Les alliances les plus solides ne résistent ni aux circonstances ni aux ambitions
En Mauritanie, les amitiés politiques se construisent souvent sur le sable mouvant du pouvoir. L’histoire croisée de Mohamed Ould Abdel Aziz, Mohamed Ould Bouamatou et Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani en est l’illustration parfaite. Trois destins, trois trajectoires intimement liées, unis à un moment par la fraternité, puis séparés par les calculs, les ambitions et les malentendus du pouvoir.
Une fraternité d’armes devenue ligne de fracture
Mohamed Ould Abdel Aziz et Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ont longtemps formé un duo inséparable. Compagnons d’armes, frères de caserne et co-auteurs du coup d’État du 6 août 2008, ils partageaient la même vision d’un État fort, souverain et débarrassé de la corruption. Ensemble, ils ont bâti le socle d’une nouvelle ère politique, où le pragmatisme militaire s’imposait face à l’instabilité civile.
Mais les dynamiques du pouvoir ont peu à peu fissuré cette alliance. En 2019, lorsque Ghazouani accéda à la présidence, l’ancien chef de l’État espérait demeurer l’ombre tutélaire du régime. Le nouveau président, fidèle à sa réputation de réserve et de sang-froid, préféra tracer sa propre voie, s’émancipant avec méthode des réseaux et des réflexes hérités du passé.
Cette indépendance provoqua une rupture totale avec Aziz, dont la chute politique et judiciaire fut aussi spectaculaire que son ascension.
Bouamatou, de l’allié intime à la conscience critique
Bien avant cette séparation, une autre amitié avait volé en éclats : celle entre Mohamed Ould Abdel Aziz et l’homme d’affaires Mohamed Ould Bouamatou. Financier respecté, mécène influent et ami de longue date, Bouamatou fut l’un des piliers économiques du pouvoir au lendemain du coup d’État de 2008. Ensemble, ils rêvaient de moderniser l’économie mauritanienne et d’en finir avec les vieux monopoles.
Mais l’entente se mua rapidement en défiance. Les divergences sur la gouvernance, la politique fiscale « politique des impôts », la transparence et la distribution du pouvoir économique creusèrent un fossé irréversible. Bouamatou prit le chemin de l’exil, d’où il mena une opposition discrète mais constante contre le système qu’il avait aidé à installer.
Aujourd’hui, de retour sur la scène nationale, il incarne pour beaucoup une figure de la réconciliation possible _ un acteur capable de peser sur la relance du dialogue et de l’investissement national.
Trois hommes, trois symboles d’une même transition
Les destins d’Aziz, Bouamatou et Ghazouani révèlent une vérité essentielle : la politique mauritanienne n’est pas figée, elle évolue par ruptures, rapprochements et reconfigurations.
Aziz reste le symbole d’une ère autoritaire et centralisée, marquée par la personnalisation du pouvoir. Bouamatou, celui du capital et du mécénat, incarne la modernité économique et la revendication d’une gouvernance plus ouverte. Ghazouani, enfin, s’impose comme l’artisan prudent d’une stabilité institutionnelle, misant sur le dialogue, la patience et la recherche du consensus.
Vers une réconciliation nationale ?
Aujourd’hui, alors que le pays aspire à tourner la page des rancunes personnelles et des divisions, la question de la réconciliation s’impose. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, sans effacer les contentieux du passé, semble vouloir ouvrir une ère d’apaisement.
Son approche, plus inclusive que celle de son prédécesseur, privilégie la concertation et la confiance mutuelle. Sous son impulsion, des passerelles ont commencé à se reconstruire entre l’État et les anciens opposants, entre le pouvoir et les milieux économiques, entre la justice et la politique.
Une réconciliation nationale réussie pourrait s’articuler autour de trois axes :
1. La vérité et la justice sans vengeance.
Il ne s’agit pas d’effacer les fautes ni de nier les responsabilités, mais de permettre une lecture partagée du passé. L’apaisement ne peut se construire que sur une reconnaissance lucide des excès et des injustices.
2. Le dialogue économique et social.
Les fractures ne sont pas que politiques : elles sont aussi sociales et territoriales. Un cadre de concertation entre les acteurs économiques, politiques et civils permettrait de replacer le développement national au cœur du consensus.
3. Le dépassement des égos politiques.
La Mauritanie a souvent été prisonnière de rivalités personnelles. L’enjeu aujourd’hui est de bâtir des institutions capables de survivre aux hommes, et non des hommes dépendants des institutions.
Un horizon encore fragile, mais possible
Dans cette perspective, la figure de Ghazouani apparaît comme celle d’un équilibriste : entre loyauté militaire et légitimité démocratique, entre prudence politique et volonté de réforme.
Sa stratégie d’apaisement, patiente mais ferme, vise à transformer les antagonismes en dialogue, et les rancunes en opportunités de reconstruction nationale.
La réconciliation entre anciens frères d’armes, anciens partenaires économiques et anciens rivaux politiques ne se décrète pas. Mais elle pourrait bien être la clé pour consolider la démocratie naissante, attirer la confiance des investisseurs, et offrir à la Mauritanie une respiration politique nouvelle.
Conclusion : des leçons d’hier pour la paix de demain
De l’amitié perfide à la rivalité politique, le parcours d’Aziz, Bouamatou et Ghazouani rappelle que le pouvoir, en Mauritanie, reste un champ d’épreuves humaines autant que stratégiques.
Mais il laisse aussi entrevoir une promesse : celle d’un pays capable de se réconcilier avec son passé, de rassembler ses forces vives, et de se tourner enfin vers un avenir fondé sur la confiance et la stabilité.
Car, en définitive, la grandeur d’une nation ne se mesure pas à la longévité de ses rancunes, mais à sa capacité à les dépasser.
Ahmed Ould Noah pour Rapide info