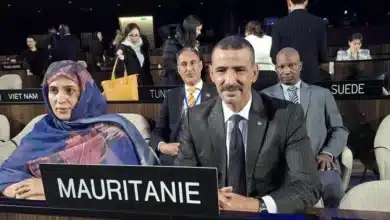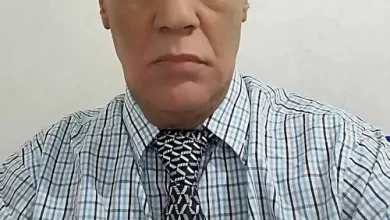Eywa : Quand l’arabe devient un instrument d’élimination : le cas Dr Aminata Diop et la mise à l’écart des élites noires mauritaniennes

Elimination
L’affaire de Dr Aminata Boubacar Diop n’est pas un simple incident administratif. C’est un symbole. Une gifle infligée au mérite, à la compétence, à l’équité. Et surtout, une énième démonstration que, sous couvert de critères linguistiques et de culture générale, la langue arabe est érigée en outil de sélection ethnique et d’élimination systématique des Noirs mauritaniens.
En recalant la seule femme neurochirurgienne du pays, après lui avoir infligé une mauvaise note en “culture générale arabe”, le système ne s’est pas contenté de commettre une injustice. Il a validé une logique d’exclusion. Une mécanique bien huilée où la langue arabe, au lieu d’unir les citoyens, devient un filtre idéologique et identitaire. Un barrage déguisé contre la diversité. Un permis de trier.
Comment peut-on justifier qu’un médecin hautement qualifié soit recalé pour une note en arabe, attribuée par un enseignant du primaire ? Comment peut-on accepter qu’une experte en neurochirurgie, maîtrisant le Pulaar, le Wolof et le Hassaniya, soit écartée au nom d’une soi-disant culture générale, dans un pays qui manque cruellement de spécialistes ? Cela n’a rien à voir avec l’excellence. Cela a tout à voir avec le racisme institutionnalisé.
Car l’enjeu est clair : maintenir le monopole des élites arabophones sur les postes stratégiques, même au prix de la médiocrité. Même au détriment de la santé publique. Même si cela signifie renvoyer chez elle l’unique neurochirurgienne d’un pays déserté par les compétences.
Le cas de Dr Diop n’est ni le premier ni le dernier. Il s’inscrit dans une longue tradition d’instrumentalisation de la langue : concours de la fonction publique biaisés, accès à l’enseignement supérieur filtré, absence de traduction des lois ou des examens, marginalisation des langues nationales africaines. L’arabe, dans ce contexte, n’est plus une langue nationale : elle est devenue un instrument politique d’épuration sociale.
Ce drame soulève une question simple : que vaut la maîtrise d’une langue quand elle écrase la justice ? Quelle est cette “culture générale” qui préfère un bon arabisant à un bon chirurgien ? Quelle est cette République qui piétine ses propres intérêts pour satisfaire une vision ethno-linguistique du pouvoir ?
Il est temps de dire les choses clairement : la langue arabe est utilisée comme un outil d’exclusion raciale. Pas par ses locuteurs en tant qu’individus, mais par un système qui l’a sacralisée au point d’en faire un totem identitaire, un critère de sélection ethnique, un marqueur de loyauté à un État unilingue qui refuse d’assumer sa pluralité.
Cette affaire doit réveiller les consciences. Il faut une réforme radicale des critères d’accès à la fonction publique, une reconnaissance réelle des langues nationales africaines, une évaluation fondée sur les compétences réelles et non sur des filtres idéologiques. Il en va de l’avenir du pays. Il en va surtout de la dignité d’une nation qui ne peut plus continuer à sacrifier ses enfants les plus brillants sur l’autel de l’exclusion linguistique.
–//////
Calame
-
janvier 2023
Le Dr Aminata Boubacar Diop, seule neurochirurgienne de Mauritanie, a été injustement recalée au concours d’entrée des spécialistes à la fonction publique, malgré une excellente note en neurochirurgie (moyenne de 15,25/20). La raison : une mauvaise note en arabe (culture générale), discipline corrigée par un enseignant du primaire. Selon le Dr Remy Kleïb, examinateur et lanceur d’alerte, tous les candidats admis sont arabes, ce qui illustre, selon lui, une discrimination raciale institutionnalisée. Le cas de Dr Diop a suscité une vive indignation dans un pays en manque de spécialistes. Des voix réclament désormais la révision d’un concours jugé injuste et biaisé.PJ