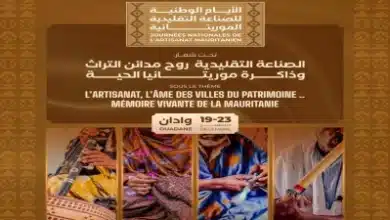Un an déjà. Et l’écho s’étiole. Leurs noms glissent entre les doigts d’un pays qui sait enterrer ses enfants, mais rarement les honorer.
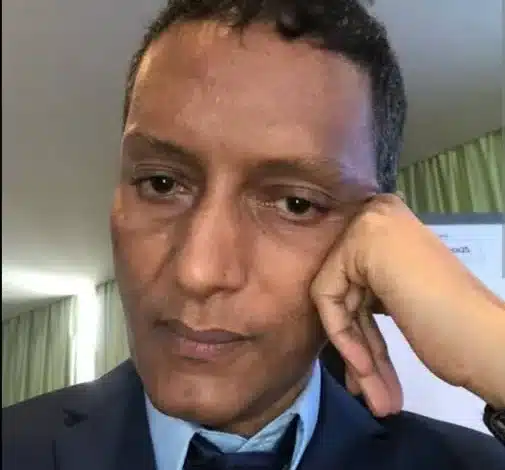
Un an déjà. Et l’écho s’étiole. Leurs noms glissent entre les doigts d’un pays qui sait enterrer ses enfants, mais rarement les honorer. Oumeïre. Kane. Ciré. Habib. Des noms qui appartiennent à cette race presque mythologique d’intellectuels mauritaniens dont la voix, le style, la pensée, étaient en avance sur l’époque, et hors d’atteinte du temps.
Ils sont partis. L’un après l’autre. En silence, ou presque. Et le pays, fidèle à sa posture tragique, n’a pas encore su graver leur héritage dans la pierre. Pas de bibliothèque, pas de centre culturel, pas de fondation, pas même une avenue qui respire leur œuvre. Seul Habib Ould Mahfoudh, maître des maîtres, prince de la prose et bretteur de l’ironie subtile, a vu son nom discrètement accroché à une ruelle de Tevragh-Zeina — comme si l’on pouvait contenir l’océan dans une flaque d’asphalte.
Mohamed Fall Ould Oumeïre, dit Mfo, journaliste lucide, conteur de vérité, stratège de l’ombre, fut bien plus qu’un observateur du pouvoir : il en était le miroir — parfois convexe, souvent loyal, toujours perçant.
Boubacar Kane, cet écrivain raffiné, romancier du silence et de la dignité, s’éclipsa à Dakar, sans cérémonie.
Avant eux, Abdoulaye Ciré Bâ, le camarade incorruptible, penseur politique engagé dès l’adolescence, combattant des idées, avait lui aussi tiré sa révérence.
Et encore avant, Habib, le seul dont le mot pouvait mordre comme un serpent et consoler comme un poème.
Tous, portaient un style, un souffle, une rigueur, un courage.
Tous, ont écrit pour bâtir, et bâti par l’écriture.
Mais tous, ou presque, sont partis sans que la République n’ose leur ériger autre chose qu’un tweet ou une couronne de plastique.
Et c’est alors qu’émerge, tel un veilleur dans la brume, la plume immense de Jemal Ould Yessa, ce diplomate-écrivain exilé à Abidjan, dont la langue brûle sans jamais blesser, et dont les textes sont trop rares pour être ignorés.
Dans un hommage déchirant, Jemal écrit pour Oumeïre, mais aussi pour lui-même — comme s’il savait que seul l’écrit peut contenir l’absence.
Il ne pleure pas. Il retrace. Il raconte les gestes, les inflexions, les ironies fines, les souvenirs de rébellion et de fidélité, les débats politiques déguisés en joutes amicales. Il peint un Oumeïre messager du risque, confident du pouvoir, mais surtout homme de constance, de culture, de raffinement.
Et dans ces lignes, nous lisons aussi une complainte plus large : celle d’une élite qui s’éteint sans que la société n’ait su, à temps, tirer profit de sa lumière.
Pourquoi aucune grande bibliothèque ne porte le nom de Kane ? Pourquoi aucun institut de journalisme ne s’appelle Ciré Bâ ? Pourquoi aucune école d’écriture ne s’inspire de la méthode Habib ?
Pourquoi les rues honorent-elles les dates mais oublient les esprits ?
Alors, que faire ?
Faire de leur absence une exigence. De leurs œuvres une boussole.
Et rêver, un jour, d’une Maison des Plumes, ouverte à Nouakchott, où l’on lirait leurs textes, où les jeunes viendraient apprendre ce que veut dire écrire sans trahir, penser sans plaire, militer sans quémander.
Un lieu où la pensée ne serait pas un luxe, mais un service public.
Ils sont partis, et le monde s’est refermé un peu. Mais leurs mots, eux, refusent la fermeture. Ils vivent, vibrent, murmurent encore — à condition qu’on sache écouter. Ou lire.
Et si la République ne sait pas leur dire merci, que les mots le fassent à sa place.
Ci- dessous le texte magistral de Jemal Ould Yessa
—————————————————————————
Certains de vos amis proches expirent à des heures voisines, presque de conserve. Le 4 juillet 2024 disparaissaient, respectivement à Nouakchott et Dakar, Mohamed Fall Ould Oumeïre et Boubacar Kane. Ils se connaissaient, de nom.
La posture fortuite de survivant vous impose de vous adresser à eux, en guise de politesse posthume à leur égard. Passé la stupeur et les primes pincées d’abattement que la faucheuse jette à profusion en travers de l’existence, vous accroche l’envie, non, le besoin primordial de griffonner quelques lignes de défense contre la mort, l’ennemi absolu, comme pour circonscrire le feu ravageur de l’amnésie, à défaut de le savoir éteindre. L’oraison funèbre est un témoin que se refilent les ardents de l’ici et les gisants de l’ailleurs. Elle rompt, opportunément, le tracé rectiligne de la finitude. Voici un genre à célébrer sans modération.
Oumeïre
Mohamed Fall Ould Oumeïre ou Mfo transbahutait un surnom déjà lourd de conséquences. L’illustre homonymie continue d’estampiller la mémoire du peuplement hassanophone de la décennie 1960. Certes, la réputation du regretté, journaliste précurseur, conseiller de l’ombre, faiseur d’opinion et arbitre des élégances dépassait le cadre de son Trarza natal. Jamais, peut-être, homme de presse mauritanien n’eut à fréquenter, autant, les divers compartiments de la société, des tréfonds de la ruralité, aux salons Nouakchottois où, des infusions de thé à l’alacrité contagieuse, s’égrène la marche du pouvoir d’Etat, avec son lot de marionnettistes invisibles, de prises et de déprises, de diversions et de soudaines ruptures. Aux côtés de feu Habib Ould Mahfoudh et de Ablaye Ciré Bâ, Oumeïre nous dépassait en analyse des enjeux partisans parce qu’il mesurait les acteurs et les concepts, sur le mode de l’objectivité. La familiarité aux animateurs du Makhzen et la divulgation de leurs déterminismes ataviques, conféraient, à ses jugements, un niveau de neutralité et de mise à distance que nos enthousiasmes d’activistes balayaient d’un revers de slogan. Quel que fût le danger induit, Oumeïre excellait à la couvaison d’un secret. Il savait parler au Prince du moment et vous revenir, porteur d’une réponse, quand il y en avait. Des camarades d’exil se reconnaîtront co-artisans de ces manœuvres précaires.
Ils se remémorent, de Oumeïre, le rôle de messager à risque, au surlendemain du putsch avorté du 8 juin 2003. Il devait, de notre part, persuader, trois piliers de la dictature, du soutien de la diaspora et des organisations des droits humains, si l’un d’eux prenait l’initiative d’en finir. Mfo, partenaire enjoué des malices que confèrent la fusion féconde de l’expérience et de la témérité, protesta de sa pudicité : « Et maintenant, vous me confiez de transmettre une proposition indécente » ! Il ne se doutait, qu’en parallèle, nous dupliquions la démarche par le canal d’un attaché militaire à Paris, hélas décédé depuis peu. Dès 2000, celui-ci acceptait de remettre, de notre part, au Chef d’état-major des forces armées, en guise d’incitation à agir, un exemplaire de la « Technique du coup d’Etat » de l’italien Curzio Malaparte, le diariste contemporain du fascisme. Chacun de nos émissaires s’acquitta de sa mission mais seul Oumeïre, lors d’un entretien furtif de fin d’année à Dakar, nous assura avoir bien remis la lettreverbale au Directeur général de la sûreté nationale (Dgsn). Ce dernier – je parviendrai à la confirmer plus tard – a entendu notre missive, sans la commenter, a fortiori, la prendre au sérieux. Après une salve de questions de routine sur les auteurs d’une telle prétention, il décida d’ignorer l’offre.
Voilà le Oumeïre avec lequel j’ai eu le privilège d’établir commerce. Notre rencontre inaugurale datait, crois-je, du 17 mars 1981, sur le muret sis en face de l’entrée du Lycée national. L’endroit abritait, au fil des récréations, agora permanente et favorisait, accessoirement, un riche nuancier de marivaudage. La veille, le coup d’Etat du 16 mars se terminait en débâcle. Autour de nous, tout à l’effervescence de leur soulagement, des centaines d’élèves soutenaient le Comité militaire de salut national (Cmsn) et dénonçaient l’impérialisme marocain. Ils réclamaient l’exécution de nos héros, les lieutenants-colonels Ahmed Salem Ould Sidi, Abdel Kader Ould Bah et les lieutenants, Moustapha Niang et Doudou Seck. Oumeïre, pétri de douleur, s’infligeait le masque de l’indifférence. Pourtant, nous nous comprîmes, au détour de nos tics corporels de révolte envers l’animosité du sort. Ce jour-là, l’hostilité du camp « patriotique » ne nous aurait permis de défendre la cause du multipartisme, à l’époque un gros mot et un délit. Le matin, Sidi Mohamed Ould Sidaty et Hassen Ould Moknass, s’y essayaient, en vain. Ils faillirent succomber au lynchage. Au cours de ce laps d’adversité, Oumeïre assista à mon apprentissage en politique et sut me guider. Assez vite, il résolut de m’encourager. La bienveillance de l’aîné, la passion qu’il vouait au chant lyrique des griots et l’exemplaire de « Guerre et paix » débordant alors de la poche de son boubou jalonnaient le préambule ludique de notre amitié. Le partage d’une francophilie décomplexée et la prospection de la belle vocalise nous rapprochaient d’une collusion artistique. Nous nous croisions souvent chez Ehl Abba et, en 1992, ne manquions une soirée de Malouma Mint Meidah, la muse de l’espérance démocratique.
Cependant le personnage bénéficiait de bontés en supplément, à commencer par la constance de sa loyauté. Je me rappelle la levée du corps de Habib Ould Mahfoudh à Paris, durant la première semaine de novembre 2001. L’automne de l’hémisphère nord et le lever matinal nous condamnaient, à souffrir crânement le frimas de la saison. Nous étions environ une dizaine d’anciens disciples de Habib, emmitouflés de lainage et perclus de chagrin, à nous recueillir face au cercueil point encore scellé. Nous sentions le café corsé et trahissions le désarroi, la confusion. Au terme de la brève sympathie en présence d’une nuée de croque-morts passe-murailles, un agent des pompes proposa, au groupe, de désigner à qui échoirait la rose écarlate, ornant la dépouille. J’observais les regards de connivence, de Oumeïre à Sid’Ahmed Ould Lab, les compagnons intimes du défunt. Oumeïre s’empara de la fleur qu’il rapporta en Mauritanie. Nul ne la lui osait contester.
Féru de poésie Hassaniya, imbattable dans le domaine de la généalogie du Trab Sudan et du Trab Elbidhane, sa souvenance recelait une infinité de références livresques et orales qui intimaient, à l’interlocuteur, l’écoute studieuse. Nous sortions, des occurrences de sa conversation, parfois honteux de traîner de si béantes lacunes au sujet de notre pays, de son histoire et de ses terroirs.
Une divergence insurmontable m’opposait, à lui, sur des détails, guère menus. Oumeïre appréciait la ferveur du nouvel hymne de la nation et s’accommodait du drapeau accident de peinture. Or, la dissonance concoctée par un musicien d’Egypte et le mélange de couleurs fruit du cauchemar d’un teinturier aveugle m’occasionnaient du navrement, en abondance. Finalement de dispute lasse, nous convînmes de n’en plus controverser. Nous désignions, l’objet de ce silence, du sobriquet « affaire Dreyfus des sables ». Lorsqu’un camarade flanchait ou accourait à la soupe, Oumeïre, taquin, mettait un point d’honneur à me prédire un sort identique : « Un autre repenti, à qui le tour prochain ? Vous n’êtes pas plus endurants que les Kadihine » ! Notre parlement polémique s’achevait, au milieu d’un festival de badinage mutuel, par un désopilant « qui vivra verra, même sans loupe ». Mfo admirait l’âpreté de Conscience et Résistance (Cr) mais reprochait, au groupuscule, une inclination « pathologique » à manipuler. Il n’hésitait à nous asséner l’admonestation puis l’adoucissait d’un compliment avare. De tempérament autant que d’éducation, Oumeïre n’aimait la confrontation, l’inimitié ni la profusion de l’anathème. Le tout-Nouakchott convoitait les joutes qu’il majorait de sa clairvoyance apaisante.
Mohamed Vall parti, cher cousin en Berbèrie, accepte, tu n’as pas le choix, l’épitaphe à ton fabuleux passage parmi nous : Adieu la qualité de la conversation, la gentillesse qui coule de source, le deymanisme retenu, la finesse de l’humour et l’ouïe délicate du mélomane !
Jemal ould Yessa dit Othman Sanhaji, Jacqueville, Côte d’Ivoire, 10 juillet 2024.
Mohamed Ould Echriv Echriv
·