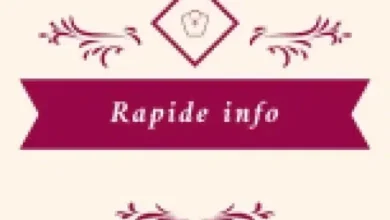A terre sur la rive ferme du dialogue/El Wely Sidi Heiba

A terre sur la rive ferme du dialogue/El Wely Sidi Heiba
La démocratie, loin d’être une option, est une exigence irréversible.
La classe politique mauritanienne, confrontée à des crises sociales, morales et idéologiques bien plus profondes qu’elle ne le perçoit, persiste dans le déni. Elle se complaît dans des joutes superficielles et stériles, sans qu’aucune lueur de consensus n’émerge à l’horizon.
Pourtant, l’opposition – dans sa diversité idéologique – comme la majorité au pouvoir – avec ses disparités internes – savent pertinemment qu’un véritable dialogue servirait leurs intérêts mutuels. Plus encore : qu’il est vital pour instaurer la stabilité sans laquelle aucune démocratie ne peut prendre racine. Mais leurs interactions restent évasives, loin des exigences d’un projet national sérieux. Car la démocratie ne se décrète pas : elle naît lorsqu’un État de droit fort garantit justice, sécurité et pérennité des institutions.
Ces querelles politiciennes, bruyantes mais dénuées de substance, trahissent une absence criante de vision. Elles peinent à s’inscrire dans un cadre de dialogue national capable d’éclairer les citoyens ou de fédérer autour d’enjeux essentiels. Un tel dialogue permettrait pourtant :
1. D’ancrer l’action politique dans des structures renforcées, où la participation populaire déterminerait les objectifs et les moyens d’action ;
2. De démocratiser réellement la vie publique, en institutionnalisant des partis fédérateurs, hiérarchisés mais égalitaires, fidèles à leurs propres textes fondateurs.
Si l’engagement politique se libérait du culte de la personnalité, de la centralisation excessive et des entendements obscurantistes, l’impasse actuelle se dissoudrait. Les forces vives du pays apprendraient alors à coexister, posant les bases d’une concorde nationale préservant à la fois l’État et les droits des citoyens.
Les mots « État » et « sécurité » peuvent sembler galvaudés. Pourtant, leur absence dans les priorités des décideurs – qu’ils soient rompus à la quête du pouvoir ou aigris par l’exclusion – constitue une bombe à retardement. À l’inverse, s’ils retrouvaient leur sens premier, ils deviendraient les pierres angulaires d’un État de droit capable d’assurer une prospérité partagée.
Dans cette « cécité politique » où dominent le noir et le rouge, où tout dialogue direct autour de la table de la patrie semble utopique, les élections démocratiques et les dialogues vertueux demeurent l’unique issue. Aucun camp ne peut légitimement les entraver – seules leur transparence et leur intégrité doivent être garanties par des moyens pacifiques et consensuels.
La démocratie n’est plus une option, mais une exigence irréversible. À l’ère du numérique et de l’information instantanée, les peuples refusent tout retour en arrière. La Mauritanie, partie intégrante de ce village planétaire, n’y échappera pas.
Seules les nations ayant surmonté leurs archaïsmes pour embrasser l’alternance pacifique forgent un avenir libéré des poids du passé. La Mauritanie doit choisir : engager sans tarder une réconciliation nationale digne de ce nom, ou risquer l’irrémédiable marginalisation.
Nos dirigeants politiques – au pouvoir comme dans l’opposition – entendront-ils l’appel de la raison et de l’histoire ? Sortiront-ils de leur léthargie pour préparer et asseoir un dialogue inclusif, seule porte d’entrée vers le monde moderne ? Comme l’a si bien déclaré un chef de parti : « Seule une consultation consensuelle, transparente et équitable, regroupant tout l’éventail politique, peut résoudre toute crise ou impasse. »
La barque mauritanienne parviendra-t-elle enfin à la terre ferme du salut démocratique, ou continuera-t-elle à dériver au gré des vents ?