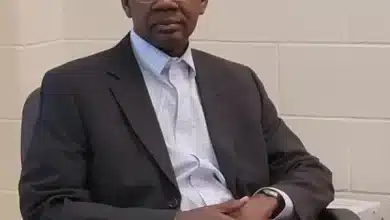« A New Road » pour penser autrement la dette de l’Afrique

« A New Road » pour penser autrement la dette de l’Afrique
INITIATIVE. À la veille du sommet sur le financement des économies africaines, des spécialistes du continent appellent à changer de paradigme dans l’approche de la dette.
D’un côté, l’administration Biden fait marcher la planche à billets, de l’autre, l’Europe, dans une moindre mesure, bénéficie d’un contexte qui rend le financement extrêmement compétitif dans la zone.
En résumé : la perception politique de la dette publique a, semble-t-il, profondément changé dans le monde. Et l’Afrique dans tout ça ? La bonne nouvelle, c’est qu’elle se mobilise fortement autour de la question. Et des acteurs aussi divers que les États, les institutions ou encore la société civile s’en sont emparés. La dette des économies africaines est désormais au centre de leurs débats.
Il faut dire que, depuis des mois, les institutions de Bretton Woods tirent la sonnette d’alarme. Relativement moins affectée que les autres continents sur le plan sanitaire par le Covid-19, l’Afrique n’échappe pas aux conséquences économiques de la pandémie qui risquent d’asphyxier les pays les plus fragiles et les plus endettés. Cela est d’autant plus vrai que les pays du continent ont dû affronter la crise avec des marges de manœuvre budgétaires bien plus étroites que les pays riches d’Europe, d’Amérique et d’Asie.
D’où la question de savoir comment, dans ce contexte, les États africains pourraient rebondir. Trouver des pistes de réponses à cette équation est devenu urgent. Et pas une semaine ne passe sans que des débats, des conférences, des colloques aient lieu pour en parler.
Vous avez dit dettes vertueuses ?
Le sujet est tellement pris au sérieux, il est si porteur d’un réel espoir de changement pour l’Afrique qu’un groupe de réflexion nommé « A New Road », exclusivement dédié aux questions des dettes publiques et du financement des économies africaines, vient d’être lancé à Abidjan, la capitale ivoirienne. « Les origines du think tank remontent au début de la pandémie. Nous sommes convaincus que par la diversité de nos profils peuvent émerger des propositions innovantes », a expliqué Nicolas Jean, membre du comité exécutif du cabinet d’avocats Gide. Autour de lui, des personnalités d’horizons divers, des ministres, des économistes, des experts et chercheurs.
Tout est parti du constat que « l’Afrique, loin d’être surendettée, est même sous-financée, voire mal financée ».
Pourquoi ?
Anne-Laure Kiechel à la tête de Global Sovereign Advisory et membre fondatrice du nouveau think tank A New Road explique : « Il y a des ressources. Ce n’est pas le sujet. C’est tout le paradoxe, indique-t-elle dans des échanges relatifs au coût de la dette. Mais encore faut-il que ce soit de la bonne ressource, précise-t-elle. Finalement, le sujet, c’est moins la dette que l’usage que l’on en fait. Une bonne dette est vertueuse pour les générations à venir, la mauvaise dette, qui est juste de l’accumulation de la mauvaise dépense, est un poids pour l’avenir », soutient la Française, ancienne de Rothschild et de Lehman Brothers.
Des explications qui viennent bouleverser l’idée que l’on se fait des dettes africaines estimées à 365 milliards de dollars. « Le coût de la dette africaine est certes élevé, mais représente à peine 2 % du stock mondial de la dette », répond d’emblée Sandra Ablamba Johnson, secrétaire générale de la présidence du Togo. « Ce qui veut dire que, si on veut vraiment accompagner l’Afrique, on peut faire mieux. » Et c’est exactement le but de ce think tank : mettre les pieds dans le plat.
Le mythe de l’Afrique surendettée
« L’idée même de ce think tank est de savoir, dans ce contexte de pandémie de coronavirus, comment les États africains vont financer leurs économies ? Vont-ils s’endetter davantage ? Ou inventer leurs modèles économiques ? » interroge Stanislas Zeze, PDG de Bloomfield Investment Corporation, l’une des seules sociétés de notation implantées sur le continent africain. « Il faut que l’on reste sur des règles universelles qui permettent aux Africains de mieux appréhender les questions de dette », poursuit-il.
« Le problème de fond est le suivant : qui détient la dette africaine ? » soulève Félix Edoh Kossi Amenounve, patron de la Bourse régionale ouest-africaine installée à Abidjan, la BRVM. « La question de la dette africaine est un véritable serpent de mer. Dans les pays comme la Chine, le Japon ou les États-Unis, elle est majoritairement détenue par les banques centrales (70 % au Japon ; 15,9 % aux États-Unis ) ou les institutions financières locales ainsi que les particuliers (57,5 % aux États-Unis) qui connaissent mieux le risque de leurs pays. La dette africaine est, quant à elle, détenue en grande partie par l’extérieur (21 % par la Chine et 31 % en eurobonds) avec une appréciation du risque réel ou perçu discutable », rappelle-t-il.
Déjà, à leur indépendance, dans les années 1960, plusieurs pays africains avaient hérité de dettes issues de la colonisation. Ils se sont également endettés auprès de la communauté internationale pour bâtir leurs nouveaux États. À cette époque, les taux d’intérêt étaient très bas, voire proches de zéro. Mais au fil des années, surtout après les chocs pétroliers, fin des années 1970, les taux sont montés en flèche. Conséquences : les pays africains se sont retrouvés à rembourser à des taux très élevés une dette qu’ils avaient contractée à des taux très faibles.
Dans ce contexte, alors qu’ils étaient déjà dans une situation d’insoutenabilité, les politiques d’ajustement structurel ont été mises en œuvre avec des prêts de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire international en échange de réformes pour libéraliser l’économie. Puis, à partir des années 2000, la Chine est arrivée, devenant, en l’espace d’une dizaine d’années, le premier créancier du continent.
Si les États africains se sont endettés à des taux d’intérêt variables, ils l’ont aussi fait dans des monnaies étrangères. « Aujourd’hui, le coût de la dette est réel », s’inquiète la ministre Sandra Ablamba Johnson. « Ce n’est pas que les Africains sont trop endettés, mais le coût constitue le pilier de cet endettement, justifie-t-elle. Nous avons assisté à l’accumulation, à la hausse des intérêts de 4 % à 12 % au moment où la croissance n’a pas suivi », pointe-t-elle.
Au-delà du moratoire et de l’annulation, quelle souveraineté pour les États ?
Des mesures ont bien été prises au niveau international, à l’instar de l’Initiative de suspension du service de la dette (ISSD) relative au report du remboursement de la dette publique. Le G20 s’est dit prêt à passer à la deuxième phase, à savoir renégocier les dettes elles-mêmes. Mais l’initiative a ses limites. L’Afrique fait face à une multitude de créanciers, ce qui rend tout accord de restructuration très compliqué. 40 % de la dette africaine est contractée vis-à-vis du secteur privé. Puis se sont ajoutées les créances dues à la Chine, qui ne fait pas partie du Club de Paris (réunissant les grands prêteurs étatiques).
Plusieurs pays n’ont pas hésité à afficher leur propre approche de la question, comme le Bénin. Ce petit pays d’Afrique de l’Ouest, endetté surtout auprès du secteur privé, s’est très tôt positionné contre le moratoire et l’annulation. Au motif de voir sa prime de risque exploser au moment de revenir sur les marchés.
Mais, attention, là encore la situation est très contrastée. Rien de commun, par exemple, entre la Zambie, premier pays africain à faire défaut sur sa dette mi-novembre, et la Côte d’Ivoire ou le Bénin, qui ont réussi haut la main leur émission obligataire. Les marchés ont-ils pour autant retrouvé de l’appétit pour le risque, en particulier africain ? La réponse n’est pas simple, mais une chose est sûre : le fait que de plus en plus de gouvernements réfléchissent à des propositions concrètes pour accéder à des financements à des conditions justes et adaptées oblige le marché et ses acteurs à mieux tenir compte de la souveraineté des États africains.
Pourquoi le paradigme doit changer
« Il faut qu’on change de paradigme ! » s’accordent à dire les intervenants réunis au très chic Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan. On ne va pas se le cacher, le think tank a dans son viseur les bailleurs de fonds. « Je crois que la nécessité réside, pour nos bailleurs de fonds, à changer de paradigme dans leur vision de l’endettement des pays africains, dans leur analyse du risque également. Et d’adapter leur pratique de financement aux besoins du continent », insiste Ghislane Guerida, directrice chargée de mission auprès du président-directeur général chez OCP, dans un message vidéo diffusé aux participants.
L’un des participants, Hamet Aguemon, associé chez SouthBridge, la banque d’affaires créée par Lionel Zinsou, ex-président du fonds d’investissement PAI Partners, également ex-Premier ministre du Bénin, et Donald Kaberuka, ex-président de la Banque africaine de développement (BAD), souligne également le rôle des agences de notation. « Aujourd’hui, les agences disent une chose : “Si tu as des ressources, si tu as de l’argent, tu ne vas pas payer cher. Mais si tu n’as pas d’argent ni de ressources, tu es taxé plus fort.” C’est un peu contradictoire », dit-il en citant les exemples de deux pays, le Bénin et l’Autriche. L’un qui emprunte à 6 % sur 30 ans et le second à 1 % sur 100 ans. « Les questions de dette concernent la souveraineté des États et la vérité c’est qu’on est seul. »
« La manière dont les agences de notation raisonnent est vraiment très illustrative de la bataille qui se joue actuellement entre l’ancien paradigme et le nouveau paradigme », esquisse Anne-Laure Kiechel. Si une économie africaine n’investit pas massivement dans sa jeunesse, elle fait une erreur fatale. Et pourtant, il n’existe pas de ratio ni de mesures par les agences de notation de combien est dépensé pour la jeunesse. Quelque part, si un gouvernement ne dépense pas pour la jeunesse, il ne sera pas sanctionné par les agences de notation. Ce n’est pas dans leur tradition. D’où cette nécessité de s’approprier nous-mêmes les bons ratios pour rendre l’économie efficace. »
Une réflexion holistique à tous les niveaux
« Un des plaidoyers est de revisiter les dispositions existantes pour voir dans quelle mesure nous pourrons défendre cette situation et permettre à nos États de bénéficier des taux de maturité relativement longs », juge Sandra Ablamba Johnson. Un constat que partage Ghislane Guerida : « Il s’agit aussi pour nos bailleurs de fonds d’appréhender le temps différemment dans ce contexte de développement structurel et de long terme. »
Le sujet de la pertinence de l’utilisation de certains ratios revient régulièrement dans les débats. Pour les intervenants, ils restreignent la capacité d’endettement de pays en pleine mutation économique. « Vous conviendrez avec moi que, si vous vous endettez sur une durée de cinq ans, vous aurez du mal à faire des infrastructures solides comme on le voit dans les pays asiatiques et d’autres. L’Afrique ne pourra que difficilement accéder à ce type d’infrastructures si elle doit se contenter de maturité aussi courte », explique Sandra Ablamba Johnson.
Pour Papa Amadou Sarr, délégué général à l’Entrepreunariat rapide des femmes et des jeunes au Sénégal, « il ne faut pas avoir peur de s’endetter. Il faut de la bonne dette qui crée de la valeur, de la croissance et de l’emploi », insiste-t-il. Pour l’experte Ghislane Guerida, « il s’agit de mener une réflexion holistique par chaîne de valeurs, et non pas par projet, afin d’accompagner des investissements qui se rentabilisent les uns les autres. Car l’enjeu, dit-elle, est de financer des projets à forts retours sur investissements, mais pas seulement monétaires. » « Nous visons des projets créateurs de valeurs pour nos populations », poursuit-elle.
Pour y parvenir, tous plaident pour des partenariats publics-privés revisités avec de nouveaux mécanismes plus innovants. « Il faut un développement inclusif. Sans inclusion, les taux de pauvreté ne vont pas évoluer », déclare Roselyne Chambrier, présidente directrice générale d’Arise Ivoire. « Tous les pays ont droit à l’endettement, mais, en face, il y a des responsabilités, comme le devoir de communication en direction des investisseurs et de la population », fait remarquer Jean-Marc Brou, conseiller du Premier ministre chargé des questions financières, du suivi de la dette et des risques financiers de la Côte d’Ivoire.
Hamet Aguemon, lui, insiste : « Il faut absolument innover, penser différemment sur le continent. Il faut prendre en compte la réalité économique et sociale ainsi que l’histoire de notre continent. Il faut s’approprier un financement qui répond à nos économies et à nos besoins. » Comment faire lorsque les gouvernements doivent « gérer des priorités, gérer l’efficacité de la dépense, gérer le suivi de la dépense et, si jamais il s’est trompé dans des dépenses, être capable de pouvoir les réallouer le plus rapidement possible dans la plus grande des flexibilités, le tout dans un plan cohérent », indique Anne-Laure Kieche, décrivant avec enthousiasme une période formidable qui invite à réfléchir à des solutions audacieuses. « C’est un peu la vocation du think tank », poursuit-elle.
De son côté, Félix Edoh-Kossi Amenounve va plus loin. Pour lui, l’une des solutions au problème de la perception du risque et du coût élevé de la dette est que celle-ci soit détenue majoritairement par des acteurs locaux. « Le changement de paradigme passe aussi par cela : s’appuyer davantage sur la dette locale pour avoir la maîtrise de notre dette globale ». « Certains gros maux d’hier sont peut-être les solutions de demain », veut croire Nicolas Jean. En tout cas, l’idée fait son chemin, et tout porte à croire que l’initiative A New Road résonnera lors du Sommet sur le financement des économies africaines qui doit avoir lieu le 18 mai prochain à Paris à la demande du président français Emmanuel Macron.
Par Viviane Forson
Le Point