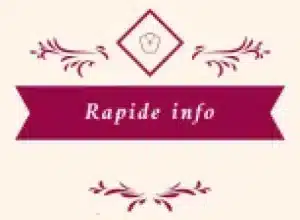Mauritanie : Pour un règlement équitable et définitif du passif humanitaire – Par Gourmo Abdoul Lô
Analyse approfondie de Gourmo Abdoul Lô sur les mécanismes nécessaires au règlement juste et durable du passif humanitaire en Mauritanie, dans le contexte du Dialogue national.

Pour un règlement équitable et définitif du passif humanitaire
Alors que la Mauritanie s’apprête à ouvrir les assises d’un Dialogue national décisif, la question du passif humanitaire s’impose comme l’un des enjeux centraux de la réconciliation nationale. Dans cette contribution, Gourmo Abdoul Lô propose une réflexion structurée et argumentée sur les mécanismes juridiques, politiques et mémoriels nécessaires pour parvenir à un règlement équitable, définitif et durable de ce dossier qui continue de peser lourdement sur l’unité et la stabilité du pays.
CONTRIBUTION AU REGLEMENT EQUITABLE ET DEFINITIF DE LA QUESTION DU PASSIF HUMANITAIRE
Par Gourmo Abdoul Lô
Au moment où doivent s’ouvrir les assises du Dialogue National auquel le Président de la République a appelé de ses vœux et auquel toute l’opposition, ainsi que la plupart des acteurs de la classe politique et de la société civile ont favorablement répondu, je désire apporter ma contribution au règlement de l’une des questions clé qui marque profondément les préoccupations de toute l’opinion publique depuis longtemps. Il s’agit du Passif humanitaire qui hante la vie de notre nation et grève dangereusement son unité, sa quiétude et sa réelle démocratisation, en servant de levier de commande à toutes sortes de manipulations et de manœuvres de certaines forces conservatrices, tapies parfois dans les profondeurs de l’Etat et très souvent servies par les positions extrémistes qui foisonnent dans les réseau sociaux surtout en ces temps de crise identitaire et qui risquent d’accentuer toujours plus dangereusement les divisions et les malentendus entre nos communautés.
Le sujet est d’ores et déjà inscrit parmi les thèmes centraux proposés dans la feuille de route du dialogue par l’opposition élargie et figure également parmi les points retenus par la quasi-totalité des participants déclarés du dialogue, d’après le Coordinateur du Dialogue M. Moussa Fall. C’était d’ailleurs déjà le cas dans le Pacte Républicain signé entre le Gouvernement au nom du Président de la République et certains partis de la Majorité d’une part, et des partis de l’opposition- en l’occurrence l’UFP et le RFD en 2023, d’autre part.
En vérité, ce thème est récurrent dans tous les dialogues amorcés ou aboutis entre les forces politiques du pays depuis au moins 2005-2006. Depuis lors, il n’a jamais cessé de constituer l’une des préoccupations majeures de la quasi-totalité de la classe politique et de la société civile qui en font un des critères de sérieux et de sincérité pour toute volonté de reformes dans le pays qui s’appuierait sur des exigences d’unité nationale et de cohésion sociale . C’est que depuis le Régime de M. Ould Taya, des tentatives hâtives et passées en catimini de règlement de ce dossier lourd n’ont cessé d’être entreprises et de décevoir, marquées qu’elles furent du sceau de manœuvres politiciennes. Ayant interrompu par son Coup d’Etat la seule démarche sérieuse de e règlement par Sidi Ould Cheikh Abdallahi, M Ould Abdel Aziz a cru pouvoir enterrer l’affaire par une « prière symbolique » à Kaédi et par des distributions d’argent liquide à des victimes et ayants droits triés sur le volet et sans aucune base légale. Echec total, au bout du compte
Cette fois-ci il semble que la volonté de tous de trouver une solution globale et effective soit forte et que l’on peut garder un optimisme mesuré et rationnel.
Au moment où sont rédigées ces lignes, l’opinion est sensibilisée autour d’un accord financier qui serait intervenu entre le Gouvernement et certaines des organisations représentatives des victimes à la veille de l’ouverture du Dialogue dont l’un des thèmes majeurs portera précisément sur le passif humanitaire.
Si cette démarche en cours semble aux yeux du public, privilégier les aspects « financiers » ( on parle de quelque 25 milliards d’ouguiyas anciens) et n’est pas en soi contradictoire avec le débat sur ce thème, c’est à la condition qu’elle ne vide pas les efforts de recherche d’un compromis national global sur ce sujet, et dont la dimension financière – quelle qu’en soit l’importance essentielle, n’en est cependant que l’un des aspects prioritaires.
Cette contribution a pour but d’inciter au débat tous les acteurs de ce dossier, en particulier les principaux concernés dont les attentes durent depuis plusieurs décennies, en gardant à l’esprit les grandes lignes des solutions que l’opposition démocratique, sous diverses formes, ne cesse de préconiser depuis très longtemps et dont on trouve une formulation dans le Pacte Républicain et dans la plupart des préconisations présentées par les partis d’opposition dans leur plateforme commune préparatoire au dialogue, en voie de finalisation…
Chapitre I. Cadre Conceptuel du Passif Humanitaire
1.1 Contexte Historique et Nature du Passif Humanitaire
Le terme de « Passif Humanitaire » en Mauritanie fait référence à la série de violations graves des droits de l’Homme commises principalement durant la période allant de la fin des années 1980 au début des années 1990. Ces événements tragiques ont profondément marqué l’histoire contemporaine du pays et ont laissé des cicatrices durables sur le tissu social, l’unité nationale et les relations entre l’État et ses citoyens issus des communautés négro-africaines, en particulier d’ethnie Pular.
1.1.1 Analyse des Faits et des violations massives des droits humains
La période charnière est marquée par les événements de 1989-1991, souvent désignés par euphémisme comme les « événements de 1989 » ou les « années de braise ».
Les violations recensées, largement documentées par les organisations de défense des droits humains et les associations de victimes, incluent de manière évidente et documentée :
*Des exécutions sommaires et extrajudiciaires :
Outre des habitants de nombreux villages de la région du fleuve, sans défense, de toutes catégories sociales, femmes, enfants et vieillards inclus, il s’agit principalement des centaines de personnes, dont un grand nombre de militaires et de fonctionnaires civils, qui ont été tués en détention ou lors de descentes de certains corps armés . Le cas emblématique des militaires exécutés à Inal en 1990 symbolise l’horreur de cette période de même que certaines tueries le long de la vallée
* Disparitions forcées : De nombreuses familles n’ont jamais pu obtenir de certitude sur le sort de leurs proches, dont les corps n’ont jamais été rendus.
* Expulsions massives et arbitraires : Des dizaines de milliers de Mauritaniens, en majorité des agriculteurs et des éleveurs, ont été déchus de fait de leur nationalité et expulsés vers le Sénégal et le Mali.
*Licenciements massifs et abusifs : Des milliers de citoyens, cadres ou simples agents publics ont été chassés de leur emploi, sans préavis, sans motif et sans recours possible
* Détentions arbitraires et torture : Des milliers de citoyens ont été emprisonnés sans procès équitable et soumis à la torture.
* Spoliations foncières et perte de patrimoine : Les familles expulsées ont perdu leurs terres, leur bétail et leurs biens, souvent réattribués par l’administration, générant des conflits fonciers toujours non résolus.
*Pillage, dépossession et spoliation de commerces d’hommes d’affaires et de Commerçants empêchés par la suite de recouvrer leurs biens.
1.1.2 Conséquences sur la Nation
Le Passif humanitaire a engendré des conséquences multifactorielles qui entravent encore aujourd’hui le développement et la cohésion nationale :
* Fracture sociale et méfiance : Ces événements ont exacerbé les tensions intercommunautaires et ont créé une profonde méfiance envers l’appareil sécuritaire et judiciaire de l’État.
* L’Exil et les rapatriés : Malgré les retours organisés (notamment après 2007), des dizaines de milliers de rapatriés sont confrontés à des problèmes de réintégration, d’accès à la terre et de reconnaissance administrative (actes de décès, régularisation de carrière, réintégration dans leurs droits, reprise de domicile etc.).
* L’Impasse du règlement : Depuis la loi d’amnistie de 1993 et les tentatives ponctuelles d’indemnisation financière, le dossier reste une source de conflit interne majeur. La position récente des associations de victimes en convergence avec celle que l’opposition historique a toujours préconisée depuis l’époque de l’UFD/Ere Nouvelle dès sa constitution au début des années 90 est claire : le règlement ne peut se limiter à une approche purement financière (souvent perçue comme un « achat de silence » ou un « achat de conscience ») mais doit impérativement reposer sur la reconnaissance officielle des faits et le rétablissement de la dignité des victimes.
1.2 Fondements et justification de la Justice transitionnelle (JT)
Face à l’échec des solutions unilatérales et partielles dont celles initiées par Maouwiya Ould Taya lui-même avec sa loi d’amnistie de 1993 et celle quasi totalement mercantiliste de Mohammed Ould Abdel Aziz (dont le coup d’Etat de 2008 a brutalement mis fin à l’approche plus inclusive, plus holistique et plus patriotique de feu Sidi Ould Cheikh Abdallahi), le recours à la Justice Transitionnelle (JT) adaptée au contexte national s’impose comme le cadre normatif et politique le plus approprié pour la Mauritanie.
1.2.1 Définition et objectifs de la JT
La Justice transitionnelle est l’ensemble des mesures judiciaires ou non judiciaires mises en œuvre par les sociétés pour faire face à un héritage de violations massives des droits de l’Homme, dans le but de garantir la redevabilité, de rendre justice aux victimes, de prévenir la répétition des atrocités et d’exclure toute revanche dans un esprit de réconciliation..
Elle repose fondamentalement sur quatre piliers interconnectés :
* Vérité : Établissement d’un récit historique officiel, reconnu par l’État.
* Instance de règlement : Démarche et procédure ouvertes au public permettant d’identifier les faits, de reconnaître les responsabilités et de sceller une réconciliation après pardon obtenu auprès des victimes reconnues.
* Réparation : Indemnisation des victimes et mesures de restauration de la dignité (psychologique, professionnelle, sociale).
* Garanties de non-répétition : Réformes institutionnelles (armée, police, justice) visant à démanteler ou à éradiquer les structures et les pratiques d’abus.
1.2.2 Justification du choix de la Justice transitionnelle (JT) spécifique pour la Mauritanie
Le recours à un cadre de JT spécifique à la Mauritanie est justifié par la nécessité de trouver une solution équilibrée entre deux impératifs :
* L’Impératif d’équité et de dignité : Répondre à l’obligation morale et légale de l’État de reconnaître les souffrances et de rétablir les droits des victimes.
* L’Impératif de stabilité : Reconnaître que l’ouverture d’un processus judiciaire classique pourrait engendrer des risques de déstabilisation des institutions, compte tenu de la réalité politique et sociale du pays et de l’état de l’institution judiciaire en Mauritanie qui est loin d’inspirer confiance et qui peine encore à sortir de ses difficultés et limites reconnues de tous (la vaste réforme déjà ficelée peine encore à se réaliser).
La JT, en particulier en privilégiant la voie d’un Mécanisme (Commission par exemple comme je le préconise ici) Vérité- Pardon et Mémoire, et un plan de réparation holistique comme étapes initiales, permet de contourner légitimement la voie rocailleuse et incertaine des poursuites judiciaires classiques tout en offrant aux victimes la reconnaissance publique et l’équité qu’elles réclament.
C’est la voie la plus réaliste pour transformer ce conflit latent à travers un processus de guérison et de réconciliation nationale.
1.3 L’Expérience des autres : Les Modèles Inspirants
L’élaboration d’un modèle mauritanien doit s’appuyer sur les leçons tirées des expériences antérieures dans d’autres pays, en particulier celles qui ont réussi à gérer l’équilibre difficile entre équité et stabilité, tout en restant ancré dans nos propres réalités nationales et nos valeurs propres.
1.3.1 Le Modèle Marocain : L’Instance Équité et Réconciliation (IER)
L’expérience marocaine est la plus pertinente pour la Mauritanie en raison du contexte politique, social et régional relativement similaire.
* Le Compromis : L’IER (2004) a réussi à traiter les violations des « années de plomb » dont le bilan fut particulièrement lourd en termes de vies humaines et de dégâts sociaux, en privilégiant la vérité (audiences publiques) et la réparation globale (financière, médicale, sociale, administrative…), mais en écartant le schéma de condamnations pénales individuelles qui eussent été difficilement gérables pour le système politique et social en place. Ce choix a permis une large coopération des institutions (forces de sécurité), garantissant l’accès à la vérité sans provoquer une crise institutionnelle majeure.
* Pertinence pour la Mauritanie : Ce modèle démontre qu’une reconnaissance officielle forte et crédible et des réparations globales et judicieuses peuvent satisfaire l’essentiel des revendications des victimes, même en l’absence de poursuites pénales classiques. La Mauritanie peut s’inspirer de certains autres aspects de cette démarche marocaine, comme par exemple celui du volet de l’IER concernant la reconnaissance des pertes professionnelles et foncières.
1.3.2 Autres modèles et leçons Tirées
* Afrique du Sud (Commission Vérité et Réconciliation – CVR) : Bien que son option d’amnistie en échange de la vérité complète soit difficilement transférable voire quasiment inapplicable en Mauritanie, elle illustre la puissance de la médiatisation des témoignages pour établir la vérité consensuelle et la mémoire nationale.
* Leçons de la transparence : Les expériences réussies insistent sur la nécessité d’une gouvernance rigoureuse et transparente du processus de réparation et d’une participation effective des victimes à toutes les étapes de e processus ainsi que la prise de gestes forts, significatifs et symboliques qui apaise les cœurs meurtris, forcent l’estime de soi collective et la réconciliation nationale.
Comme on le voit, l’objectif principal de cette contribution est donc de proposer les grandes lignes d’un modèle hybride qui adapte les meilleures pratiques de la JT (notamment l’approche globale marocaine) aux spécificités mauritaniennes.
Chapitre II. Le Compromis légal et Mémoriel
Il s’agira ici de proposer le socle légal et institutionnel qui pourrait permettre à l’État de reconnaître formellement les crimes du Passif Humanitaire et d’en tirer les conséquences adéquates. En plus d’une dimension matérielle efficiente admettant et réactualisant les efforts limités de compensations financières antérieures (à titre de réparation), le compromis résidera dans l’adoption d’une Vérité officielle et de garanties mémorielles fortes, tout en excluant tout risque de déstabilisation lié aux incertitudes et aléas d’une justice procédurale classique.
2.1 Le Cadre Juridique de reconnaissance et de Mémoire
Le premier acte de ce règlement doit être législatif, matérialisant l’engagement politique de la Nation.
2.1.1 La Loi de Reconnaissance et ses Implications
Une Loi-Cadre sur le Règlement du Passif Humanitaire doit être adoptée par le Parlement. Cette loi aura une portée double : elle légitime le processus de Justice Transitionnelle à la mauritanienne et elle établit une vérité historique intangible. Cette loi doit être adoptée dans un esprit de concorde et de consensus entre la majorité et l’opposition, après discussions avec les principales organisations concernées, dans le cadre du dialogue national en préparation. Cette démarche de débats et compromis au sein du Parlement s’inspire de l’expérience de l’adoption en septembre 2007 de la loi sur la criminalisation de l’esclavage. Elle aura trois volets :
1°) Reconnaissance de la Responsabilité de l’État : La loi doit stipuler clairement que les violations commises durant la période du Passif Humanitaire constituent des crimes contre les droits de l’Homme (disparitions forcées, torture, exécutions extrajudiciaires…) et que la responsabilité de l’État est engagée. C’est l’étape la plus forte de la réparation morale. Elle réaffirme la déclaration du Président de la République Feu Sidi Ould Cheikh Abdallah. Le Président de la République en exercice prononce un Discours officiel dans lequel sont réaffirmés la reconnaissance de la Responsabilité de l’Etat du fait de ses agents criminels ainsi que l’ensemble des engagements souscrits au titre de la réparation et de la Réconciliation Nationale.
2°) Fondement de la Réparation : La loi sert de base juridique à toutes les mesures de réparation (financières, de carrière, foncières etc.) gérées par l’Etat à travers notamment le Mécanisme de règlement évoqué précédemment, assurant qu’elles sont versées au titre de la réparation et non d’une simple aide sociale ou d’une charité.
3°) Statut des Victimes et Martyrs : La loi doit conférer un statut légal de « Victimes du Passif Humanitaire » et de « Martyrs de la Nation » aux personnes identifiées, avec les droits qui y sont attachés (santé, éducation, carrière, restitution…). Une Place et un Monument devraient être dédiés aux Martyrs et à la Réconciliation Nationale.
2.1.2 Le Dispositif Anti-Négationniste : Garantir la Mémoire
Pour prévenir la résurgence des discours de haine et garantir la paix sociale, la Loi de Reconnaissance doit inclure un dispositif anti-négationniste (Loi Mémorielle).
* Définition de l’Infraction : Criminaliser explicitement le fait de nier, minimiser grossièrement, justifier, ou faire l’apologie des crimes reconnus par la loi et établis par le rapport de la CVPM (Commission Vérité Pardon Mémoire)
* Portée et Sanctions : Les sanctions pénales sont exclues. Elles doivent surtout être d’ordre moral et proportionnel et viser à créer une empathie entre les protagonistes après reconnaissance des faits. L’Etat couvre les crimes de ses agents et, en cas de difficultés de reconnaissance personnelle justifiée, demande officiellement le pardon en leur nom devant la CVPM.
* Équilibre avec les Libertés : Le dispositif doit être rédigé avec précision pour ne pas entraver la liberté de la recherche historique légitime ni la liberté d’expression générale, en se focalisant uniquement sur les tentatives de remettre en cause la vérité établie par l’État.
2.1.3 Articulation avec le Droit International
La Loi de Reconnaissance permet à la Mauritanie de se conformer aux obligations issues des instruments internationaux, notamment :
* La Convention contre la Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
* La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, qui oblige à la recherche des disparus et l’indemnisation de leurs familles.
2.2 La Commission Vérité, Pardon, Mémoire (CVPM)
La CVPM est le pivot institutionnel chargé de transformer les faits individuels en une Vérité nationale. Elle doit être perçue comme un organe d’État, mais agissant avec une pleine autonomie.
2.2.1 Mandat, Pouvoirs et Composition
* Indépendance et Pluralisme : Les membres de la CVPM (idéalement 7 à 9) doivent être choisis sur la base de leur compétence et indépendance morale (juristes, historiens, psychologues, leaders sociaux) et non sur l’appartenance politique ou ethnique. Leur nomination par Décret du Président de la République doit faire l’objet de la plus grande attention afin que leurs membres soient réellement représentatifs et acceptables pour les principaux concernés (spécialement les associations des victimes et ayants droits)
* Mandat Prioritaire : Le mandat principal de la CVPM est double : établir la vérité des faits et identifier la situation des victimes. Elle n’a pas de mandat d’ouvrir des poursuites pénales, mais ses conclusions sont rendues publiques, à la satisfaction des victimes et de leurs ayants droits.
* Pouvoirs d’Enquête : La CVPM doit avoir le pouvoir d’accéder aux archives publiques et militaires (sous conditions de sécurité), en particulier les rapports des commissions d’enquête existants, de convoquer des témoins et, surtout, de superviser les enquêtes pour la localisation des dépouilles des disparus.
2.2.2 Le Processus de l’établissement de la Vérité
L’activité de la CVPM s’articulera autour de trois axes de collecte de l’information :
– Auditions:
Recueil confidentiel des témoignages pour documenter les faits et établir les droits à réparation.
* Audiences Publiques : Sélectionner des témoignages représentatifs pour être rendus publics (idéalement médiatisés) afin de transférer la douleur des victimes vers la conscience nationale et d’obtenir une reconnaissance collective.
*Enquêtes sur les Disparus : C’est la tâche la plus ardue et la plus urgente. La CVPM doit collaborer avec des experts médico-légaux et génétiques nationaux et, au besoin, internationaux pour :
* Localiser les sites de sépulture présumés.
* Exhumer, identifier et restituer les restes aux familles.
* Délivrer des certificats de décès officiels mentionnant la cause de la mort dans le cadre du Passif Humanitaire, mettant fin à l’incertitude et permettant aux familles le cas échéant d’ouvrir la succession.
2.2.3 Le Rapport Final de la CVPM
Au terme de son mandat, la CVPM doit publier un rapport final qui :
* Établit la chronologie des événements et le bilan humain.
* Formule des recommandations détaillées pour les réparations (en tenant compte de ce qui a été déjà fait) et pour les réformes institutionnelles (à l’intention du gouvernement).
* Devient la référence historique officielle de l’État mauritanien sur le Passif Humanitaire.
Chapitre III. Quelques propositions liées à la Réparation et au Rétablissement dans leurs droits des victimes et ayants droits
La CVPM est le principal outil de la Justice transitionnelle en Mauritanie. Il doit transcender la simple fonction de caisse de paiement pour devenir un symbole de la responsabilité de l’État, de l’équité du pardon et de la Réconciliation
3.2.1 Indemnisation Financière et Barèmes
Les montants, les conditions d’établissement et les barèmes des indemnisations financières seront établis en fonction des accords et pratiques déjà effectués par les Parties s’il y a lieu, à moins que des accords aient déjà réglé cette question
3.2.2 Réparation Sociale, Médicale et Psychologique
* Prise en charge sanitaire : Le Mécanisme prévu doit rendre effective la disponibilité ou l’accessibilité à des centres ou organismes spécialisés ou compétents offrant un suivi médical et psychologique gratuit et à vie aux victimes directes de torture, aux veuves et aux orphelins.
3.2.3 Le Principe de reconnaissance et de reconstitution de Carrière pour les Fonctionnaires civils et militaires
* Reconnaissance d’ancienneté : La Loi de Reconnaissance doit explicitement stipuler que la période d’inactivité forcée des fonctionnaires (civils et militaires) victimes est considérée comme du service effectif pour le calcul de l’ancienneté, des avancements et des droits à la retraite. Au vu des dossiers, des mesures exceptionnelles de promotion pourraient être adoptées (élévation de grade…).
* Régularisation administrative : Le Mécanisme doit coordonner avec les Départements concernés (Fonction Publique, Défense…) pour délivrer aux victimes des dossiers de carrière rectifiés et des actes administratifs attestant de cette continuité de principe. Cela mettra fin au va et vient sans fin et souvent sans lendemain des victimes bénéficiaires souvent laissés à eux-mêmes et perdus dans la dédale des départements administratifs sans interlocuteurs et sans espoir comme ce fut le cas lors du « règlement des indemnités des déportés de 1989.. » sous le précédent régime à la suite des décisions prises en conseil des Ministres le 20 septembre 2012
* Indemnisation Différentielle : Pour les victimes déjà à la retraite avec une pension réduite, il doit être versé une indemnité forfaitaire correspondant à la valeur actualisée de la différence entre la pension réduite reçue et la pension complète qui leur est désormais due.
3.3.3 Indemnisation des Pertes de Fonds de Commerce et Actifs
*Nécessité d’évaluer la valeur des fonds de commerce, des équipements professionnels et des actifs financiers perdus ou abandonnés par les hommes d’affaires et commerçants.
Chapitre IV. Réintégration et garanties de non-répétition
Il s’agit ici des mesures visant à assurer la pérennité de la paix sociale en Mauritanie. L’objectif est de s’attaquer aux causes profondes du Passif Humanitaire, notamment l’insécurité foncière et l’impunité institutionnelle.
4.1 La Régularisation Foncière : Complexités et Solutions
La question foncière est un point de friction majeur pour les rapatriés, dont les terres ont souvent été spoliées ou réattribuées. Le règlement nécessite une approche à la fois juridique, sociale et économique.
4.1.1 Analyse des défis juridiques et sociaux
Le défi principal réside dans la superposition des droits et de l’état du système de propriété foncière largement problématique.
* Conflits d’occupation : Les terres laissées vacantes par les Mauritaniens expulsés ont été parfois réattribuées à d’autres occupants, y compris des rapatriés du Sénégal dans un mouvement inverse, ou des populations locales. Une simple restitution créerait de nouvelles victimes et de nouveaux conflits intercommunautaires.
* Absence de Titres : La majorité des terres rurales n’est pas couverte par des titres de propriété formels, rendant l’établissement de la preuve de propriété difficile pour les rapatriés.
4.1.2 Mécanisme de règlement de la dimension foncière
* Priorité à la Médiation : Le Mécanisme doit privilégier la médiation et l’arbitrage locaux. La résolution doit être basée sur des accords consensuels entre les parties.
* Enquête impartiale : Le Mécanisme doit mener une enquête foncière détaillée et impartiale pour identifier les droits originels des victimes et les droits d’usage actuels des occupants.
4.1.3 Le Protocole de la double approche (Restitution ou Compensation)
Pour garantir l’équité sans créer de nouvelles injustices, un protocole strict est nécessaire :
* Restitution faisable : La restitution physique des terres est effectuée uniquement lorsque la terre n’est pas exploitée ou lorsque l’occupant actuel accepte une compensation monétaire ou un relogement.
* Compensation et nouvel octroi : Lorsque la restitution est impossible (conflit aigu ou usage intensif par les occupants actuels), le Mécanisme doit :
* Proposer une indemnisation financière majorée pour la perte du capital foncier (comme partie de la réparation globale)
* Ou Octroyer de nouvelles terres de qualité équivalente dans des zones disponibles, en finançant leur mise en valeur.
4.2 Garanties de non-répétition et réformes Institutionnelles
Les réformes structurelles au sein de l’appareil sécuritaire et judiciaire sont la garantie ultime que les violations ne se reproduiront pas.
* Transfert de Juridiction : une future réforme du système pénal devrait permettre que les crimes graves contre les droits humains (torture, exécutions) commis illégalement par les militaires et les forces de sécurité soient transférés à la juridiction civile (tribunaux de droit commun). C’est une norme internationale fondamentale pour assurer l’impartialité et la crédibilité des poursuites.
4.3 Renforcement du contrôle démocratique et des garanties
* Contrôle Parlementaire effectif : Renforcer les pouvoirs des commissions permanentes de l’Assemblée Nationale (Défense, Justice) pour un contrôle civil et transparent des doctrines, des budgets et de la nomination aux postes clés des forces armées et de sécurité.
* Transparence et Représentativité : Promouvoir une composition des forces armées qui reflète la diversité démographique et régionale de la Mauritanie, à tous les niveaux de la hiérarchie.
4.4. Devoir de Mémoire et éducation civique
* Intégration Mémorielle dans l’Éducation : Mettre en œuvre les recommandations de la CVPM pour l’intégration de l’histoire du Passif Humanitaire (sur la base du récit officiel établi par la CVPM) dans les programmes scolaires et les manuels d’histoire, afin de forger une mémoire nationale partagée.
* Formation aux Droits de l’Homme : rendre les formations sur le Droit International Humanitaire (DIH) et les droits de l’homme obligatoires et récurrentes pour tous les militaires, policiers et membres de l’administration, du recrutement au perfectionnement professionnel.
Chapitre V. Conclusion et Recommandations
Ce chapitre récapitule les fondements du consensus proposé et synthétise l’urgence de l’action en vue du règlement définitif du passif humanitaire.
5. Synthèse du Consensus proposé
Le plan de règlement du Passif Humanitaire présenté dans cette contribution s’appuie sur l’idée qu’il peut représenter une opportunité historique pour la Mauritanie de transcender les blessures du passé et de consolider son unité nationale sur des bases de justice et de vérité.
Le modèle proposé crée une « double dividende » bénéfique pour toutes les parties :
-Les Victimes et Associations : Dignité et Vérité (Loi de Reconnaissance et CVPM), Réparation Holistique (financière, carrière, foncière), et Garanties de Non-Répétition (réformes militaires).
-L’État Mauritanien : Stabilité politique (en évitant l’ouverture d’une crise judiciaire), Crédibilité Internationale (en respectant les normes de la JT et en sécurisant des financements), et Unité Nationale (en refermant l’un des dossiers les plus sensibles du pays).
-Les Institutions : Modernisation et professionnalisation (via les réformes du secteur de la sécurité) et sécurisation de la paix sociale.
Le succès repose sur la reconnaissance du fait que la vérité sans réparation est incomplète, que la réparation sans vérité est inacceptable et que le tout pourrait contribuer à une vraie renaissance et consolidation de l’idée d’une nation forte, plurielle réconciliée avec elle-même, unie et prête à amorcer son réel développement.
Cette contribution a essayé de dégager un cadre consensuel, juste et réalisable. La Mauritanie a aujourd’hui l’occasion d’écrire un nouveau chapitre de son histoire, qui tourne la page des rancœurs, des malentendus et des suspicions, un nouveau chapitre fondé sur la réconciliation par la Vérité, la Réparation, le Pardon et la Non répétition.
Nouakchott le 12 novembre 2025