Le plan de paix de septembre 2025 : promesse fragile ou épée de Damoclès pour les Palestiniens ?
Le plan Trump–Netanyahu de septembre 2025 : promesse de paix ou piège politique pour les Palestiniens ? Analyse des enjeux et incertitudes.
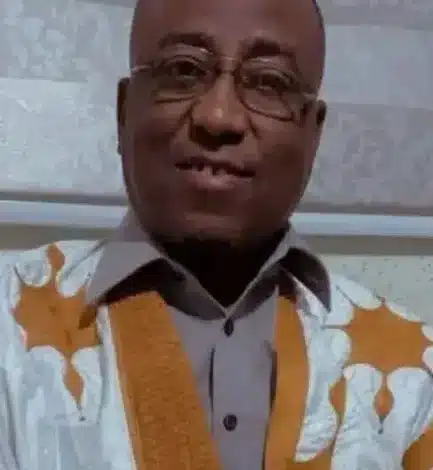
Palestiniens
Cheikh Sidati Hamadi – Expert senior en droits des Communautés Discriminées sur la base de l’Ascendance et du Travail (CDWD), Chercheur associé, Analyste, Essayiste. Le 01 octobre 2025
I. Aux origines d’un conflit sans fin
Depuis plus de soixante-quinze ans, la question palestinienne demeure l’une des plaies ouvertes les plus douloureuses du Moyen-Orient. Tout commence en 1948, avec la Nakba, cette « catastrophe » qui vit l’exode forcé de plus de 700 000 Palestiniens de leurs villages et villes pour laisser place à l’État d’Israël. En 1967, la guerre des Six Jours accentua encore ce traumatisme : Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est passèrent sous occupation israélienne, inaugurant une ère de colonisation qui se poursuit aujourd’hui. L’ONU estime à plus de 600 000 le nombre de colons israéliens installés en Cisjordanie et à Jérusalem-Est (UN OCHA, 2023), un chiffre qui illustre l’ampleur de la dépossession territoriale.
De décennies en décennies, les initiatives de paix se succèdent sans parvenir à briser le cercle de la violence. Oslo, en 1993, avait ouvert une brèche d’espérance : pour la première fois, Israéliens et Palestiniens se reconnaissaient mutuellement et jetaient les bases d’une Autorité palestinienne autonome. Mais les assassinats, les attentats, les guerres de Gaza et la poursuite implacable des colonies vidèrent rapidement cet accord de sa substance. Camp David II, en 2000, n’aboutit à rien. La Feuille de route du Quartette, en 2003, resta lettre morte. L’Initiative arabe de paix de 2002, qui proposait la reconnaissance d’Israël en échange d’un retrait complet des territoires occupés, ne fut jamais sérieusement considérée par Tel-Aviv.
II. La rupture de 2020 : Trump et les Accords d’Abraham
L’année 2020 marqua une double rupture. D’un côté, Donald Trump, alors président des États-Unis, dévoila ce qu’il appela « l’accord du siècle ». Le plan, bâti en 20 points, promettait un État palestinien, mais sous condition d’une démilitarisation complète et dans des frontières fragmentées, entourées de territoires annexés par Israël. Jérusalem y était consacrée comme capitale indivisible d’Israël, tandis qu’un programme de 50 milliards de dollars devait relancer l’économie palestinienne (U.S. State Department, 2020). Les Palestiniens rejetèrent massivement ce plan qu’ils considéraient comme une capitulation forcée.
De l’autre côté, les Accords d’Abraham redessinèrent la carte régionale : plusieurs pays arabes, dont les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan, normalisèrent leurs relations avec Israël sans exiger la création préalable d’un État palestinien (BBC News, 2020). Pour beaucoup de Palestiniens, ce fut un sentiment d’abandon, comme si leur cause historique passait au second plan dans le jeu des intérêts géopolitiques et économiques.
III. Septembre 2025 : le retour de Trump et le pari d’un nouveau plan
Cinq ans plus tard, Donald Trump revient au centre du jeu diplomatique. Le 30 septembre 2025, aux côtés de Benjamin Netanyahu, il présente à la Maison Blanche un nouveau plan en 20 points, destiné à mettre fin à la guerre qui ravage Gaza depuis des mois.
Le cœur de l’accord est clair : la libération immédiate des otages encore détenus par le Hamas dans les 72 heures ; le désarmement et la démobilisation de l’organisation islamiste ; la destruction systématique des tunnels et des infrastructures militaires souterraines ; et, en contrepartie, la fin des opérations militaires israéliennes à Gaza. À ces mesures sécuritaires s’ajoutent la libération de centaines de prisonniers palestiniens par Israël et l’acheminement immédiat d’une aide humanitaire, devenue vitale dans une enclave où 2,3 millions d’habitants vivent au bord du gouffre (UNRWA, 2023).
Mais le plan ne s’arrête pas là. Il institue un « comité de paix », présidé par Donald Trump lui-même, auquel Tony Blair s’est dit prêt à participer. Ce comité serait chargé de superviser l’application de l’accord et de préparer une étape politique ultérieure : l’organisation d’élections pour une autorité de transition palestinienne. Le Hamas et ses dirigeants en seraient exclus, tout comme ceux jugés « extrémistes » ou « incompatibles » avec le processus.
IV. Entre promesse et piège : une paix conditionnelle
À première vue, le plan porte en lui une promesse tangible : celle d’un cessez-le-feu, d’une aide humanitaire massive et d’un soulagement immédiat pour les populations civiles. La libération simultanée d’otages israéliens et de prisonniers palestiniens pourrait marquer un rare moment de réciprocité dans un conflit souvent unilatéral.
Pourtant, une lecture plus attentive laisse planer de lourdes incertitudes. Le désarmement complet du Hamas, sans garantie politique solide en échange, risque de laisser Gaza sous tutelle sécuritaire permanente. L’exclusion du Hamas des élections futures marginalise une partie importante de la société palestinienne, au risque d’alimenter un cycle de ressentiment et de clandestinité armée. La supervision directe par Trump et un comité international renforce l’impression d’une autonomie confisquée : Gaza ne déciderait pas de son avenir, mais l’exécuterait sous surveillance.
Ce plan, comme les précédents, ne traite pas des questions de fond : le statut de Jérusalem, la poursuite de la colonisation, les frontières de 1967, le droit au retour des réfugiés. Autrement dit, il éteint l’incendie immédiat sans résoudre l’embrasement profond.
V. Héritages et continuités
À bien des égards, le plan de septembre 2025 n’est pas une rupture, mais une continuité. Il reprend la logique sécuritaire du plan Trump de 2020 : garantir la sécurité d’Israël avant toute concession politique. Il prolonge l’esprit des Accords d’Abraham : normaliser la situation régionale, quitte à marginaliser la question palestinienne. Et il reproduit le schéma des accords passés : apaiser la violence à court terme sans offrir de solution durable à la souveraineté palestinienne.
Dans l’histoire des négociations, on observe un même paradoxe : plus les plans se multiplient, plus la cause palestinienne s’étiole, enfermée entre concessions forcées et promesses non tenues.
VI. Conclusion : l’épée suspendue
Le plan Trump–Netanyahu de septembre 2025 est présenté comme une opportunité pour la paix. Il pourrait, en effet, apporter un répit nécessaire et vital pour les habitants de Gaza. Mais il ressemble davantage à une épée de Damoclès suspendue au-dessus des Palestiniens : s’ils refusent, ils seront accusés d’obstruction ; s’ils acceptent, ils entreront dans une transition politique sous tutelle, privée de souveraineté réelle.
Ainsi se rejoue, une fois de plus, le drame palestinien : entre soulagement immédiat et impasse historique, entre survie quotidienne et espoir de liberté différée. L’histoire récente nous rappelle qu’aucune paix durable ne peut naître sans justice, ni sans reconnaissance pleine et entière du droit des Palestiniens à disposer d’eux-mêmes.




