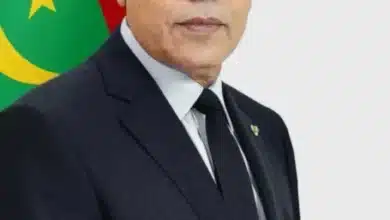Mauritanie : quand le vernis du Commissariat aux droits de l’homme occulte la réalité des droits humains
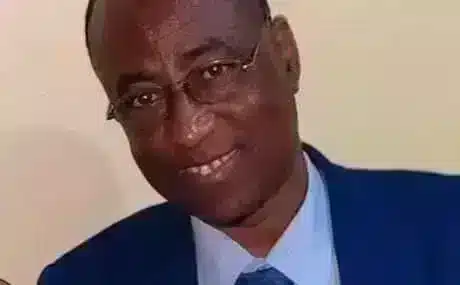
Par Cheikh Sidati Hamady
Expert Senior en droits des CDWD , Chercheur associé, analyste, Essayiste .
L’article publié le 30 septembre 2025 sur Rapide Info, intitulé « Traite des êtres humains : Washington salue les avancées de la Mauritanie », présente le pays comme un modèle de progrès dans la lutte contre l’esclavage moderne et la traite des êtres humains. Selon le Commissariat aux droits de l’homme, à l’action humanitaire et aux relations avec la société civile, les réformes juridiques et institutionnelles, la création de tribunaux spécialisés, l’augmentation des allocations du Fonds d’assistance aux victimes et la mise en œuvre du Plan national 2024-2026 témoigneraient d’une volonté politique sincère et d’un engagement réel en faveur de la dignité humaine.
Pourtant, une lecture attentive des rapports nationaux et internationaux révèle une réalité beaucoup plus contrastée. Loin de refléter un progrès uniforme, les droits humains en Mauritanie restent fragiles, l’accès à la justice pour les victimes demeure limité et l’opacité institutionnelle persiste, affectant particulièrement les Communautés discriminées sur la base du travail et de l’ascendance (CDWD) (U.S. Department of State, 2025; Global Slavery Index, 2023).
1. La lutte contre la traite : progrès formels, impacts limités
L’article met en avant le maintien du classement de niveau 2 attribué à la Mauritanie par Washington comme preuve de progrès. Ce classement, davantage symbolique que réel, masque la persistance de problèmes graves. Le rapport américain souligne que l’identification des victimes reste incomplète et que l’accès aux services demeure limité, surtout pour les populations vulnérables (U.S. Department of State, 2025).
Le chiffre de 30 000 candidats à l’émigration clandestine arrêtés reflète surtout la coopération sécuritaire et migratoire avec les partenaires internationaux et non la réussite de la lutte contre l’esclavage. Il illustre les attentes des États européens et nord-américains en matière de gestion externalisée des frontières, sans rien dire de l’état réel de la justice pour les victimes de crimes esclavagistes.
Selon le Global Slavery Index 2023, environ 149 000 personnes vivent encore dans des conditions d’esclavage en Mauritanie, soit un habitant sur vingt-cinq. Les rapports de la Rapporteuse spéciale des Nations unies sur les formes contemporaines d’esclavage documentent la persistance d’un esclavage héréditaire dans plusieurs régions du pays (United Nations, 2023).
2. Les tribunaux spécialisés : progrès symbolique et limites structurelles
a. Les tribunaux spécialisés antérieurs
Avant la création de la Cour pénale spécialisée de 2024, la Mauritanie disposait déjà de tribunaux spécialisés pour traiter les crimes d’esclavage dans plusieurs villes : Nouadhibou, Nouakchott et Néma. Ces juridictions ont introduit des mécanismes spécifiques pour juger les crimes liés à l’esclavage, mais leur impact réel reste limité :
- Entre 2016 et 2023, moins de cinq condamnations pour esclavage ont été prononcées, alors que plus de 200 plaintes ont été enregistrées (Association des Femmes Chefs de Famille – AFCF).
- La majorité des dossiers est classée sans suite ou réqualifiée en délits mineurs (SOS Esclaves).
- IRA-Mauritanie a documenté plusieurs cas où les victimes ou leurs représentants ont été intimidés, arrêtés ou emprisonnés, notamment dans les wilayas du sud.
Ces éléments montrent que, malgré l’existence de tribunaux spécialisés, l’impunité demeure la norme pour les victimes de l’esclavage moderne.
b. La Cour pénale spécialisée de 2024
La Cour pénale spécialisée, créée par la loi n°039/2024 et dirigée par Sidi Mohamed Cheina, constitue une innovation juridique majeure dans la région sahélo-saharienne. Son rôle officiel est de juger les crimes d’esclavage, de traite des personnes et de trafic illicite de migrants, avec pour objectif de restaurer la justice pour les victimes et de briser l’impunité. Après cinq mois d’activité, son président évoque des résultats positifs et une reconnaissance internationale (Loi n°039/2024).
Pourtant, plusieurs limites persistent :
- Transparence insuffisante : aucune donnée publique sur les affaires traitées, les condamnations prononcées ou le profil des victimes n’est disponible, rendant difficile l’évaluation de l’efficacité de la Cour.
- Accès limité aux victimes : les CDWD, en particulier femmes et enfants, restent marginalisés, souvent analphabètes et craignent des représailles, ce qui entrave leur accès à la justice.
- Indépendance contestée : absence de mécanismes de nomination indépendants et proximité persistante avec l’exécutif, remettant en question l’autonomie réelle de la juridiction.
- Priorité à la migration : le chiffre de 30 000 migrants arrêtés illustre davantage la coopération sécuritaire internationale que l’efficacité réelle de la Cour pour traiter les crimes d’esclavage et de traite.
Ainsi, cette Cour, bien qu’innovante et dotée d’un rôle central dans la lutte contre l’esclavage et la traite, ne peut remplir pleinement son mandat sans transparence, accès effectif aux victimes et réelle autonomie judiciaire.
3. Sensibilisation et communication : un vernis diplomatique
Le Commissariat aux droits de l’homme met en avant les campagnes de sensibilisation menées avec des leaders religieux et associatifs. Pourtant, ces programmes n’atteignent pas toujours les populations réellement exposées aux pratiques esclavagistes. Dans de nombreuses zones, le tâcheronnat persiste et les chaînes de production informelles continuent d’exploiter des populations marginalisées.
Cette communication officielle agit comme un vernis, masquant la faiblesse des résultats tangibles sur le terrain et donnant une illusion de progrès qu’il ne convient pas de confondre avec la réalité.
4. Violations graves occultées : quand le vernis diplomatique ne suffit plus
Derrière la communication officielle, les violations des droits humains persistent et affectent particulièrement les populations vulnérables. Le rapport du Département d’État américain 2025 documente ces insuffisances de manière détaillée :
- Liberté d’expression et pressions sur les journalistes : arrestations et intimidations d’activistes et journalistes critiques, limitant la diffusion d’informations indépendantes ([U.S. Department of State, 2025]).
- Exploitation persistante des travailleurs : maintien du tâcheronnat, retards dans le traitement des conflits collectifs et non-respect des droits syndicaux ([U.S. Department of State, 2025]).
- Violence et impunité policière : blessures de manifestants, absence d’enquêtes et de sanctions, renforçant un climat de peur et de vulnérabilité ([U.S. Department of State, 2025]).
- Protection insuffisante des enfants et femmes : mariages d’enfants encore fréquents et mutilations génitales féminines non sanctionnées ([U.S. Department of State, 2025]).
Ces éléments illustrent l’écart entre la communication officielle et la réalité vécue. Le vernis diplomatique ne peut masquer des violations systémiques qui exigent des mesures concrètes et durables.
Conclusion : transformer la promesse en justice réelle
La Mauritanie dispose aujourd’hui d’un outil judiciaire inédit avec la Cour pénale spécialisée de 2024. Mais ce potentiel reste largement sous-exploité. Pour que cette Cour remplisse réellement son mandat, plusieurs mesures sont indispensables :
- Publier régulièrement des rapports détaillés sur les affaires traitées, les jugements et les réparations.
- Assurer une assistance juridique spécialisée et gratuite pour les victimes d’esclavage et de traite.
- Mettre en place un mécanisme indépendant de nomination et d’évaluation des juges.
- Créer un fonds d’indemnisation pour les victimes.
- Impliquer société civile et victimes dans le suivi des actions de la Cour.
Seule une approche fondée sur la transparence, la vérité et le respect des droits humains permettra de transformer cette promesse juridique en avancée historique et de restaurer la dignité des CDWD.