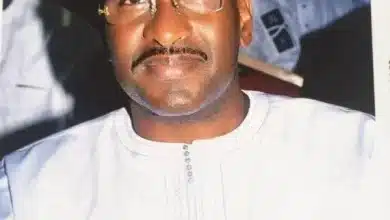Mauritanie à l’ONU : quand le vernis diplomatique masque l’impunité et la vulnérabilité
"Cette tension entre vernis diplomatique et réalité expose les migrants, les réfugiés et les victimes d’esclavage à des risques constants, mettant en évidence un décalage profond entre les promesses affichées et les résultats concrets."
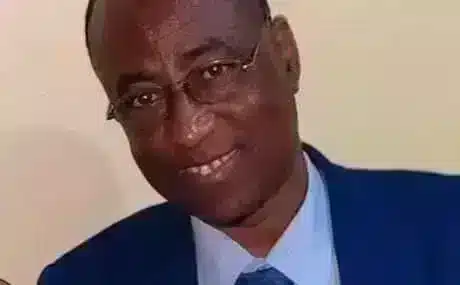
Vernis diplomatique
Cheikh Sidati Hamady
Expert senior en droits des Communautés Discriminées sur la base de l’Ascendance et du Travail (CDWD), Chercheur associé, Analyste, Essayiste
Lors de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations unies, le discours officiel de la Mauritanie a tenté de présenter le pays comme un modèle en matière de droits humains et de solidarité, en évoquant la régularisation de plus de 150 000 migrants, l’accueil de 250 000 réfugiés maliens, et le renforcement d’un arsenal juridique contre l’esclavage et la traite des êtres humains.
En réalité, cette communication flatteuse contraste avec des dysfonctionnements persistants et des violations tangibles : la régularisation des migrants reste opaque et partielle, les camps de réfugiés sont surpeuplés et manquent de services de base, l’impunité prévaut dans la majorité des affaires d’esclavage et de traite malgré l’existence de tribunaux spécialisés, et les mesures humanitaires sont largement insuffisantes face à des populations vulnérables en expansion.
Le discours officiel semble davantage destiné à soigner l’image internationale de la Mauritanie qu’à refléter les conditions réelles sur le terrain. Cette tension entre vernis diplomatique et réalité expose les migrants, les réfugiés et les victimes d’esclavage à des risques constants, mettant en évidence un décalage profond entre les promesses affichées et les résultats concrets.
1. La régularisation des migrants : chiffres et limites
La régularisation de 150 000 migrants semble représenter un geste généreux. Pourtant, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM, 2024) rappelle que la Mauritanie reste principalement un pays de transit pour les flux migratoires d’Afrique de l’Ouest (OIM, Rapport 2024). Les critères et mécanismes de régularisation demeurent opaques, et aucune donnée publique ne permet d’évaluer l’impact réel sur les droits des personnes concernées.
Des ONG telles que Human Rights Watch et Amnesty International rapportent encore des expulsions collectives vers le Mali et le Sénégal, souvent hors de tout cadre légal. Les contrôles au faciès sont également dénoncés par les défenseurs des droits humains (Amnesty International, Rapport 2024). Ces pratiques révèlent un écart entre le discours officiel et la réalité vécue par les migrants, qui restent fréquemment vulnérables et exposés à l’arbitraire.
2. Réfugiés en Mauritanie : un accueil au-delà des moyens et des risques ignorés
La Mauritanie ne se limite pas à un rôle de transit. Selon le HCR (mi-2025), le pays accueille environ 309 000 réfugiés et demandeurs d’asile, dont 177 000 sont enregistrés, soit une augmentation de 75 % en un an (HCR, Rapport 2025). L’essentiel provient du Mali, mais des réfugiés arrivent également de Syrie, Côte d’Ivoire, Centrafrique et Guinée.
Le camp de M’Béra, initialement prévu pour 70 000 personnes, héberge aujourd’hui plus de 110 000 réfugiés, et 150 000 autres vivent dans les villages alentours, partageant ressources et services avec les communautés locales déjà vulnérables. L’État tente d’intégrer les réfugiés aux écoles publiques, aux services de santé et aux registres sociaux, mais ces efforts dépendent largement de financements extérieurs. L’Union européenne avec son partenariat de 210 millions d’euros en 2024, reste insuffisant face aux besoins, et le Programme alimentaire mondial (PAM) peine à garantir des rations complètes (PAM, Rapport 2024 ; L-Post Media, Analyse Paul Villerac, 2025).
Cette situation entraîne des tensions sociales et des frustrations parmi les réfugiés et les communautés locales, exposant le pays à des risques accrus d’instabilité et de conflits locaux.
4. Rôle humanitaire et sécuritaire : limites, insécurité et risques
La position stratégique de la Mauritanie, à la fois maritime et frontalière du Mali, lui confère un rôle central, mais sous-financé et fragile. Sur le plan maritime, plus de 25 000 migrants ont quitté les côtes mauritaniennes en 2024 pour les Canaries. Les garde-côtes, en coopération avec l’Espagne, interceptent certaines embarcations et sauvent quelques vies, mais les mesures restent réactives et insuffisantes, laissant de nombreux migrants exposés à la noyade et à l’exploitation (OIM, Rapport 2024).
Sur le plan terrestre, l’Est mauritanien, frontalier avec le Mali, subit une pression humanitaire et sécuritaire croissante. Les camps surpeuplés et les villages d’accueil manquent d’infrastructures, d’eau potable, de soins et de nourriture suffisante. Cette situation entraîne des tensions sociales, une insécurité grandissante, des déplacements forcés et un risque accru d’épidémies. Les réfugiés et les communautés locales sont également exposés à des vols, agressions et incidents liés aux groupes armés présents dans la région transfrontalière (PAM, Rapport 2024 ; Amnesty International, Rapport 2024).
En réalité, le rôle humanitaire de la Mauritanie, souvent présenté comme exemplaire, reflète surtout les contraintes d’un pays qui assume des responsabilités bien au-delà de ses moyens. Sans un appui international accru et durable, ces efforts risquent de rester symboliques, laissant les populations vulnérables exposées à de graves risques humanitaires et sécuritaires.
3. Esclavage et traite des êtres humains : un arsenal juridique pour la consommation internationale, pas pour les victimes
La Mauritanie a adopté la loi n°2015-031 criminalisant l’esclavage et la loi n°2013-025 sur la traite des êtres humains, ainsi que des tribunaux spécialisés. Pourtant, le Global Slavery Index (2023) estime que près de 149 000 personnes vivent encore dans des conditions assimilables à l’esclavage (Global Slavery Index, 2023).
Le CERD (ONU, 2022) dénonce l’impunité quasi totale des auteurs, et le HCDH (2024) note que les victimes rencontrent des obstacles majeurs : lenteur judiciaire, intimidation et complicité d’autorités locales (CERD, Observations finales 2022 ; HCDH, Rapport 2024).
Le TIP Report (Département d’État américain, 2024) documente encore des cas de femmes et d’enfants victimes de traite des êtres humains, notamment dans le travail domestique, la mendicité forcée ou au sein de réseaux migratoires. Le Département d’État américain souligne également que de nombreux dossiers d’esclavage ne sont pas instruits correctement, malgré l’existence de tribunaux spécialisés, laissant une partie du cadre juridique largement symbolique (TIP Report 2024 ; US State Department, Human Rights Report 2024).
Moins d’une dizaine de condamnations effectives ont été prononcées depuis 2015, laissant la majorité des victimes dans la vulnérabilité et l’impunité (SOS Esclaves, Rapport 2023 ; IRA Mauritanie, Données 2022-2023).
Conclusion : vernis diplomatique ou progrès réel ?
Le discours officiel à l’ONU donne une image flatteuse de la Mauritanie, mais il ne reflète pas pleinement les réalités sur le terrain. Pour transformer ce vernis diplomatique en progrès concret, il est impératif de :
- Publier des données détaillées et vérifiables sur la régularisation des migrants.
- Renforcer l’intégration réelle des réfugiés et améliorer les infrastructures de base.
- Garantir l’application effective des lois contre l’esclavage et la traite des êtres humains, en protégeant pleinement les victimes.
- Soutenir le pays face aux risques sécuritaires dans l’Est et aux surcharges humanitaires, avec des ressources proportionnées aux défis.
C’est à ce prix que la Mauritanie pourra légitimement prétendre incarner les principes de dignité et de droits humains qu’elle affiche à l’international.