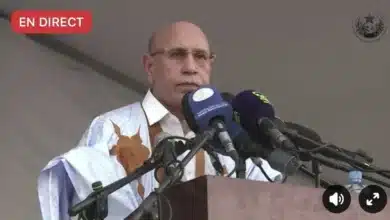Lignes de sable et d’héritage : deux familles, une citoyenneté à reconstruire
C'est l'histoire de deux familles en Mauritanie qui luttent pour rétablir leur mémoire et obtenir une citoyenneté pleine et entière. Plongez dans les récits de la famille El Hacen à Nouadhibou et de la famille Maccufie à Kiffa, chacune avec ses défis et ses espoirs.
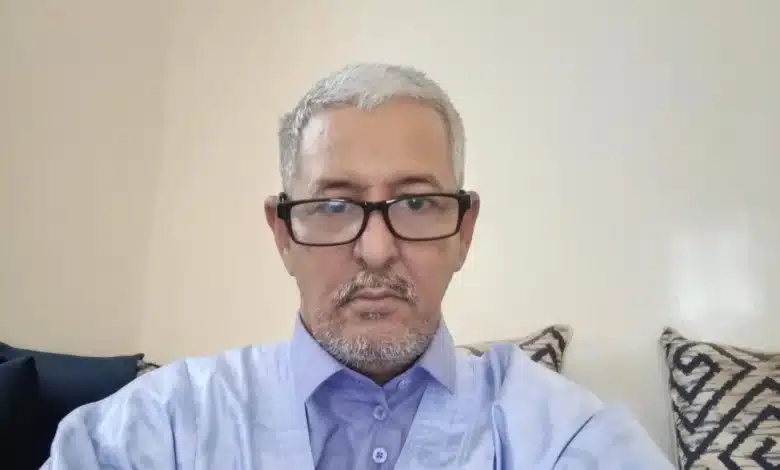
Deux familles mauritaniennes, l’une à Nouadhibou, l’autre à Kiffa, se battent pour réveiller une mémoire commune et construire une citoyenneté pleine. Découvrez les récits de la famille El Hacen et de la famille Maccufie, témoins d’une quête de justice et d’égalité.
En Mauritanie où le vent balaie sans cesse les traces du passé, deux familles – l’une à Nouadhibou au nord, l’autre à Kiffa au sud – se battent, chacune à leur manière, pour raviver une mémoire commune : celle d’un peuple longtemps dépossédé de ses droits et aujourd’hui en quête d’une citoyenneté pleine et entière.
La mémoire effacée du nord : la famille El Hacen
Au cœur de la cité portuaire de Nouadhibou, dans une maison modeste adossée à un chantier naval, Fatimetou El Hacen, 42 ans, enseignante, feuillette un vieux cahier d’écolier. Les pages jaunies racontent, de façon décousue, l’histoire de son grand-père, affranchi en silence à la fin des années 1950. « On ne parlait jamais d’esclavage. Chez nous, on disait juste qu’on “travaillait pour quelqu’un”. La honte, c’est ce qui a étouffé la parole pendant des générations. »
Pour Fatimetou, la citoyenneté se gagne aujourd’hui par la connaissance. Elle anime des cercles de mémoire dans les écoles et milite pour l’introduction de l’histoire des affranchis dans les programmes scolaires. « Comment peut-on construire une république si la moitié de ses enfants ignorent leur propre histoire ? »
L’abolition officielle de l’esclavage en 1981, par décret présidentiel, est restée sans effet concret pendant plus de deux décennies. Il a fallu attendre 2007 pour qu’une loi pénale autorise enfin la poursuite des propriétaires d’esclaves. Trop tard, selon Fatimetou : « Le mal est fait, mais il n’est pas trop tard pour éduquer. »
Au sud, la conscience en éveil : la famille Maccufie
À Kiffa, la ville poussiéreuse et vibrante au sud du pays, la famille Maccufie vit sur des terres qu’elle cultive depuis des générations – pour d’autres. Amadou Maccufie, 28 ans, juriste et activiste, a grandi dans une maison où le mot « droit » semblait réservé à ceux d’en haut. Mais les temps ont changé.
« Mon père disait toujours : « Nous ne sommes pas nés libres, mais nos enfants le seront. » C’est ma mission aujourd’hui. » Amadou dirige une organisation qui aide les jeunes à obtenir leurs papiers d’identité, à voter, à accéder à l’éducation. « Il y a des milliers de Mauritaniens, surtout parmi les anciens esclaves, qui ne possèdent aucun document civil. Comment parler de citoyenneté sans cela ? »
Il évoque aussi la fracture culturelle : « Beaucoup d’affranchis ignorent s’ils sont d’ascendance arabe ou africaine. L’esclavage a effacé les racines, cassé les lignées, mélangé les noms. Ce flou identitaire est une blessure ouverte. »
Deux récits, une même quête
La famille El Hacen cherche à éclairer le passé ; la famille Maccufie se bat pour façonner l’avenir. Ensemble, elles incarnent une vérité trop longtemps tue : l’esclavage en Mauritanie n’est pas un vestige lointain, mais une ombre encore présente dans les plis de la société.
Le défi, aujourd’hui, est double : réparer sans raviver les haines, affirmer sans diviser. L’action affirmative n’est pas un luxe dans ce contexte : c’est une nécessité. Réserver des postes dans l’administration, créer des bourses pour les descendants d’esclaves, rendre obligatoire l’enseignement de cette histoire – autant de pas vers une égalité réelle.
Citoyenneté : le mot qui manque encore à trop de lèvres
Dans un pays où l’on peut encore naître sans nom de famille reconnu, sans nationalité, sans voix, la citoyenneté est une conquête. Fatimetou et Amadou, chacun depuis son bout de territoire, refusent de laisser les vents du désert emporter le récit des leurs.
Ils le gravent dans l’action, dans les mots, dans l’éducation. Car, au fond, c’est peut-être cela, la citoyenneté : le droit de raconter son histoire – et d’en écrire la suite.
Ahmed Ould Bettar