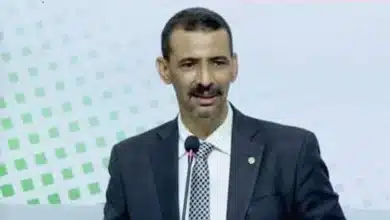La liberté d’expression en Mauritanie : entre espoirs constitutionnels et réalités judiciaires
Analyse de la liberté d’expression en Mauritanie : entre les promesses constitutionnelles, les pressions judiciaires et le combat des citoyens pour leurs droits.

Inscrite dans la Constitution comme un droit fondamental, la liberté d’expression en Mauritanie demeure un horizon plus qu’une réalité vécue. Entre les promesses solennelles des textes et les contraintes imposées par certaines pratiques judiciaires et politiques, le chemin vers une expression véritablement libre reste semé d’embûches.
La Constitution mauritanienne, dans son article 10, proclame que « la liberté d’opinion et d’expression sous toutes ses formes est garantie ». Ce principe, gravé dans le marbre du droit fondamental, devrait constituer la pierre angulaire d’une société démocratique et inclusive. Pourtant, sur le terrain, de nombreuses voix s’élèvent pour dénoncer l’écart persistant entre cet idéal constitutionnel et les réalités vécues par les citoyens, les journalistes et les acteurs de la société civile.
L’histoire contemporaine du pays montre que la liberté d’expression a souvent été perçue comme un terrain de tension où se confrontent deux logiques : celle de l’État, soucieux de préserver l’ordre public et la stabilité, et celle des citoyens, attachés à leur droit d’exprimer leurs opinions, y compris critiques, à l’égard du pouvoir. Ce face-à-face a façonné un climat où la parole publique oscille entre ouverture prudente et autocensure.
Le poids des textes et l’ombre des pratiques
Si la Constitution et certaines lois garantissent théoriquement la liberté de presse et la protection des opinions, d’autres dispositifs viennent restreindre ce droit au nom de la sécurité, de la morale publique ou de la lutte contre la désinformation. Ces restrictions, bien que justifiées par leurs promoteurs, peuvent dériver vers des instruments de contrôle.
Des procès intentés à des journalistes, militants ou blogueurs, parfois sur des bases juridiques fragiles, alimentent l’idée que la justice n’est pas toujours un arbitre impartial mais peut devenir un outil de dissuasion.
Le cas Ely Ould Bakar : quand la parole écologique devient un crime
L’affaire d’Ely Ould Bakar illustre crûment ces tensions, pour l’analyste Abdoulaziz Dème. Ce militant a été arrêté et emprisonné après avoir dénoncé le pillage massif des ressources halieutiques dans les eaux mauritaniennes, notamment par de puissants chalutiers étrangers — turcs ou européens — accusés de vider les stocks de poissons essentiels à la sécurité alimentaire et à la survie économique des pêcheurs artisanaux.
Son engagement en faveur de la justice environnementale et de la protection des ressources marines lui a valu le soutien d’ONG internationales et d’acteurs locaux. Pourtant, le gouvernement l’a accusé de diffuser de fausses informations, transformant son combat en symbole des lanceurs d’alerte muselés pour avoir dénoncé la destruction du patrimoine naturel du pays.
Ce cas s’inscrit dans un contexte de crise profonde du secteur halieutique, aggravée par des accords internationaux controversés qui, sous couvert de coopération, accordent à des flottes industrielles étrangères un accès privilégié aux eaux nationales, souvent au détriment des populations locales. Ici, la défense de l’environnement et des droits des communautés côtières se heurte à des intérêts économiques puissants et à des réflexes autoritaires.
Justice et équilibre des droits
Une société démocratique repose sur un équilibre délicat : garantir à chacun la liberté de parole tout en préservant l’ordre et la dignité des personnes. Or, cet équilibre ne peut être atteint que si la justice agit en toute indépendance, sans pression politique, et en interprétant les lois à la lumière des valeurs constitutionnelles. Lorsque les procédures judiciaires semblent privilégier la préservation du pouvoir au détriment de la protection des libertés, c’est toute la crédibilité de l’État de droit qui se trouve fragilisée.
Le Conseil constitutionnel : un sursaut attendu
La récente décision du Conseil constitutionnel d’invalider plusieurs dispositions clés du projet de règlement intérieur de l’Assemblée nationale illustre l’importance d’institutions indépendantes dans la protection des libertés publiques. Ce n’est pas une première, mais l’enjeu était majeur : préserver la qualité démocratique du parlement et réaffirmer les droits d’expression et d’initiative des députés.
Ce sursaut, salutaire, pourrait marquer un tournant dans le long processus d’affirmation de l’indépendance du Conseil, longtemps perçu comme inféodé à l’exécutif. Son président actuel, connu pour ses positions critiques lors du référendum constitutionnel de l’article 38, démontre qu’une voix dissonante est possible au sein de cette institution.
Cependant, ce geste fort ne doit pas faire oublier les limites structurelles qui entravent son action : une architecture institutionnelle et un mode de fonctionnement qui réduisent sa capacité à agir en juge véritablement indépendant. Sans réforme en profondeur du Conseil constitutionnel — première garantie de transparence électorale aux côtés de la Cour suprême et de la CENI —, cette avancée risque de rester un feu de Bengale dans un ciel encore sombre, selon l’expression de Me Gourmo.
Entre craintes et espoirs
Malgré les limites actuelles, la société mauritanienne continue de porter haut l’exigence d’une liberté d’expression réelle. Les débats publics, la vitalité de certains médias indépendants, l’émergence de jeunes voix sur les réseaux sociaux témoignent d’un désir profond de faire vivre l’esprit de la Constitution. Ces signaux montrent qu’une évolution est possible, à condition que les institutions judiciaires et politiques acceptent de jouer pleinement leur rôle de garants des droits, et non de gardiens des silences.
Conclusion
La liberté d’expression n’est pas un luxe réservé aux temps de prospérité ; elle est la condition même de la vitalité démocratique. En Mauritanie, elle reste à la croisée des chemins : protégée par les textes, parfois étouffée dans les faits. Le défi est clair : transformer l’espérance constitutionnelle en une réalité quotidienne où chaque citoyen — qu’il soit journaliste, parlementaire, militant ou simple observateur — puisse s’exprimer sans crainte ni contrainte. Car une démocratie sans liberté d’expression est une maison sans fenêtres : elle étouffe, faute d’air.
Rédaction Rapide info