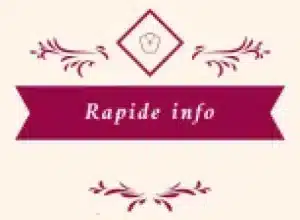Chapitre 2 : Le grand repas

Chapitre 2 : Le grand repas
Il y avait une époque où les repas ne se comptaient pas en convives, mais en manches.
À Nouakchott, surtout dans les anciens quartiers, on ne disait pas qu’il y avait “beaucoup de monde à table”, mais que “le plat avait mille manches”. Cela voulait dire que chacun avait sa place, que chacun pouvait tendre le bras, se pencher et recevoir. Le plat, en général une large bassine en aluminium cabossé, fumait au centre de la natte. Autour, les rires, les histoires, les disputes parfois — mais toujours les regards croisés, la reconnaissance mutuelle.
C’était cela, la vraie richesse.
Pas les murs en ciment. Pas les titres. Pas les 4×4.
Mais ce moment : des bras qui plongent dans le même plat, des manches qui se salissent du même riz, et l’impression, tenace, qu’on fait corps.
Dans la maison des Zein, ces repas collectifs étaient autrefois une institution.
Chaque vendredi, la grande porte s’ouvrait dès la prière de midi. Le salon se vidait de ses meubles, les tapis s’alignaient jusqu’à la cour, et des bassines de couscous ou de riz à la viande circulaient dans un ballet orchestré par les femmes de la maison, les domestiques et les tantes venues prêter main forte.
On y voyait des employés, des cousins éloignés, des nécessiteux, des commerçants du coin, des étudiants isolés — tous invités, sans protocole. Zein appelait cela « son devoir d’homme comblé ». Il disait :
« Je rends ce que Dieu m’a prêté. »
Mais dans les faits, chacun savait que ces repas étaient aussi des scènes politiques. L’homme distribuait sa générosité comme un berger jette du grain à ses moutons. Ceux qui mangeaient aujourd’hui voteraient demain, soutiendraient après-demain, défendraient, protégeraient, relaieraient sa voix dans la tribu, dans le quartier, dans les couloirs du pouvoir.
Pourtant, dans l’assiette, il y avait de la sincérité. Et parfois, c’est assez.
Ce jour-là, le soleil était haut et le vent passait entre les murs nus du quartier périphérique de Riyad. Une femme, Khadijetou, veuve depuis trois mois, préparait un repas pour une trentaine de personnes ou plus avec les restes de riz blanc et une demi-poignée de légumes fanés. Autour d’elle, les enfants chantaient sans conviction. Son voisin, Sidi, ancien enseignant devenu réparateur de téléphones, arriva sans prévenir avec un sac de pain rassis et quelques dattes.
— « On mangera ensemble. Ce n’est pas grand-chose, mais à plusieurs, le ventre comprend mieux. »
Ils étaient sept autour du plat. Les manches tremblaient parfois, mais elles étaient là.
La solidarité à Nouakchott ne portait pas de nom savant.
Elle ne faisait pas l’objet de rapports, d’ONG ou de statistiques.
Elle était vécue, chaque jour, sans témoins.
On prêtait. On soignait à crédit. On hébergeait des cousins. On versait la zakat, souvent en silence. On transportait un malade en voiture même quand on manquait d’essence. Et surtout, on écoutait. Ce qui, dans un monde bruyant, est devenu rare.
Les imams, dans les mosquées, rappelaient que « celui qui dort repu alors que son voisin a faim n’est pas des nôtres ».
Mais ce n’étaient pas ces mots qui faisaient vivre la solidarité.
C’étaient les femmes.
Les mères.
Les sœurs.
Celles qui tenaient les foyers à bout de bras, de prières et de patience.
Pourtant, une transformation lente s’opérait dans la ville.
Les nouveaux riches s’enfermaient derrière des portails métalliques. Les classes moyennes s’équipaient de caméras de surveillance. Et même dans les familles modestes, on sentait une gêne nouvelle à partager, à demander, à s’abandonner aux autres.
Certains appelaient ça la dignité. D’autres, la fierté.
Mais c’était surtout la peur. Peur de manquer. Peur d’être envahi. Peur que la solidarité devienne une faiblesse.
Le repas aux mille manches devenait, petit à petit, un repas à quatre, puis à deux, puis seul, devant une assiette de plastique, devant un écran de téléphone.
Un jour, Zein fit annuler le déjeuner du vendredi.
— « Trop de monde, disait-il. Trop de bruit. Trop de dépenses. Et puis, ce n’est plus nécessaire. Chacun vit sa vie maintenant. »
Ce jour-là, les marmites restèrent vides. Les domestiques attendirent en silence des ordres qui ne vinrent pas. Et dans la rue, un jeune homme, qui avait marché deux kilomètres, fut refoulé sans explication.
Il ne dit rien. Il s’assit sous un arbre, puis repartit vers le sud de la ville, là où les repas n’avaient pas de maître.
C’était cela, le début de la fracture.
Presque rien. Une habitude qui se perd. Un geste qu’on omet. Un plat qui ne fume plus.
Mais dans une ville comme Nouakchott, ce sont ces petits gestes qui tiennent les murs debout.
Et lorsqu’ils disparaissent, la poussière n’attend pas longtemps pour s’installer.
Le Repas aux Mille Manches
Ahmed Ould Bettar
Lire aussi : Chapitre 1 : Une année de délivrance
Lire également : Chapitre 3 : Les failles