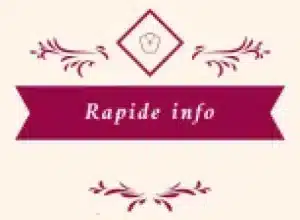Le Repas aux Mille Manches
Nouakchott, chronique d’une ville écartelée entre solidarité et solitude

Chapitre 1 : Une année de délivrance
Nouakchott, cette année-là, était comme une délivrance, un soulagement!
Le sable avait cessé de tourbillonner dans les têtes. Le vent, longtemps chargé de rumeurs, de plaintes, de fatigue collective, semblait enfin souffler plus doucement sur les tôles rouillées des quartiers périphériques. Le ciel, lui aussi, avait changé de regard. Il ne pesait plus sur les épaules des enfants comme une menace opaque, mais s’ouvrait, large et bleu, au-dessus d’une ville haletante. C’était une année sans date précise, une année floue mais décisive, marquée non par un événement spectaculaire, mais par une lente bascule, imperceptible et irréversible.
Les vieux disaient :
« Elle nous a été rendue. La ville. Comme un enfant perdu qu’on retrouve devant la porte. »
D’autres, plus jeunes, la redécouvraient, sans trop savoir s’ils devaient la craindre ou l’aimer.
Dans les rues poussiéreuses de Dar Naïm, de Sebkha, de Tarhil ou du Ksar, les étals recommençaient à s’installer tôt le matin. Les vendeuses de poisson et de tomates, foulards noués sur la nuque, redressaient la tête. Les silhouettes anonymes se remettaient en marche, tenant entre leurs mains les petits secrets d’un espoir trop longtemps repoussé.
Mais ce n’était pas une euphorie. Non. Plutôt un soupir. Un relâchement collectif. Après les années d’incertitude, de confinement ou de pénurie — après la désagrégation des liens les plus simples —, Nouakchott entrait dans une autre forme de fatigue : celle du réveil. Et le réveil, dans une ville comme celle-là, n’est jamais sans douleur.
Au cœur de cette ville tendue entre l’océan et le désert, un mot revenait dans toutes les conversations : « solidarité ».
Un mot ancien, racé, usé par les prêches du vendredi et les slogans politiques, mais qui gardait une force intime, presque sacrée.
Dans les cours sablonneuses, les femmes prêtaient encore des marmites, les jeunes s’entraidaient pour enterrer les morts, et les familles se cotisaient pour les opérations chirurgicales de dernière minute. Chez nous, on ne disait pas « je donne », on disait « je participe », comme si la bonté devait être partagée à parts égales.
Le repas aux mille manches, disait-on.
Un proverbe ancien, devenu presque invisible, mais toujours vivant dans les gestes du quotidien. Chacun y plongeait la main : non pour prendre, mais pour nourrir les autres. Mille manches, mille bras, mille raisons de ne pas laisser l’autre tomber.
La famille Zein était, dans cette tradition, une figure imposante. Le père, ancien ministre et actuel directeur d’une grande société para-étatique, était respecté à défaut d’être aimé. Il avait l’élégance des notables et la voix lente des hommes que la vie n’avait jamais pressés. On disait de lui qu’il donnait sans compter, mais aussi qu’il attendait qu’on s’en souvienne.
Dans les mosquées, lors des grandes fêtes, aux enterrements, Zein était toujours là, enveloppé dans un grand boubou blanc, serrant des mains, glissant discrètement une enveloppe à une veuve, prenant des nouvelles d’un cousin malade. Il incarnait cette caste ancienne — mi-politique, mi-parentale — qui faisait tenir la société par une toile invisible d’obligations réciproques.
Mais cette année-là, quelque chose vacillait, même chez lui.
Car derrière la façade apaisée, le cœur de la ville battait de travers.
Les structures de santé étaient saturées. Les dispensaires ne répondaient plus au téléphone. Le personnel médical, sous-payé, manquait de gants, de masques, parfois même d’eau courante. Et dans les quartiers les plus éloignés du centre, on se passait les informations comme des talismans : « Un médecin qui accepte sans rendez-vous. Un centre qui prend encore les urgences. »
Les jeunes, eux, rêvaient des Canaries comme d’un autre monde. Pas pour vivre. Pour respirer. Même ceux qui n’avaient jamais vu la mer. Même ceux qui ne savaient pas nager.
À Nouakchott, l’exil commençait souvent par une promesse :
« Je reviens avec quelque chose. Pour vous. Pour tous. »
Et finissait en silence.
Dans ce désordre contrôlé, la solidarité tenait encore, mais à peine.
Elle tremblait sous le poids des dettes, des petits trafics, des violences domestiques qu’on taisait par pudeur. Elle craquait parfois sous les cris d’une mère qu’on bat ou d’un enfant qui ne mange pas à sa faim. Mais elle tenait. Par miracle, par orgueil, ou simplement par habitude.
C’est dans cette faille que Zein allait glisser. Lentement. Doucement. Comme on quitte une salle trop bruyante pour écouter le silence de ses propres désirs.
La ville ne le savait pas encore. Mais l’homme au grand boubou blanc, celui qu’on saluait encore avec déférence, allait bientôt tourner le dos à cette table aux mille manches.
Et chacun le sentirait. Comme on sent l’absence d’un pilier lorsqu’il se retire d’une maison construite sur le sable.
à suivre …
Ahmed OULD BETTAR