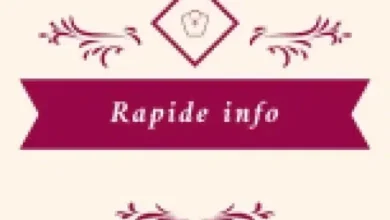Mauritanie : quand la parole devient arme – le duel entre Biram Dah Abeid et Bouhoubeyni
Dans la tradition hassanienne, la parole est plus tranchante que le sabre. À travers le cas du jeune Yarg Ould Dah, un débat éclate entre deux figures majeures des droits humains : Biram Dah Abeid et Ahmed Salem Ould Bouhoubeyni. Entre symbolisme politique et dignité républicaine, c’est la parole qui juge.

Mauritanie : quand la parole devient arme-
Il y a des batailles qu’on ne mène pas avec des sabres, mais avec la bouche. Et dans la mythologie hassanienne du Trarza, la parole est plus tranchante que le fer. Là-bas, entre les dunes et les silences cultivés, on enseigne aux enfants qu’un homme se reconnaît à la forme de ses phrases, pas à la force de ses poings. Que l’on peut mourir d’un mot, et vivre par un autre.
C’est dans cette tradition du « el-kalâm el-tayîb », la parole noble, que se situe le débat houleux entre deux figures majeures des droits humains en Mauritanie : Biram Dah Abeid, tribun incandescent au verbe volcanique, et Ahmed Salem Ould Bouhoubeyni, juriste du calme et gardien d’une certaine idée de l’élégance républicaine.
Le fait est simple : un jeune homme, Yarg Ould Dah, ancien esclave affranchi en 2011 et aujourd’hui lycéen au Sénégal, a réussi son baccalauréat. C’est une réussite, certes. Mais ce n’est pas une première. Des fils d’anciens esclaves, d’orphelins, d’anonymes sans carte politique ont réussi, brillamment, et sans tambour ni mélo.
Mais voilà que Biram, adoptant une posture quasi hiératique, a transformé l’annonce du bac de Yarg en manifeste, en drapeau, en cri. Comme si l’enfant, devenu jeune homme, n’avait pas encore mérité d’être un individu, mais devait rester symbole.
Dans une tribune d’un calme désarmant, Ahmed Salem Ould Bouhoubeyni rappelle une vérité :
« Quand on libère un homme, il faut aussi libérer son histoire de la cage. »
Ce que Ould Bouhoubeyni dénonce, ce n’est pas le fait de célébrer Yarg. C’est de le maintenir captif d’un passé devenu outil de marketing politique. C’est d’en faire un rappel permanent que l’on promène comme une blessure ouverte pour récolter les larmes du public.
Il appelle donc, avec ce tact qui sied aux vrais lettrés, à libérer Yarg une seconde fois : cette fois, du fardeau du symbole. Car un homme ne peut pas marcher vers l’avenir s’il est constamment ramené par les poignets vers son passé.
La réponse de Biram ? Des audios où les critiques acerbes coulent comme un oued en crue, où l’on n’épargne ni l’ascendance ni la dignité. Des mots que la tradition hassanienne aurait qualifiés d’ »el-kalâm el-tayih » — la parole tombée, qui dissout l’homme au lieu de le grandir.
C’est là que la bataille devient culturelle : la parole en tant que témoin de civilisation. Car dans le Trarza ancestral, on apprenait aux poètes que le pire outrage n’est pas de perdre un duel, mais de le gagner en salissant sa bouche.
Ahmed Salem Ould Bouhoubeyni, fidèle à son style de lettré civilisé, n’a pas répondu aux attaques. Il s’est contenté de dire que la parole doit redevenir un outil d’élévation dans une société où le verbe s’est prostitué au bruit. Et ce disant, il a gagné.
Dans l’Iguidi, on disait :
« La parole est une monture : choisis-la bien, car c’est elle qui te portera ou te renversera. »
Dans ce duel verbal, chacun a enfourché sa propre monture. L’un a choisi la colère et la rudesse. L’autre, la mesure et la hauteur. À chacun de décider quel cheval mène au progrès.
Mais une chose est sûre : on ne libère pas les hommes en les retenant dans nos récits.
On les libère en les laissant écrire les leurs.
Mohamed Ould Echriv Echriv