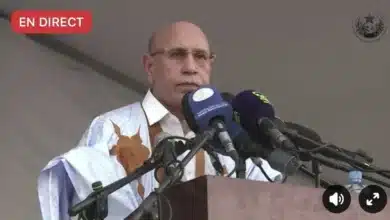La Mauritanie : Vers une Nouvelle Souveraineté Maritime et Écologique
Découvrez comment la Mauritanie, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Merzoug, affirme sa volonté de gouverner son espace maritime comme un vecteur de souveraineté et d'innovation. Analyse des enjeux géopolitiques et écologiques à l'échelle mondiale.

À la Conférence des Nations Unies sur la protection des océans, Mohamed Salem Ould Merzoug expose une vision audacieuse pour la Mauritanie, transformant la conservation marine en une déclaration de souveraineté. Ce discours révèle un changement stratégique vers une gouvernance maritime proactive et intégrée dans les normes internationales.
Dans un monde où la géopolitique des ressources naturelles se recompose autour de la mer, les discours écologiques deviennent des déclarations de souveraineté différée. Tel est le sens profond du propos prononcé par Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre des Affaires étrangères, à la troisième session de la Conférence des Nations Unies sur la protection des océans.
Ce qui semble, en surface, un discours environnemental classique, est en réalité une mise en scène diplomatique d’un nouveau paradigme stratégique : la Mauritanie ne se contente plus d’avoir un littoral, elle entend désormais le gouverner comme un espace de projection géoéconomique et d’innovation politique.
En affirmant que « la Mauritanie reste fermement engagée à construire un avenir maritime sûr et durable », Ould Merzoug inscrit la politique maritime nationale dans un répertoire discursif transnational aligné avec l’Agenda 2030 des Nations Unies. Mais sous cette adhésion apparente aux normes globales, se dessine une volonté d’appropriation régulée d’un espace autrefois négligé : l’espace maritime est ici requalifié comme matrice stratégique, au croisement des défis climatiques, de la sécurité énergétique et des ambitions économiques nationales.
Il ne s’agit pas seulement de protéger : il s’agit de gouverner la mer comme on gouverne un territoire, avec des outils juridiques, des systèmes de surveillance, et des alliances diplomatiques.
L’énumération des engagements juridiques récents — ratification de la Convention BBNJ (biodiversité au-delà des juridictions nationales), protocole d’Abidjan sur l’environnement offshore, etc. — n’est pas un inventaire pour faire joli, mais une stratégie normative d’insertion proactive dans les nouveaux régimes juridiques maritimes.
Ould Merzoug fait ici ce que les États périphériques font rarement : revendiquer leur place dans la fabrique du droit international environnemental. Il ne subit plus les traités : il les active, les intègre et les utilise comme levier d’accès à la technologie, au financement et à l’influence.
Ce mouvement traduit un déplacement de la souveraineté classique vers une souveraineté instrumentale, fondée sur l’agilité juridique, l’ingénierie réglementaire et l’alignement sur les régimes d’obligations collectives.
Quand le ministre évoque « un développement durable juste, global et équitable », il ne parle pas que de développement humain. Il parle d’un nouvel imaginaire économique post-extractiviste : celui de l’économie bleue, comprise comme synthèse entre la croissance et la régulation, l’exploitation et la conservation.
L’économie bleue, ici, n’est pas une simple rhétorique verte repeinte en bleu. Elle devient le cadre de convergence de politiques publiques sectorielles : pêche durable, énergies marines renouvelables, biotechnologies marines, résilience côtière.
Ce cadrage révèle une gouvernance par hybridation, où les domaines techniques (halieutique, surveillance, droit maritime, climatologie) sont intégrés dans une architecture politique plus large. Ce que propose implicitement Ould Merzoug, c’est une transition vers une planification maritime à haute densité stratégique.
L’insistance sur le renforcement des capacités de surveillance, inspection et lutte contre la pollution indique une orientation nette : la souveraineté maritime passe désormais par la maîtrise de la donnée océanique.
C’est ici que le discours atteint son niveau technopolitique le plus subtil. Car la donnée environnementale, souvent considérée comme neutre, est en réalité un vecteur de pouvoir géostratégique. Celui qui contrôle les modèles climatiques, les cartes de vulnérabilité, les flux de biodiversité et les capteurs satellitaires, contrôle aussi les financements, les priorités et les mécanismes de gouvernance.
En signalant la nécessité d’« accès équitable à la technologie, à la connaissance et à l’innovation », Ould Merzoug dénonce en creux l’asymétrie informationnelle entre Nord et Sud, tout en appelant à une diplomatie du savoir océanique fondée sur la réciprocité et la transparence.
En insistant sur une coopération fondée sur la solidarité et la responsabilité partagée, le ministre ne formule pas un vœu pieux : il redéfinit l’architecture d’un multilatéralisme marin en mutation. Là où l’ordre international postcolonial a longtemps été vertical (donateur / récepteur), il propose un cosmopolitisme horizontal des littoraux, où les pays côtiers du Sud seraient co-concepteurs de la gouvernance océanique, et non plus ses exécutants périphériques.
Ce positionnement appelle à un nouveau pacte transocéanique, où les savoirs endogènes, les communautés côtières, la société civile scientifique et les acteurs étatiques seraient réunis dans une forme d’écosystème diplomatique inédit.
Le discours d’Ould Merzoug n’est pas un simple exercice diplomatique. C’est un manifeste technique d’une souveraineté écologique en reconstruction, une proposition d’architecture marine pour une nation qui, dans le silence de ses courants atlantiques, cherche à articuler stabilité intérieure, visibilité extérieure, et viabilité planétaire.
Ce que dit Ould Merzoug aux Nations Unies, c’est que la Mauritanie n’est pas un pays côtier. Elle est désormais un acteur marin.
Mohamed Ould Echriv Echriv