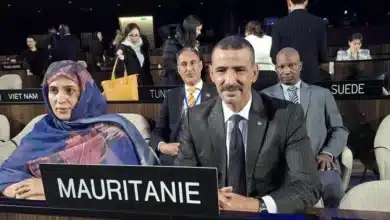Réponse à Gourmo Abdoul Lô – Contribution au débat / Par MANSOUR LY

Débat : thématique
Réponse à Gourmo Abdoul Lô – Contribution au débat
Par MANSOUR LY
Merci M. Gourmo pour cette prise de parole claire et salutaire. Votre texte a le mérite de poser les mots justes sur une dérive insidieuse que nous devons affronter lucidement : le harcèlement linguistique dans l’espace public mauritanien.
Mais au-delà de la scène elle-même, un ministre s’exprimant en français, un ambassadeur optant pour l’arabe, ce qui trouble, c’est l’instrumentalisation immédiate de cet échange par certains acteurs qui cherchent à réactiver des réflexes identitaires au détriment du bon sens, de la courtoisie diplomatique et du pluralisme républicain.
Dans un pays comme le nôtre, multilingue, multiculturel et traversé par des tensions récurrentes autour de la langue, il n’y a rien d’étonnant à ce qu’un ministre mauritanien choisisse, dans le cadre d’une rencontre bilatérale, la langue qu’il maîtrise le mieux. Ce n’est ni une trahison ni une anomalie. C’est un choix fonctionnel, respectueux, cohérent.
Et ce type de situation n’est pas isolé. Au Maroc, par exemple, de nombreux responsables gouvernementaux s’expriment en français lors de rencontres diplomatiques ou de conférences internationales, même si l’arabe est la langue officielle du royaume. Le français y est reconnu de facto comme langue de travail dans l’administration, les affaires et la diplomatie. Cela n’alimente aucune polémique identitaire. Ce sont des usages, non des trahisons.
Ce qui est bien plus problématique, c’est cette tendance croissante à surinterpréter chaque usage linguistique comme une provocation ou une revendication idéologique. À faire de la langue un outil de disqualification citoyenne. À confondre défense de l’arabe avec dénigrement systématique des autres langues de la République, qu’elles soient nationales ou de travail.
L’arabe ne peut être la langue d’un groupe contre d’autres. Pas plus que le français, le pulaar, le soninké ou le wolof ne doivent être relégués à des sous-statuts honteux.
Et je parle ici d’expérience. Il m’est arrivé, dans un cadre professionnel, de m’exprimer en français face à des interlocuteurs qui le comprenaient parfaitement et qui choisissaient délibérément de ne pas répondre ou de répondre en arabe pour me signifier une forme de mépris symbolique. Ce refus de communication, fondé sur un dogme linguistique, est une violence silencieuse mais bien réelle.
La langue ne devrait jamais être une barrière imposée. Elle est un outil de lien, de service, de transmission. Or à trop vouloir la sacraliser, certains finissent par l’armer. Et cela, nous devons le refuser.
Nous avons besoin d’un État qui assume pleinement le caractère plurilingue et égalitaire de ses composantes. Cela suppose une clarification officielle du statut des langues nationales comme langues de l’État, une redéfinition des rôles fonctionnels des langues étrangères dans l’administration et l’enseignement, et une lutte ferme contre toute forme de stigmatisation fondée sur la langue d’expression.
Ce qui est en jeu ici dépasse une scène de protocole. C’est la promesse même de notre contrat républicain. Garantir à chacun le droit de comprendre, de participer et de s’exprimer sans devoir s’excuser d’exister.
MANSOUR LY